
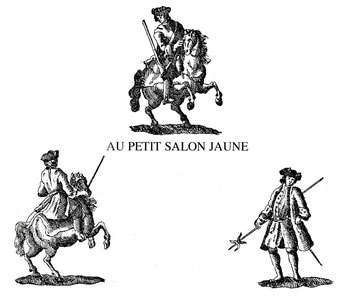
Ce que les villageois appellent "le château", à Teyssode, est une grosse maison carrée en-dessous de l'église. Il a la particularité d'être en pierre plutôt qu'en briques ou en torchis comme les autres demeures, et nul ne peut disconvenir de sa construction, car il porte, en creux et en relief, sur sa façade, la date 1864 au-dessus d'un blason ovale où un aigle a l'air de s'étirer sous ce qui me parut longtemps être une ligne de peupliers.
C'est, paraît-il, à la suite d'un don par les dernières demoiselles de Teyssode que "le château" était passé aux Soeurs de la Croix de Lavaur. Elles l'avaient transformé en école libre pour petites filles, qui faisait concurrence à l'école laïque, sur la place de la mairie (où il n'y avait guère que des garçons). Aidée de ma grand-mère Clémentine, qui faisait la cuisine, ma tante Jeanne Escande, avec sa mauvaise humeur et ses lunettes de fer, régnait sur une quinzaine d'enfants de hameaux proches ou éloignés : La Creuse, Pech de Camp, Bélaval, Emporte-Pot, les Trois Moineaux. Cet été 1943, comme il n'y avait décidément plus rien à ronger à Paris, à part les os de seiches du marché de Buci, mes parents décidèrent de me laisser à la campagne avec mes soeurs Denise et Josette, déjà là depuis l'année précédente. J'allais avoir dix ans et il fut décidé avec le bon abbé Vidal, curé de Teyssode, que cette année compterait pour la 6ème, car il se chargeait de m'apprendre les rudiments du latin.
Quel plaisir, quel émerveillement pour de petits Parisiens sortant d'un appartement étriqué de la rue des Beaux-Arts et de la misère de l'Occupation, de se trouver seuls et libres dans cette vaste demeure ! Elle nous paraissait immense. Dès l’entrée, une gigantesque Vierge en bois doré, le coeur transformé en pelote d'épingles par les sept épées de ses douleurs, nous ouvrait ses bras compatissants. Nous pouvions courir de la cave au grenier sans crainte de déranger d’autres gens qu'en bas les poules dans leurs nids de poussière, et en haut les chouettes sur les poutres. Nul ne nous interdisait de nous gaver de prunes vertes dans le jardin d'où partait, dit-on, un souterrain qui débouchait dans la grande salle du château de Magrin, sur la colline d'en face. Enfin, grande nouveauté, chacun de nous avait sa chambre. La mienne s’appelait "la chambre de la mariée ", sans que rien n’y rappelât un quelconque mariage : bien au contraire, sur la cheminée de marbre noir, une Basilique de Lourdes en réduction resplendissait sous un globe à socle d'ébène.
Que de soirées délicieuses je passais cet hiver-là enfoncé dans un grand lit à ramages, sous un édredon rouge, à lire Le Capitaine Fracasse dans l'édition de la Bibliothèque Verte qu'on m'avait offert pour Noël et que je dévorais à la lueur d'une bougie ! Car naturellement il n'y avait pas d'électricité. Le vent mugissait contre les volets. L'horloge de l'église proche sonnait, impavide, les heures. Le vent s'enfuyait dans les collines, cherchant à arracher quelque chêne, puis, furieux de sa déconvenue, revenait faire claquer tous les petits volets carrés du grenier. Quelles terreurs délicieuses ! C'est là, à cette époque, que je décidai de vivre à la campagne. Mais il s'en fallut de bien des années avant que je ne me tienne promesse.
Un seul endroit nous était interdit, soi-disant parce qu'il y avait des rats : c'était au premier étage, une pièce délabrée que mes soeurs appelaient "le petit salon jaune". Peut-être avait-il porté ce nom autrefois. Nous y étions toujours fourrés, au lieu de jouer dans les lauriers roses ou à l'ombre de la Vierge en fonte debout sur un croissant de lune qui ponctue la limite extrême du jardin.
Le petit salon jaune ouvrait au bout du couloir sur le perron du jardin. On y accédait par trois marches en tommettes usées. Venant de l'éblouissante clarté du dehors, on mettait un moment à s'accoutumer à la semi-obscurité. Les volets étaient hermétiquement clos, et même les fenêtres, aux rideaux gris de poussière tendus de toiles d'araignées. A part ça, pas de femmes pendues, pas de sang caillé (comme dans Barbe-Bleue). Dans la rue, des villageoises se promenaient avec leurs "farrats" (leurs seaux) ; elles venaient chercher chez nous un "farradat" d'eau, car en cet été torride seule la citerne de notre jardin gardait une réserve. De temps en temps on y trouvait, noyés et les pattes en croix, des lézards légitimement assoiffés, mais imprudents. Vers le cimetière bossu retentissait le bruit argentin du marteau de M. Cabaussel, le forgeron, et à sept heures le bon abbé Pierre Vidal, dont je fus un enfant de choeur, sonnait l'Angélus, que ma tante et ma grand-mère, à genoux dans la cuisine, reprenaient dévotement :
- L'Ange du Seigneur annonça à Marie...
- Je suis la servante du Seigneur.
Occupés à inventorier l'ancien salon, et "sages comme des limaces", nous faisions moins de bruit que les fameux rats, qui n'existaient que dans l'imagination de ma tante, il y avait là des malles en peau de chèvre mangée aux mites, des gravures que j'ai plus tard identifiées comme des Lancret. Leurs cadres dorés, depuis longtemps moisis, montraient leur plâtre. Des lettres, des rouleaux de dessins s'échappaient de cartons. Même les gens qui avaient abandonné ces souvenirs étaient morts à leur tour : il ne restait, dans des boîtes de biscuits en fer qui représentaient des couchers de soleil orange dans des pinèdes marron, que des photos jaunies de femmes en robes à tournure, comme prises dans un tourbillon de vent de sable, et des paquets de correspondances nouées de vieux rubans bleus. Un paysan, ensuite, avait pris possession des lieux. Sans rien déranger, il avait entassé jusqu'à mi-muraille du foin pour les litières de lapins qu'il élevait de l'autre côté du couloir, dans la "chambre aux punaises des bois" que nous appelions ainsi parce que dès l'automne ces bestioles vertes et puantes venaient s'y réfugier de la forêt voisine.
Depuis beau temps le paysan et ses lapins avaient eux aussi disparu. Nous nous roulions dans le foin sec, qui ne sentait plus que la poussière. Mes soeurs, coiffées d'anglaises avec des rubans choux roses à chaque tempe (et des robes à smocks que leur brodait maman) essayaient des robes de faille et de soie brune qui nous semblaient étonnement petites : elles avaient pourtant appartenu à des femmes adultes, sous Louis XV. Quant à moi, armé d'une paire de ciseaux, je découpais avec application les cachets de cire rouge, verte ou noire qui dans le temps avaient clos ces lettres. C'étaient, si je me souviens bien, des têtes frisées d'Antinoüs et autres Télémaques. Ils furent par mes soins enfermés dans une boîte de poudre "Mille Fleurs" d'Houbigant, et définitivement perdus. Certains papiers formaient plusieurs liasses allongées, ficelées de cordelettes brunes encore très solides. Il y avait aussi des livres de comptes reliés en parchemin, de différentes formes et épaisseurs, des cahiers de musique...
Vers la fin de l'été une des Soeurs de la Croix (je pense que c'était la Supérieure) vint rendre visite à ma tante. Grand branle-bas dans le château. Nous la guettions de derrière les volets, car naturellement nous n'étions pas invités à cette importante entrevue, bourrée de préséances et de questions épineuses comme une châtaigne dans sa bogue. La Soeur arriva à vélo (il n'y avait pas d'autres moyen de se déplacer) sa cornette ou son voile volant au vent d'autan. Elle avait un visage mince et pâle, l'air ouvert et le sourire avenant, tout le contraire de ma tante, donc. Elle visita la maison, s'assura que la salle de classe, au premier, était bien pourvue d'un litre d'encre violette, et comme ma tante lui ouvrait la porte du "petit salon jaune” qui nous était si cher, elle dit :
- Tout ce qu'il y a dans ce débarras, vous pouvez le brûler dans le jardin...
Puis elle repartit, toujours à vélo, à travers les collines de Massac et les sarcasmes de ma tante, qui trouvait que côté religion elle pouvait, Dieu merci, en remontrer encore à n'importe qui. (Ma tante était le seul vrai pilier que j'ai personnellement connu de notre sainte religion catholique, apostolique et romaine).
Je chancelais, comme ivre. Comment ! On allait brûler ces lettres si extraordinaires, que j'arrivais presque à déchiffrer ! J'allais trouver mon père, qui fumait sa pipe sous les pruniers. Il se demandait ce qui serait plus avantageux d'emporter à Paris pour l'hiver : des pommes de terre, ou des haricots secs ? (Qu'il avait passé l'été à acheter, une livre deci, un kilo delà, dans les fermes environnantes). Comme tout Français à l'époque, dès qu'il venait en province, c'était pour emplir des caisses soigneusement clouées de précieux tubercules ou autres légumineux qui, voyageant par le train et renvoyés de gare en gare à cause des bombardements arrivaient souvent des semaines après. On allait les chercher à la gare d'Austerlitz, et à l'odeur on les devinait échauffés, ou germés, quand ce n'était pas pourris. Souvent même ils n'arrivaient pas du tout, ayant été volés en route par les cheminots. La puanteur des couloirs du métro, d'Austerlitz à Odéon, bondés de gens hâves, qui défaillaient sous des caisses de légumes plus que mûrissants, est un de mes plus violents souvenirs d'enfance. Et à Odéon ce n'était pas fini : il fallait encore arriver, à pied, rue des Beaux-Arts, avec ces kilos de fruits et légumes dont on jetait la moitié à la poubelle.
Mes papiers lui posaient donc un problème certain : patates, ou lettres du XVIIIe siècle ?
Heureusement papa vivait dans le milieu des libraires d'ancien de la rue Bonaparte et de la rue de Seine : pour allonger sa paye du Crédit Foncier de France, où il était rédacteur en chef, il tenait la comptabilité d'un certain Sven Nielsen, propriétaire d'une petite boîte de messageries "Les Messageries du Livre", 57 rue de Seine, qui n'étaient pas encore devenues les puissantes "Presses de la Cité".
- Je les montrerai à Monsieur Martineau, me promit-il.
Martineau, le libraire du "Divan", rue Bonaparte, en face de l'église Saint-Germain des Prés, était un spécialiste de Stendhal, mais ce n'est pas pour lui que mon père le fréquentait : il haïssait Beyle ("Ce Stendhal est un faux-jeton»). Il venait voir Martineau pour ses rééditions de Tristan Derême. Tristan Derême est d'Oloron, et c'est là que mon père a connu ma mère. Mais ne nous éloignons pas. Finalement, il emporta les papiers dans une caisse qu'il fit spécialement à leur intention, pendant que sous les figuiers les robes et les photos s'évanouissaient en fumée.
Il y a vraiment une prédestination dans le destin des choses, comme pour le reste: oiseaux, humains, saphirs... Comment sans cela expliquer que ces lettres revinssent, deux cents ans après, dans le quartier de l'Université d'où la plupart étaient sorties ? De la rue des Beaux-Arts où nous habitions à la rue des Saint-Pères où vécut Emilie de Portocarrero il n'y a qu'une promenade : celle que je faisais presque chaque jour pour jeter mon courrier à la poste. Néanmoins ces lettres mirent très longtemps à me revenir. Je ne les découvris que ces dernières années. Mon père, chaque fois que je les lui demandais, avait quelque "défaite " à m'opposer. Il ne savait plus où il les avait mises. S'il les avait montrées à Martineau ? Il ne s'en souvenait pas... S'il les avait lues? Oui, partiellement (je découvris plus tard qu'il avait essayé de les classer et avait fait des suppositions sur les correspondants). Finalement, déménageant de Paris en 1976, il avait ramené ses livres en de multiples caisses à Labruguière. Chaque caisse avait sa liste soigneusement collée sur son couvercle. De la caisse n° 33, le bois blanc qui renfermait les lettres était devenu brun, mais elles étaient toujours là, soigneusement rangées, avec, dans une enveloppe, un portrait, une miniature sur cuivre qui tient dans le creux de la main. C'est une femme au visage blanc, aux lèvres serrées, au regard perspicace, qui porte une robe bleue et des fleurs dans les cheveux. Est-ce Emilie ? Ou une amie ? Encore jeune, elle a plutôt l'air d'une Italienne que d'une Espagnole ; comme sa mère était anglaise et qu'elle a passé sa vie en France cela ne nous avance pas beaucoup. Avec quarante ans de retard je lus les lettres. On verra de qui elles sont, et comme je le découvris.
Cette correspondance amoureuse avec deux hommes est certainement tout ce qui reste du passage sur cette 5e planète d'une étoile de 3e dimension de la fille naturelle d'un Grand d'Espagne, qui après bien des aventures et des faillites, vint échouer dans ce coin de Languedoc pour y mourir, en pleine Révolution. Le tout pourrait s'appeler, comme dans ces titres interminables qu'on donnait aux romans à son époque :
ou la vie et les aventures de Marie-Emillie de Porto-Carrero, fille naturelle non reconnue de Christophe de Porto-Carrero, Comte de Montijo, Grand d'Espagne de Première Classe ; et d'une femme estrangère malgré toutte les recherches demeurée incongneue ; née obscurément à Londres en Angleterre en 1735 et morte à Teyssode paroisse de Languedoc en l'année 1795 (vieux stile) l’an 3 de la Rep. Fr. Une et Indivisible, après avoir recherché toutte sa vie de se faire reconnoitre et estimer
DE SON INGRATTE PARENTé.
*
LE COUVENT DE GISORS,
ET CELUI DES URSULINES DE PONTOISE
A sa sortie du couvent de Gisors, en 1751, une jeune fille de seize ans, Marie-Emilie, ou Emilie, correspond avec les supérieures qu'elle y a laissées : Soeur Saint-Jérôme, mesdames Delalande et Dapremond. Ce sont des Ursulines "filles ou veuves qui se consacrent à l'éducation des jeunes filles". Ces Ursulines possédaient une très belle maison à Paris à l’emplacement de la rue qui a gardé leur nom, dans ce quartier pour moi charmant de Saint-Jacques du Haut-Pas.
Emilie envoie des cadeaux, qui mortifient ces dames ; "Cette preuve de votre bon coeur n'étoit nulement nécessaire vis-à-vis de moi, ma chère amie". Certaines de ces soeurs sont très âgées : deux meurent, en cet octobre 1751, à plus de 80 ans. Une des condisciples d'Emilie, Mlle Gromaire, "a été mariée ce mois d'août, elle est partie aussitôt à la terre de son mari, qui est en Bourgogne". En fait on a l'impression que la seule famille réelle de Marie-Emilie ce sont, justement, ses relations de couvent ; les bonnes soeurs qui l'ont élevée et qui lui écrivent avec une tendresse maternelle, s'occupant beaucoup de sa vie spirituelle, de ses soucis, et d'une difficile entrée dans la vie. Marie-Emilie ne sait pas elle-même qui elle est. Fille naturelle, plus ou moins abandonnée dans cette institution pieuse ? Bâtarde d'un grand ? C'est possible. Comme elle cherche à s'en éclaircir, soeur Saint-Jérôme proteste de son ignorance : "Je voudrais, chère amie, être assez heureuse pour pouvoir vous mettre au fait de ce que vous désirez savoir ; il y a longtemps que vous seriez satisfaite, mais je suis aussi ignorante que toutes celles de notre maison. Il n'y a que la demoiselle qui vous a placé içi qui en sait quelque chose ; je ne la vois point, et ce serait en vain que je ferais effort pour lui arracher le secret : ses amies l'ont tenté plus d'une fois inutilement. Il faut attendre avec patience quelque événement qui vous éclairera. Le Seigneur n'attend peut-être qu'un acte de conformité à sa volonté pour vous accorder ce que vous souhaitez le plus..." (12 novembre 1751). La jeune fille se désespère et dépérit : « Je suis inquiète extrêmement du peu que vous mangez, ce qui me surprend, ayant toujours été d'assez bon appétit, celà fait grand tort à votre tempérament et contribue en partie à votre maigreur. » Soeur Saint-Jérôme - qui semble avoir été elle aussi une fille abandonnée - lui reproche les inquiétudes et les peines auxquelles elle se livre : "Trouvez bon ma chère amie que je vous dise que je vous trouve condamnable de n'avoir pas plus de soumission à la Divine Providence, qui vous a secourue dans les plus fâcheuses circonstances, ce qui devrait vous inspirer une confiance sans bornes" ; elle lui en donne pour preuve "l'ami solide et essentiel qu'elle (la Providence) vous a procuré en la personne de M. de Flobert."
Qui est M. de Flobert ? (Qui se prénomme Antoine). D'après la seule lettre adressée à lui, il est en 1757 Directeur Général des Fortifications de la République de Gênes. Nous voilà en plein dans cette Europe cultivée et cosmopolite du XVIIIe siècle qu'ont tuée les nationalismes brutaux et bornés issus de la Révolution. Cet officier français au service d'une république italienne, c'est toute une civilisation. M. Antoine de Flobert devait être à Gênes depuis un moment. C'est en 1746 que Louis XV envoie des secours à cette belle ville révoltée contre les Autrichiens. Le 21 mai 1747, le duc de Boufflers les y attaque et s'empare de leurs positions ; le 27, ils sont chassés de toute la côte. En 1748, une opération du duc de Richelieu réussit complètement : Varragio est attaquée et prise en février. La même année, le traité d'Aix-la-Chapelle termine la guerre.
Que va faire en 1757 M. de Flobert à Gênes où il était certainement dix ans avant ? De Chamicy, hameau proche de Senlis, en septembre, M. Coqueret, qui a l'air d’être une sorte d'intendant, lui réclame une obligation de 7 000 livres qu'il a faite à M. l'abbé de Crillon, et dont on n'a pu retrouver la minute chez Me Andrieu, notaire parisien... Tous les comptes et lettres de l'époque sont pleins d'histoires d'importants papiers perdus, dont on cherche vainement soit les originaux, soit des copies... M. de Flobert est bien avec le clergé, car par l'honnête M. Coqueret (dont le nom signifie amour en cage, ou à notre époque Lanterne Japonaise : il s'agit tout simplement de l'alkékenge ou Cerise d'Hiver...) il reçoit des nouvelles de divers ecclésiastiques de haut vol : "M. le prieur de Bray se porte bien, et M. le curé de Reuilly. Toutte vos chambre et meuble sont en bonne estât à la réserve de vos couverture, que les vers ont attaqué ; on les a mis à ler [l’air] plusieur jours et toutte sa na servy de rien..." M. l'abbé de Crillon est venu à Chamicy au commencement d'août. "Je l'ai reçu du mieux qu'il m'a été possible. Heureusement qu'il y avait 12 bouteilles de vin que M. le Prieur de Bray avait envoyées quand vous êtes venu à Chamicy la dernière fois ; je lui en présenté une de blanc qu'il a bue ; il l'a trouvé bon. Il a trouvé votre appartement très beau."
M. de Flobert ne doit pas venir souvent à Chamicy puisque les couvertures ont le temps de s'y miter : d'ailleurs la lettre est envoyée de Senlis à Gênes. Pourtant, à l'instar de la mystérieuse demoiselle qui a déposé Marie-Emilie au couvent de Gisors, dès qu'elle en sort il prend la relève et s'occupe d'elle. A-t-il des ordres, peut-être de la famille de Crillon, qui revient souvent en allusion dans la correspondance ? C'est probable. Mais pourquoi a-t-on choisi ce militaire comme bonne d'enfant ? Dès 1753, Marie-Emilie est avec lui à Guérande et se fait appeler Mademoiselle de Robertot. Nom de guerre, on s'en doute. A moins que Robertot n'ait un rapport quelconque avec M. de Flobert, qui y aurait eu une propriété : c'est le nom d'un village de la Seine-Maritime, près de Doudeville.
En octobre de la même année, toujours avec M. de Flobert, la voilà qui loge à l'hôtel du marquis de Crillon, quai des Célestins à Paris, maison bien connue des amoureux qui suivent la Seine, car derrière son rideau d'arbres jaunissant en automne et peuplé d'oiseaux c'est, en face de la caserne des Gardes Républicains, le magnifique Hôtel Fieubet, que touche, justement, un lycée de jeunes filles qui font entendre, aux récréations, comme un bruit de volière...
Arrêtons-nous un instant à l'Hôtel Fieubet pour parler des Crillon qui y ont vécu. Les Fieubet sont des parlementaires des environs de Toulouse dont les papiers ont été malheureusement dispersés à Castres ces dernières années quand la bibliothèque de Gaston Tournier, érudit mazamétain, fut vendue dans les pires conditions. Le patronyme Fieubet ou Fieuzet est encore porté dans la région de Lavaur. Quant aux Crillon ce sont comme on sait des Avignonnais dont la statue de l'ancêtre orna longtemps la Place des Doms. Comment ces gens se retrouvèrent-ils au XVIIIe siècle dans le quartier de l'Arsenal, proche de la Bastille, je ne sais. Louis de Berton, marquis et même duc de Crillon (par la grâce du Pape) né en 1718, a 17 ans de plus qu'Emilie. C'est un militaire. Entré à treize ans aux Mousquetaires Gris, il est à quinze, lieutenant au régiment du Roi-Infanterie. Il se distingue en Italie aux batailles de Parme et de Guastalla et à vingt ans commande le régiment de Bretagne. Raconter sa carrière serait fort long : il suffit de dire qu'à Fontenoy il s'empare de 50 canons et est nommé général d’infanterie. Louis XV lui propose 3000 livres de pension et le cordon rouge de l’Ordre de Saint-Louis, équivalent de notre Légion d'Honneur, mais Crillon refuse : il espérait avoir la décoration suprême, le cordon bleu du Saint-Esprit. Or il ne risque pas de l'avoir : il n’est pas assez noble. On a des échos des préventions des imbéciles titrés envers un vrai talent dans cette note des”Souvenirs de la Marquise de Créquy": "Leur nom de famille est Berton, et leur prétention consiste à être sortis de la famille Balbi, ce qu'ils n'ont jamais pu faire accroire à personne dans leur pays Venaissin. Le fameux Crillon (compagnon d'Henri IV) n'était qu'un soldat de fortune. On a toujours dit que son grand-père était un marchand de Carpentras, et leur titre de duc avignonnais est fondé sur un brevet pontifical. Si on les a laissés s'élever sans crier, c'est qu'on les regardait de si haut et qu'on les voyait de si loin, qu'on n'y prenait pas garde." Toute la fatuité de la Cour est dans de pareilles remarques : prenez toujours 50 canons à Fontenoy et sauvez la France de l'invasion, si votre aïeul était marchand à Carpentras, ça ne vous servira pas à grand chose... Après plusieurs autres humiliations du même genre pendant la Guerre de Sept Ans, au profit de généraux de la Pompadour, Crillon passera au service de Charles III d'Espagne.
Cependant, quand en 1751 Emilie vit dans son hôtel parisien, Crillon est en pleine gloire. Ce sont probablement ses parents qui habitent l'Hôtel Fieubet, mais je ne les connais pas. D'ailleurs Emilie n'eût qu'un temps assez court pour connaître le futur maréchal qui passa sa vie aux armées : à la paix d'Aix-la-Chapelle (1748) il revint à Avignon. En 1751 il y donna des fêtes splendides pour la naissance du duc de Bourgogne. "Il alla féliciter Louis XV de la part des Comtadins et demeura à la Cour de janvier à mars 1752" : c'est pendant cet intervalle qu'Emilie dut le connaître, car ensuite "il se rendit à Rome, où le pape lui fit le meilleur accueil en 1754" (Biographie Française).
Après le duc, l'abbé. Louis-Athanase-Boniface de Berton de Crillon, né en 1726 à Avignon, a huit ans de moins que Crillon-Mahon. Il entra dans les ordres,"s'attacha à son oncle Jean-Louis, archevêque de Toulouse, qui le nomma chanoine de Saint-Sernin, grand vicaire de son diocèse, et qui résigna en sa faveur, en novembre 1750, l'abbaye de Saint Etienne de Baigne" : c'est-à-dire à peu près un an avant la sortie d'Emilie de son couvent. Si on regarde les dates, l'Abbé de Crillon n'est que de neuf ans l'aîné d'Emilie. Ils ont bien du faire connaissance, dans quelque vestibule de l'Hôtel Fieubet... D'autant que cet homme de trente ans est encore mieux renté en 1755: il est nommé Agent Général du Clergé ! La carrière de cadet, presque obligatoirement ecclésiastique, pouvait être extrêmement rentable. C'est celle de l'abbé de Crillon. Promoteur de l'assemblée générale du Clergé, en 1760 (à 34 ans...), abbé de Saint-Jean d'Amiens en juillet de la même année, abbé de Grandselve en 1779 (53 ans...) la vie de l'abbé de Crillon est semée de roses et de bénéfices tous plus ecclésiastiques les uns que les autres. Il ne parait pas avoir souffert dans les missions et n'est nullement candidat au martyre. Ce n'est pas un confesseur de la Foi, mais de belles dames, qui n'ont que des pêchés mignons.
L'abbaye de Grandselve (la Grande Forêt), de l'Ordre de Citeaux, faisait partie du diocèse de Toulouse, et l'abbé de Crillon en est toujours propriétaire à la veille de la Révolution. On verra qu'Emilie, vers la fin de sa vie et dans la panade, fera appel à l'abbé de Crillon : il lui rendra un modeste service, assez utile cependant pour qu'elle passe sans trop de heurts ses dix dernières années.
Quels étaient les rapports de l'Abbé richissime et d'Emilie? Bien malin qui mettra la main sur des documents sérieux, à ce sujet. On trouve dans la correspondance d'Emilie des brouillons de lettres à l'abbé de Crillon, mais pas une lettre de lui. Il devait lui faire tenir des "mots ", par quelque vicaire itinérant : on n'est jamais assez discret, dans le Clergé. Pourtant l’abbé de Crillon ne donne pas l'impression d'un de ces scandaleux prélats de son époque, qui ont causé tant de tort, par ricochet, à la religion. C'est un homme avisé : il se débrouille pour mourir à Avignon, son lieu de naissance, le 26 janvier 1789. On ne saurait être plus prévoyant. L'année en cours et les suivantes lui auraient sans doute fait passer quelques mauvais quarts d'heure. Mais c'est un homme heureux, bien typique de son siècle ; il a su se retirer à temps. Il avait publié, de concert avec l'abbé de Jumilhac, quelques fadaises, dont les"Rapports de l'Agence Générale du Clergé", au titre proprement surréaliste. Il donna ensuite "de l'Homme Moral" (1771) et "Mémoires Philosophiques du baron de... grand chambellan de S.M. l'Impératrice" (1777-1778) deux volumes destinés à convertir les philosophes au catholicisme (1).
Pierre Larousse, dans son Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle rajoute que les "Mémoires Philosophiques du baron de..." dont le titre à sa parution ne devait pas manquer de piquant, car c'est une parodie, est un « livre où sont combattues avec beaucoup de vigueur les doctrines matérialistes du baron d'Holbach, qui a été réimprimé plusieurs fois. "
Voilà pour l'abbé de Crillon. J’ai longtemps cru que les lettres de l’Amoureux Inconnu, qu'on verra plus loin, étaient de lui. Mais non, impossible. Celui-ci vit à la Cour, se dit secrétaire-général des dragons. N'empêche qu'il y a eu entre Emilie et l'abbé de Crillon certainement autre chose que de simples relations de confessionnal. On ne vous accorde pas comme ça des inscriptions sur les rentes du Clergé sans que vous ayez fourni quelques bonnes raisons de votre savoir-faire. Et d'abord qu'était cette Assemblée du Clergé dont il est si souvent question ? Quand l'abbé de Talleyrand-Périgord fut nommé, à son tour et bien plus tard promoteur de l'Assemblée du Clergé de France, à la suite de l'abbé de Crillon, il prendra soin de nous l'expliquer: "J'observai avec soin la manière dont les affaires se conduisaient dans ce grand corps. L'ambition y revêtait toutes les formes. Religion, humanité, patriotisme, philosophie, chacun prenait là une couleur ! L'intervention de la conscience dans tous les démêlés pécuniaires avait donné aux pièces de cette grande affaire un caractère déloquence que le clergé seul sait avoir." L'assemblée du Clergé avait pour principal objet (la grande affaire) de déterminer tous les cinq ans le montant de l'impôt qu’elle "consentait " ou plutôt qu'elle se laissait arracher avec moults gémissements, par le Roi, sous la fiction d’un "don gratuit".
Je ne sais si Talleyrand, qui était si charitable comme on sait, a fait profiter quelques Marie-Madeleine des deniers du clergé. Mais c’est possible. Tout comme est probable le même service rendu, avec les mêmes deniers, par l’abbé de Crillon à Emilie.
__________
(1): Roman d'Amat : Dictionnaire de Biographie Française, Tome 9, p. 1255. Paris, 1961.
SOEUR SAINT-JEROME
Soeur Saint-Jérôme écrit en prenant certaines précautions conventines : elle n'a pas le droit de correspondre avec son ancienne élève, et le fait par l'intermédiaire de Mme Delalande, qui quitte le couvent pour les Dames Hospitalières de Saint-Nicolas de Pontoise : l'Hôtel-Dieu. Mme Delalande met toujours un post-scriptum, d'une grande écriture élégante et aristocratique, qui redouble les conseils de prudence et de soumission à la volonté divine que prodigue la Sœur : "Le Seigneur exige peut-être que vous lui sacrifiéz de certains sentiments qui paraissent bien naturels, celà est, j'en conviens, difficile, et par là d'autant plus méritoire. D'ailleurs il est quelquefois de la prudence de dissimuler, il y a de la grandeur d'âme à oublier, et selon le Christianisme, de pardonner, je comprends tout ce que vous pouvez m'objecter à celà, mais je crois avoir plus que personne grâce à vous parler ainsi par tout ce que j'en ai ressenti.” Soeur Saint-Jérôme, on le voit, a du être dans le même état d'abandon que la jeune fille. "Vous me ferez plaisir de me faire part de votre situation, m'interessant véritablement à votre bonheur" lui écrit Mme Delalande. "Soyez, fidèle à Dieu, et il ne vous abandonnera pas, cette vie est courte et il y a une éternité, mettez à profit l'esprit que vous avez reçu, ce sont de ces talents dont vous rendrez compte, pensez donc ma chère fille à en faire un bon et saint usage, et aimez moi toujours comme je vous aime".
D'ailleurs Emilie ne se tourmente pas toujours pour la recherche de sa parenté et son propre établissement ; elle a quelquefois des occupations plus frivoles : en février 1753 elle demande des échantillons de laine mais soeur Saint-Jérôme ne peut la satisfaire : "l'on n'a point conservé ces nuances et l'on ne travaille plus içi en laines, peut-être par la difficulté d'en avoir. Vous êtes, ma chère amie, beaucoup plus à portée de les choisir et de les assortir ayant votre robe. " La soeur croit prudent de ne pas transmettre les compliments de Marie-Emilie aux dames du couvent, car elle reçoit ces nouvelles d'une voie indirecte : elle en a de temps en temps de Mlle Gromaire, qui a toujours de l'amitié pour elle, mais elle a perdu de vue Mlle Romaine, une autre condisciple de Marie-Emilie.
Soeur Saint-Jérôme témoigne beaucoup de tendresse à la jeune fille, "dans quelque partie du monde que vous habitiez, donnez moi de vos nouvelles, ma chère amie, elles me feront toujours un vrai plaisir... Je serai toujours avec une amitié tendre et sincère votre bonne amie." Si Marie-Emilie n'écrit pas de quelque temps elle s'inquiète, "j'ai trouvé bien long le temps que j'ai été sans recevoir de vos lettres, je craignais de votre part quelque refroidissement." Mme Delalande fait chorus : elle était en peine. Elles lui souhaitent un bonheur solide, une confiance entière en M. de Flobert, elles la félicitent : « Je trouve votre écriture et votre orthographe infiniment meilleures, vous pouvez encore faire mieux. Je voudrais savoir ce que veut dire que vous espérez nous dire de vive voix à ma soeur et à moi ? Combien vous nous aimez ? Quels seraient donc vos projets en revenant dans ce pays ? Cette question n'est que pour votre bonheur..." Il paraîtrait donc que M. de Flobert aurait découvert à sa pupille une partie de la vérité : qu'elle est la fille naturelle d'un Grand d'Espagne, née à Londres. Avec son caractère romanesque, elle a immédiatement décidé d'aller se faire reconnaître.
Ces histoires de filles abandonnées, le XVIIIe siècle en est plein, à tel point que c'était devenu un poncif de théâtre, où l'enfant, dans des circonstances éminemment dramatiques et après bien des infortunes, était découvert et reconnu au dernier acte grâce à la croix (d'or, évidemment) que sa pauvre mère avait eu la bonne idée de lui passer au cou. « Elle a la croix de sa mère », cela se disait pour désigner quelqu'un qui avait de la chance. D'autres fois, c'était une marque sur le corps, indélébile, généralement en forme de blason, afin que nul n'en ignore. Sans rechercher dans le fatras littéraire, on trouve les histoires bien réelles de la fameuse comtesse de La Mothe, du sang des Valois, qui se rendit célèbre dans l'escroquerie du Collier de la Reine ; celle moins connue de la comtesse de Montcairzain, qui passa sa vie à essayer de se faire reconnaître de la famille de Conti, d'où elle prétendait descendre (1). Ces deux-là eurent des destinées tragiques, ou décevantes. Toutes ne le furent pas. Mlle de Folleville, fille naturelle du Prince de Salm et de la Duchesse de Bouillon, en épousant Vitrolles, petit émigré inconnu dont elle était tombée amoureuse, porta visiblement bonheur au futur ministre de Louis XVIII dont elle fut le premier grand succès. Un bienfait n'est jamais perdu…
_______________
(1) : A propos de la Montcairzin, G. Lenotre, citant un "Annuaire du Jura" (Vieilles Maisons, Vieux Papiers, 4e série) et peu soucieux de vérifier aux bons endroits, termine son article de fort romantique façon : "On croit qu'elle mourut en 1825, de faim ou de froid au pied d'une borne, en face des Tuileries." Voilà qui est symbolique à l'extrême, cette enfant d'un sang royal contesté qui vient mourir, en pleine Restauration, comme un reproche vivant, devant la somptueuse demeure de ses parents ingrats... De quoi faire pleurer tous les mélodrames du Boulevard du Crime ! Mais il n'en est rien. La Montcairzain ne mourut probablement ni de froid, ni de faim. Elle avait même eu le temps de se préparer une dalle cossue "tout en haut du Père-Lachaise, à Ménilmontant", comme eût chanté Bruant. C'est même non loin du rond-point Casimir-Périer, rendez-vous des élégances d'outre-tombe, qu'elle a choisi de reposer. Si elle avait eu faim et froid elle aurait mangé les sous de sa pierre tombale ! On y lit : "Cette princesse a préparé elle-même ce tombeau pour y trouver enfin le seul bonheur durable sur lequel on puisse compter, et où l'injustice et les persécutions qu'on éprouve sur la terre ne puissent plus atteindre. " L'inscription a été relevée dans l'intéressant roman de Jean Escande : Du Flouze (Ed. du Seuil, 1958).
Autre enfant trouvé, qu'on ne peut guère prendre au sérieux : Chamfort. Né en 1741, il n'a que quatre ans de moins qu'Emilie. Joli petit-maître, les dames lui ont décerné un brevet de capacité amoureuse : elles l’appellent Hercule-Adonis. (Comme elles savent faire, en ridiculisant). Mais Hercule-Adonis se prend pour un Romain, un Caton (celui qui voulait brûler Carthage), un caractère, un dur. Entendons-nous : un dur pour une société en pâte tendre, celle des duchesses à vapeurs. Il est à peu près aussi terrifiant qu'une statuette en porcelaine de Sèvres. C'est le Misanthrope en culotte de soie rose et redingote de faille vert d'eau. Ce moraliste professionnel est invité aux petits soupers de la meilleure société pour y faire frissonner les caillettes d'aphorismes définitifs. En bon bâtard d'un manant auvergnat, il se conforme parfaitement à son rôle et crache dans la soupière en Pont-aux-Choux en débitant du nihilisme à bon marché.
Hercule-Adonis accepte à toutes mains les bénéfices confortables, quitte à insulter longuement ceux qui les lui ont procurés. Les marquises à bascule sont ravies : voilà enfin un homme vrai. Marie-Antoinette elle-même obtient à notre Romain de verre filé une bonne pension, et prend la peine de la lui annoncer elle-même. Bref, tout comme un tupamaro du XVIe arrondissement, fils d'énarque et protégé par une quelconque présidente de la République, Chamfort vit dans les délices de la contestation chic. De nos jours, il fomenterait, entre deux jets, des révolutions marxistes au Paraguay avant de revenir prendre son petit déjeuner rue de la Faisanderie, servi par une négresse soumise, sa vieille nounou. L'esprit en plus (car il a de l'esprit), Chamfort est un soixante-huitard en Lamborghini.
Quand vint la vraie révolution, avec ses vrais terroristes bien horribles, le révolutionnaire en peau de lapin a la trouille : il ne veut pas qu'on le guillotine. Il n'aurait jamais cru MM. Robespierre et Marat si mal élevés. Il essaie de se suicider, mais comme c'est un lâche, il se rate deux ou trois fois. Hercule-Adonis n'a laissé qu'un petit recueil d'anecdotes, précieux pour l'histoire des hautes classes au XVIIIe s. : la seule humanité qu'ait fréquenté M. Chamfort. C'est un excellent échotier du genre putassier, comme sous le Second Empire le gommeux Viel-Castel. A force de cracher dans la soupe, Chamfort, l'académicien, a tout raté, même sa mort. De nos jours, il serait Ministre de la Culture.
Evidemment, le sort des enfants trouvés était hasardeux et complètement abandonné à la fortune, bonne ou mauvaise. On ne songe jamais aux milliers de bâtards qui au cours de l'histoire ont fini misérablement, gelés nuitamment sur les marches d'églises. Marie-Emilie, qui s'appelle provisoirement Mlle de Robertot, peut se féliciter de son sort : un couvent, un tuteur... Elle prend des habitudes qui feront d'elle une de ces assistées qui vivent en marge du grand monde sans vraiment en faire partie mais qu'on tolère comme plus ou moins de la famille. Sans travail (c'est une aristocrate) mais pas sans soucis, les besoins d'argent la dévorent. Pas vraiment femme entretenue, mais pas mariée non plus, parce que sans dot... Un de ces êtres ambigus comme on en trouvait beaucoup autour des tables de jeu, aux chasses, dans les villes d'eau, près des grands, inutiles et à moitié déplacés. Toutes ces conditions feront d'elle pour la vie, une errante.
Outre les dérangements que donnent ses soucis et ses inquiétudes à sa santé, en novembre 1753, à 18 ans, Marie-Emilie a le malheur d'être attaquée de la petite vérole. Mme Delalande remercie M. de Flobert : "des nouvelles que vous avez la bonté de me donner de notre demoiselle, dont j'étais très en peine. Je suis fort charmée qu'elle se soit tirée heureusement de la petite vérole dont tout le monde périt cette année. Je ne puis, Monsieur, vous exprimer la joie que je ressens du contentement où vous me dites être de sa bonne conduite ; j'en bénis le ciel et je désire son bonheur de tout mon coeur. Cette chère enfant a de l'esprit et un coeur admirable ; il y a bien de la ressource avec de pareilles qualités, soutenues de la religion. J'espère, Monsieur, qu'elle reconnaîtra toute sa vie les bontés et les tendres soins que vous prenez pour elle, dont elle me parait bien touchée, et dont j'ose vous demander la continuation par l'intérêt infini que j'y prends en l'embrassant bien tendrement..."
Soeur Saint-Jérôme : "Dès que j'ai entendu parler des ravages que faisait cet été la petite vérole, je n'ai cessé d'invoquer Saint Roch pour que vous en fussiez préservée, ou du moins des tristes et fâcheux accidents qui souvent en restent…" Cette lettre de Janvier 1754 a été renvoyée de l'Hôtel Fieubet à Londres, chez l'Ambassadeur d'Espagne - on peut penser que M. de Flobert s'y est rendu pour affaires. Mais il ne parait pas que Marie-Emilie l'y ait accompagné : en août de la même année, ses amies lui écrivent : elle est pensionnaire aux Filles de la Croix, rue d'Orléans à Paris. On lui donne du "Madame”, mais le nom a été soigneusement barré. Soeur Saint-Jérôme craint "qu'elle ne fut malade, ou, ce qui est en partie vrai, dans quelque endroit ou vous n'eussiez point la liberté de me donner de vos nouvelles." La voilà donc dans un autre couvent. Soeur Saint-Jérôme trouve que les meilleurs conseils que ces dames puissent lui donner "est de vous exhorter à la patience : c'est le seul parti que vous ayes à prendre pour vous concilier la bienveillance d'un quelqu'un à qui vous convenez avoir beaucoup d'obligation, dont par votre bonne conduite vous avez déjà mérité les louanges, et de qui les bontés et la protection vous sont si nécessaires. Je vous exhorte donc, ma chère fille, à temporiser, ce ne sera que par votre soumission que vous parviendrez à ce que vous désirez, autrement vous gâteriez tout, et vous ruineriez totalement vos affaires au lieu de les avancer. Peut-être que ce qui vous parait en ce moment rigueur ou humeur est dirigé pour votre plus grand bien. Le temps peut apporter un grand changement à votre fortune..." "Surtout soyez réservée avec tout le monde sur vos affaires et votre situation : tout dépend de votre prudence sur ce point ; pensez toujours qu'il n'est rien de plus rare qu'un ami solide et véritable" lui recommande Mme Delalande, faisant allusion à M. de Flobert.
Par précaution, Soeur Saint-Jérôme brûle toutes les lettres que lui envoie Marie-Emilie. En 1755, celle-ci va avoir vingt ans et son moral ne s'améliore pas. Soeur Saint-Jérôme a beau la féliciter "sur le précieux et solide ami que la Providence vous a donné en la personne de M. de Flobert" rien n'y fait : elle l'exhorte pourtant "à tout employer pour vous le conserver et vous le ménager. Il a la bonté, me disiez-vous, d'excuser vos vivacités lorsqu 'il vous arrivait d'en avoir. Ne soyez pas pour vous-même si indulgente, ne vous les pardonnez point ; ce qui peut vous en occasionner, ou du moins vous empêcher de travailler à les réprimer est le désir trop vif que vous avez de connaître ce que l'on vous cache. Vous voulez bien que je doute de votre soumission à la volonté de Dieu à cet égard, puisque vous avouez, chère amie, que cette pensée ne vous laisse de repos ni jour ni nuit. Celà ruine votre tempérament, n'avance rien, et vous fait perdre peut-être beaucoup de mérites et de grâce auprès du Seigneur qui attend et exige de votre part une résignation plus entière pour remplir votre désir, que je ne blâme point en soi, mais en ce qu'il est trop excessif…" Elle la dissuade de venir la voir à Gisors : cette démarche "ne serait point du goût des personnes que vous désirez tant de connaître : je ne puis m'ôter de l'esprit qu'elles surveillent votre conduite, vous ne pouvez en tenir une trop mesurée à tous égards" écrit soeur Saint-Jérôme qui parait en savoir plus qu'elle ne le montre. "Je serais désespérée que ce qui ne serait que pour ma satisfaction put vous faire tort ; il viendra peut-être un temps plus favorable...” Mme Delalande a du chagrin : "J'avais écrit à M. de Flobert la douleur sans égale où j'ai été et où je suis encore du départ de ma chère petite nièce." On va la changer de maison, et elle sera logée de façon à ne pouvoir l'inviter : elle voulait profiter des derniers jours qui lui restaient à Pontoise pour les prier à dîner, lui et elle : "nous n'aurions été que nous trois pour jaser à notre aise" mais M. de Flobert, vrai ou faux, « m'a mandé que vous étiez incommodée et que vous ne pouviez sortir" : on dirait que le sort, ou les humains, empêchent Marie-Emilie de revoir les femmes qui l'ont élevée et qui peut-être en savent trop.
En mars 1755, soeur Saint-Jérôme l'engage à se ménager, car elle a vraiment été malade, à manger davantage et à distraire son esprit. "Celà n'est point aisé, j'en conviens, mais enfin le chagrin auquel vous vous livrez, ma chère enfant, ne change rien à votre sort, ruine votre tempérament et m'afflige..." Si M. de Flobert ne vous accorde point ce que vous voulez bien souhaiter, avec tant d'empressement, ce ne sera sûrement que des vues de prudence qui l'arrêteront, peut-être les mêmes que je vous ai représentées la dernière fois." Elle a elle-même ses déboires : "Ma soeur est venue vendredi faire une apparition par un temps affreux, c'était pour m'enlever les chères petites, auxquelles j'étais fort attachée, de façon que je m'en ennuie beaucoup. Elles ont infiniment d'esprit, amusantes et l'aînée a déjà du solide. Dans peu elle sera compagnie pour la chère tante, qui est toujours bien touchée de la séparation de Mme Delalande, et moi de son éloignement."
En avril, Marie-Emilie a encore changé d'adresse : elle est avec M. de Flobert chez M. Hüare, perruquier rue de l'Echelle, quartier Saint-Roch à Paris. La rue existe toujours. De Gisors, soeur Saint-Jérôme lui écrit sa dernière lettre : elle est navrée de la voir encore malade."Vous ne sauriez user de trop de précautions et de ménagement et ne rien vous permettre qui puisse déranger votre santé. J'applaudis à votre résolution de vous priver de tout ce qui n'est que pour satisfaire le goût ; il faut tacher de vous former un bon tempérament en mangeant davantage et toujours des choses solides et saines. Je suis charmée de votre nouvelle demeure, puisque vous y goûtez quelques satisfactions. Je souhaite toujours beaucoup de vous savoir au fait et instruite de ce qui fait votre tourment." Elle l'exhorte à la patience et à la soumission, qui doit être le fruit d'une retraite que projette Marie-Emilie, puis elle disparaît et on ne retrouve plus sa signature. Peut-être cette femme, qui lui a servi de mère, est-elle morte dans l'intervalle.

En 1757, voilà Emilie, par un coup de baguette magique, devenue Madame de Saurin. Elle a 22 ans et habite rue des Saints-Pères, la porte cochère à côté de la Charité, au faubourg Saint Germain, où, selon d’autres suscriptions de lettres : la porte cochère vis-à-vis la croix du cimetière de la Charité. L'immeuble n'existe plus. Il était à l'emplacement de la nouvelle Faculté de Médecine, qui a remplacé l'hôpital de la Charité, peu avant 1939. Le cimetière de l'hôpital était sensiblement à l'emplacement de la chocolaterie Debauve et Gallais ; de ses fenêtres Emilie devait voir le bout de la rue Saint-Guillaume, actuelle rue Peyronnet. Elle habite ce faubourg Saint-Germain où vécut, jusqu'au début du XXe siècle, l'aristocratie. C'est le noble faubourg. Rien que dans la rue des Saints-Pères, on compte à l'époque d'Emilie le maréchal de Téssé, le duc de Cossé-Brissac, les Saint-Simon. Au coin de la rue de l'Université la comtesse de Montmorency-Laval et sa mère la marquise de la Roche-Gensac, toulousaines, viendront s'installer en 1772. Pas une maison des rues de Bourbon (aujourd'hui de Lille), Jacob, Verneuil, Saint-Guillaume, de la Chaise, de Grenelle, qui ne renferme quelque famille noble. Notre héroïne ne va pas quitter comme cela un quartier qui est à lui seul une carte de visite. D'autant que le Paris de l’époque est aussi compartimenté que le nôtre, et que le fait d'habiter le noble faubourg même à un cinquième étage sous les toits, vous a une autre allure qu'un appartement rue du Moulin-Vert au Petit-Montrouge.
Je n'aurais pas pensé, quand j’allais dans mon enfance entre 1940 et 1943, acheter du faux chocolat blanc avec de vrais tickets chez Debauve et Gallais ("Fournisseurs des anciens Rois de France") que je me liais ainsi inconsciemment avec les âmes d'anciennes habitantes de mon quartier, qui me forceraient un jour, en me faisant trouver leurs lettres, à raconter leur histoire. Mes soeurs Denise et Josette allaient à la petite école de la rue Peyronnet, tenue par des religieuses, dont le parloir s'ornait d'une magnifique maison de poupées, avec tous ses appartements, bien propre à faire rêver les petites filles. La Faculté de Médecine, dont la guerre avait interrompu les travaux, dressait des escaliers de béton inachevés sous un ciel de neige, derrière des palissades qu'arrachaient pour se chauffer les habitants du quartier, peu soucieux des affiches nazies qui les recouvraient : tout le monde crevait de froid, pendant ces hivers affreux de l'Occupation.
Comme Emilie veut paraître, elle habite donc le faubourg Saint-Germain, tout comme elle se fait appeler Madame de Saurin, on ne sait à quel titre. Pourquoi ce nom, alors que rien n'indique qu'elle soit mariée ? Je n'ai jamais trouvé trace, dans sa correspondance, de ce Monsieur de Saurin dont elle s'affuble : peut-être n'existe-t-il que dans son imagination, ou est-ce un mariage blanc ? A l'époque, il y a bien un Bernard-Joseph Saurin, poète dramatique et académicien, mais il est plus vieux de trente ans qu'Emilie, et pas noble. De même les amis et voisins de palier d'Emilie rue des Saints-Pères ne sauraient faire illusion à des Altesses : Madame Dalmés, M. et Mme de Nerel sentent la bonne noblesse, sans plus. Ce sont des gens d'état intermédiaire : M. de Nerel, par exemple, garde l'hôtel particulier puis la maison de campagne, Montjoli, du Baron de Bennes, autrement argenté. C'est une espèce d'intendant, un peu au-dessus de sa fonction par sa condition.
Marie-Emilie, ou Madame de Saurin, fréquente une société huppée qui, si elle n'est pas le monde de la Cour, où elle ne peut évidemment prétendre, n'ayant ni rang social ni, et pour cause, preuves de noblesse suffisantes, en est pourtant fort proche. Elle est jolie fille et on le lui dit. Si l'on en croit la miniature sur cuivre jointe à ses papiers, qui représente une femme dans la trentaine et qui est peut-être son portrait - à moins que ce ne soit celui d'une des nombreuses Altesses qu'elle approche -, elle a la peau très blanche, un sourire fin et engageant, des yeux singulièrement perspicaces. Couronnée de fleurs et en robe bleue, elle a d'ailleurs plutôt le physique d'une actrice italienne que d'une aristocrate espagnole, le portrait rappelant de façon assez flagrante les pastels de Rosalba Camera. D'après ce qu'on peut voir de son caractère à travers les lettres qu'elle a laissées et ce qui en transparaît dans la volumineuse correspondance qui lui est adressée, c'est une intrigante, retorse, surtout accrocheuse et tenace. Une histoire de revendication de succession en 1768 à l'Ile de Curaçao, que nous rapporterons en son temps, est révélatrice du caractère accrocheur et rêveur à la fois d'Emilie. Son seul but dans la vie est de se faire reconnaître par sa famille espagnole et de se faire verser une pension substancielle. Tous les doutes, tous les émois, les espérances et les ennuis que lui procure sa situation en porte-à-faux dès le couvent de Gisors la poursuivront jusqu'à la fin. Pour cela, elle a besoin de relations, d'appuis et saura s'en créer, car elle est combative, à sa manière insinuante. Elle plaît aux hommes, c'est certain, et elle se servira de cette arme, car à partir de l'année 1757 la majorité des lettres à elle adressées sont masculines. Presque toutes pour lui rendre service, ou offrir des services.
Elle a touché au coeur un homme, certainement plus âgé qu'elle, qui lui sert à la fois de père, d'amant et surtout d'ami. Où qu'il soit il lui envoie de courts billets sans date ni signature. Craint-il de se compromettre en se déclarant ?
L'Amoureux Inconnu est quelqu'un de l'entourage du duc de Coigny. Or les Coigny sont des gens très en cour. Depuis 1748, le duc, ami intime de Louis XV, est gouverneur de Choisy, où se rend presque chaque semaine le roi. L'Amoureux s'est d'ailleurs fait construire à Choisy même un hermitage, où il attend le passage de l'Emilie adorée pour lui offrir, selon sa propre expression "un bouquet et une salade". De temps à autre, l'Amoureux laisse échapper quelque détail : c'est un courtisan, attaché à de grands seigneurs, secrétaire-général des dragons, alors que le duc de Coigny est Mestre-de-Camp général de cette arme. Il négocie d'importants mariages. Il a fait la guerre et est connu de maréchaux français, de princes allemands qui lui font des grâces quand ils le rencontrent, ce qui le comble d'aise. Il assiste au lever du roi et se rend à ses châteaux particuliers : Choisy, Marly. Il fait partie du cercle restreint qui entoure Louis XV, tout le monde n'étant pas invité à ces demeures privées. Il fréquente des diplomates suédois et espagnols, dîne avec eux chez Madame Geoffrin. Ses devoirs militaires n'ont pas l'air de le trop tourmenter et il ne se rend qu'à regret aux Camps de Compiègne, qui sont à Louis XV ce que le Camp de Chalons sera à Napoléon III.
L'Amoureux s'occupe, à la satisfaction générale, du mariage du frère du duc, en mars 1767. Gabriel-Augustin de Franquetot comte de Coigny, qui a 27 ans, épouse Anne-Josèphe-Michel de Roissy, petite-fille de Madame de Villette. Mademoiselle de Roissy est "médiocrement née, mais largement dotée", ce qui vaut beaucoup mieux dans un milieu où tout le monde est très largement né. Ces Coigny inconnus de nos jours sont les parents d'Aimée de Coigny, la "Jeune Captive" immortalisée par André Chénier. Or Mlle de Roissy, comtesse de Coigny, ne resta mariée que huit ans : elle mourut en 1775. Après la mort de sa mère, la petite Aimée, que connut bien évidemment notre Amoureux, fut élevée par la princesse de Guéménée, maîtresse de son père. Puis, après la faillite retentissante des Guéménée, elle fut mise au château de Vigny, près de Pontoise, celui-là même qu'habite le Père Yvel, correspondant d'Emilie. On voit bien qu'il s'agit, dans les mêmes lieux, de la même société. Aimée de Coigny fut mariée à quinze ans (décembre 1784) au duc de Fleury... à Choisy. Mais, à cette date, Emilie est à Viterbe, près de Lavaur, en Languedoc.
Bien plus tard, on retrouve le comte de Coigny : en émigration. "Etabli à Pise avec la charmante duchesse de Fleury, sa fille, il vient faire une visite de courtisan à M. le comte d'Artois et retourne promptement dans la Toscane. La place d'un chevalier d'honneur de Madame Elizabeth ne serait-elle pas en cette circonstance auprès de cette respectable princesse ?" écrit en novembre 1790 le marquis d'Espinchal, qui, lui, se baguenaude à Turin mais ne tolère pas que les autres en fassent autant. Madame Elizabeth finira comme on sait sur l'échafaud. Aimée de Coigny ira en prison et mènera une vie aventureuse, quant au comte son père, émigré en Angleterre, il fait partie du comité de secours aux émigrés.
Mais remontons le cours du temps, et revenons à nos moutons. Le duc de Coigny, premier Ecuyer du Roi, quand il ne loge pas à Choisy, veut que l'Amoureux Inconnu prenne pension chez lui, à l'Hôtel de Coigny, rue Coq-Héron, à Paris (9 avril 1769). Il est à Choisy le 1er juin pour recevoir le prince héréditaire de Prusse, qui n'est autre que le futur Duc de Brunswick, auteur du célèbre Manifeste imbécile qui souleva comme un seul homme la France en 1792. Bref le futur vaincu de Valmy. Né en 1735 comme Emilie, il n'a cette année 1769 que 34 ans. Général en chef des Prussiens en 1806, et encore une fois vaincu, les balles françaises des troupes de Davout termineront sa carrière à Auerstaedt.
Le duc de Coigny, François-Henri, né le 28 mars 1737, passera pour un des favoris de Marie-Antoinette et sera avec Lauzun, Besenval et autres snobinets, un des bellâtres de la petite bande de la reine. "Ce n'est pas un très bel homme, pas un homme de beaucoup d'esprit. Il avait mieux que cela : un excellent maintien, un ton exquis, une belle tournure, une raison simple et juste, du calme et de la politesse... Aimé de tout le monde, le duc de Coigny ne haïssait personne" écrit un autre snobinet et tricheur professionnel, le comte de Tilly. Bref, les qualités d'une bergère, estampillée d'époque. Ou d'un sopha.
Des lettres de l'amoureux d'Emilie se dégage un portrait moral qui n'est pas désagréable. Le ton est mesuré, élégant, les sentiments tendres, quoique sans grande énergie. A certains moments on est surpris par le style, qui pourrait être d'un ecclésiastique. En fait, l’Amoureux est un sceptique. C'est un courtisan, nous l'avons vu, déjà âgé, sans doute de la génération du roi et du duc de Coigny : il parait, à part quelques phrases gentiment osées, avoir plutôt éprouvé pour Emilie de tendres sentiments paternels, et non pas une de ces passions dévorantes qui vous font pousser des soupirs à faire envoler les feuillets illisibles de la Nouvelle Héloïse. Soumis aux lubies de sa maîtresse errante, il paie de ses deniers la location de différents appartements inutiles où elle fait loger une servante, Antonia, et un chien hargneux, Moretto, qui ne lui sont pas d'un grand secours. Pendant des années elle court l'Espagne, et notre amoureux lui écrit, avec la même régularité dans le sentiment que dans le départ de la poste. Il risque bien quelques réflexions (sensées) sur la conduite d'un ménage qui coûte fort cher inutilement (le loyer des appartements parisiens est hors de prix, surtout faubourg Saint-Germain) et ne sert à rien puisqu'elle galope dans les sierras, mais finalement il tombe toujours d'accord sur tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle fait est bien fait. Recule-t-elle d'année en année son retour à Paris ? C'est excellent comme cela. Lui se contente de baiser la papatte à Fils-Fils et d'assurer Moretto, ce roquet grognon et ridicule, de ses respects empressés.
Emilie pouvait-elle compter sérieusement sur un tel partenaire ? Il n’y parait pas. Il est beaucoup trop attaché à son ermitage de Choisy, petits-levers royaux, à cette vie futile, vide et irresponsable que Louis XIV avait su imposer, pour la châtrer définitivement, à la noblesse. Vivant dans un milieu de quémandeurs et d'assistés, l'Amoureux comprend très bien qu'Emilie tâche elle aussi de se faire reconnaître de sa famille espagnole pour en tirer quelque prébende : c'est dans l'ordre des choses. Il l'y encourage vivement, de la voix et du geste. C'est sûrement lui qui lui a fait ouvrir les portes des ambassadeurs, des financiers qui pourront l'épauler de leur crédit, de leurs prêts. Là s'arrête son influence. A part payer ses loyers, il ne peut lui être que d'un secours assez faible : acheter des rubans, faire confectionner des paquets gracieusement noués. Dans plusieurs lettres il proteste de son impuissance : son appartement est trop petit, il vit chez les autres... Drôlerie du destin, cet aimable égoïste, qui hait le conjungo, s'occupe de mariages : pourtant, rien ne lui parait plus enviable que le célibat, on le voit à ses réflexions au moment du mariage d'Antonia : "elle va faire une folie... c'est à dire un lien conjugal. " Il n'est guère embarrassé non plus par l'idée de contraception : autant vaut un infanticide qu'une vie”souillée" c'est à dire avec un enfant naturel sur les bras. Certaine lettre là-dessus est explicite : telle dame a été ”embarrassée", qu'Emilie y prenne garde et ne se mette pas en cette fâcheuse posture, qui réclame par la suite des soins infinis...
Guère jaloux, donc, notre Amoureux, qui semble avoir fait la part des choses et ne se met pas martel en tête pour savoir ce que fait notre amie dans son alcôve. On apprend à un moment que notre amie a été amoureuse d'un Suédois, et que ce Syllog n'a pas voulu d'elle (1). L'Amoureux la console. Elle trouvera mieux la prochaine fois. Les Suédois sont très surfaits. Ils sont pourtant bien portés, en cette fin de siècle : Marie-Antoinette a un penchant pour Fersen, Mlle Necker épouse le baron de Staël, dont elle sera bien la seule à illustrer le nom ; on voit là aussi qu'Emilie a devancé la mode.
_________________
(1) : Voir Le Voyage en Absurdie, où le caractère des Suédois est très bien décrit.
Et le mariage, dira-t-on ? Son Amoureux Inconnu n'aurait-il pu l'épouser, ne fut-ce que pour la mettre à l'abri ? Vous n'y pensez pas. Au XVIIIe siècle comme de nos jours, le mariage est une idée incongrue, farfelue, pas possible, dont le seul énoncé fait éclater l'hilarité. Le mariage est une institution républicaine sourcilleuse, ennuyeuse, rébarbative, où de malheureux infirmes, aveuglés par des lois écrasantes, avancent en pantelant pendant des trente, quarante ans de fidélité forcée... Et sous des prétextes de sentiments encore ! Comme si ces choses-là existaient... On sait bien, depuis Chamfort et d'ailleurs on ne l'avait pas attendu pour s'en apercevoir, que l'amour n'est que le contact de deux épidermes. Dans la société royale ou aristocratique, ce qui est tout comme, ou dans notre société permissive, le mariage est une vieille baliverne, une croquignole... Louis XV change plus souvent de maîtresses que de chemises, et toute la cour l'imite, à tel point que les recherches des historiens en sont terriblement compliquées : Mme A est bien l'épouse de Monsieur A, mais en fait si vous voulez la trouver, c'est chez Monsieur B, tandis que Monsieur A, lui, est l'amant comblé de Madame C, et de mesdemoiselles D, E, F... Les gens qui ont fait un solide mariage, comme le Grand Dauphin, fils du Roi, et sa femme Marie-Josèphe de Saxe, étonnent tout le monde.
Le reste des lettres de l'Amoureux est à l'avenant : de l'eau bénite de cour. Toujours mêmes sentiments fades et renchéris: "Je n'oublierai rien... Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir... Je ne négligerai rien..." Il est si prudent qu'il ne signe jamais ses lettres et, bien entendu, pas le moindre geste positif du genre :" Venez, j'ai peu de bien, mais nous le partagerons, mon logement sera toujours assez grand pour deux. " Bref de ces choses qu'il n'est pas besoin d'être d'un siècle particulier pour les comprendre, surtout quand on est femme. Par contre, beaucoup de mines vis-à-vis de Moretto, dit Toto, dit le Père au Fils - encore que cette allusion à la Sainte Trinité, à propos de chiens, paraisse une plaisanterie typiquement ecclésiastique. C'est vraiment ce qu'on peut espérer de mieux dans ce monde d'eunuques et d'intrigantes qu'est la bonne société pourrissante de la fin du siècle. "On voit des filles fatiguées, lasses..." écrit Mercier : on croirait entendre Maupassant ou tel naturaliste parler du monde des cocottes, vers 1880. Avec ses travestis, ses "amphibies", ses joueurs, ses pédérastes et ses lesbiennes, sa veulerie complaisamment étalée, le XVIIIe finissant ressemble beaucoup au XIXe finissant, à la fin du XXe...
A se demander si la fin de chaque siècle, à l'intérieur de notre civilisation, ne marque pas une lassitude, un affaiblissement, une pourriture qu'une gigantesque révolution ou une guerre mondiale viennent régulièrement balayer. Comme si chaque cent ans de nouvelles générations vigoureuses se levaient, croissaient, combattaient, s'épanouissaient pour finalement s'étioler, crever et disparaître dans des catastrophes.
A vrai dire, l’Amoureux est le type accompli du sigisbée, institution féminine que la pilule contraceptive a définitivement fait disparaître. Le sigisbée était un homme, amoureux d'une femme mariée, qui dans la société italienne de l'époque, l'accompagnait, lui rendait mille services sans que le mari put s'en offusquer. Sans qu'il la touchât, aussi, parait-il. Dans un tableau de Tiepolo vers 1785, conservé à la Ca'Rezzonico de Venise, on peut voir un couple à sigisbée dans toute sa gloire. Au milieu, la dame, en robe jaune à paniers, coiffée d'un énorme bonnet blanc à noeud bleu et vue de dos, ressemble à quelque toupie géométrique : elle est le point central d'une machine célibataire qui donne le bras, orné d'engageantes jaunes, d'une part à son mari, en redingote rouge, catogan et bas blancs, et de l’autre à son sigisbée, en chapeau bicorne, qui se détourne vers nous pour qu’on le voie bien : "Suis-je bien comme ça?" semble nous dire cet heureux homme. Un lévrier efflanqué suit le mouvement du groupe et un vil valet marche, porteur d'un second chien indispensable.
On imagine l'étonnement de nos jeunes femmes : un sigisbée! Alors qu'il est si facile de faire grimper cinq ou six copains à la fois dans son plumard, après avoir fumé un petit joint ! C'est qu'elles oublient, les ingrates, les progrès bienfaisants qu'a faits à notre époque la contraception. Les humains ne sont vertueux que par force : ils n'ont été écologistes pendant des millénaires que parce qu'ils n'avaient pas inventé la pelle mécanique et la bombe à hydrogène ; les femmes n'avaient des sigisbées que parce qu'on n'avait pas inventé le stérilet.
D'ailleurs il ne faut rien exagérer. L'Amoureux a du mérite : il écrit des lettres chaque semaine pendant six ans à son Emilie qui court l'Espagne. C'est joli. "Vous êtes ma maîtresse errante et adorée" lui écrit-il. Et, d'autres fois : "Ma princesse, ma reine!" comme un Rimbaud avant l'heure. Cet amour platonique et désintéressé, si constant, est évidemment très antérieur au voyage à Madrid, car il rappelle qu'elle a déjà voyagé en Angleterre, en Italie - probablement à Gênes où, on l'a vu, M. de Flobert était ingénieur en chef des fortifs. Toujours à la poursuite de son père introuvable, de sa famille volontairement oublieuse, et de l'argent qu'elle croit ratisser à force d'intrigues. Pauvre Emilie ! Portocarrero par raccroc. Désabusée, ou moins entêtée, elle aurait certainement pu se faire, avec ses belles relations, une vie de demi-castor (le terme est d'époque) très acceptable et confortable. Mais c'est une mélancolique. Plutôt cérébrale que sensuelle, cette dame vit dans des chimères.
Pour se consoler, elle a ses chiens. Louis-Sébastien Mercier a bien vu la mode des chiens : on dirait que c'est d'Emilie, de Moretto, de Fils-Fils et de l'Amoureux qu'il parle : "La folie des femmes est poussée au dernier période sur cet article. Elles sont devenues gouvernantes de roquets, et ont pour eux des soins inconcevables. Marchez sur la patte d'un petit chien, vous êtes perdu dans l'esprit d'une femme ; elle pourra dissimuler, mais elle ne vous le pardonnera jamais : vous avez blessé son manitou.
Les mets les plus exquis leur sont prodigués : on les régale de poulets gras, et l'on ne donne pas un bouillon au malade qui gît dans le grenier.
Mais ce qu'on ne voit qu'à Paris, ce sont de grands imbéciles qui, pour faire leur cour à des femmes, portent leur chien publiquement sous le bras dans les promenades et dans les rues ; ce qui leur donne un air si niais et si bête, qu'on est tenté de leur rire au nez, pour leur apprendre à être hommes. "
Madame Geoffrin
L'Amoureux fréquente assidûment le salon de Madame Geoffrin. Il y brille en y narrant des anecdotes espagnoles et picaresques du voyage d'Emilie. (Au fait, où ont bien pu passer les lettres d’Emilie ? Elle a du en écrire un sacré paquet). Il y parle d'Emilie avec le comte de Creutz, autre admirateur de notre mélancolique amie. Madame Geoffrin est une de ces tenancières de salons plus ou moins politiques, littéraires, mondains, artistiques dont on chercherait en vain le charme, et dont Virginia Woolf a si bien dans Orlando décrit l'inanité. Que faisaient, que disaient ces gens à longueur de soupers, à longueur d'années ? Rien. Des sottises, de l'esprit à bon marché, des mondanités : il suffit de se référer à la première Madame Verdurin venue. Madame Geoffrin est une Madame Verdurin pas vulgaire, pas agressive, pas sotte non plus : rien. Grimm fait un portrait assez drolatique de cette "reine-mère de Pologne" (Stanislas Poniatowski se considérait comme son fils spirituel), de cette Geoffrinska. "Elle renouvelle les défenses et lois prohibitives des années précédentes. Il ne sera pas plus permis que par le passé de parler chez elle ni d'affaires de la Cour, ni d'affaires de la ville, ni d'affaires du Nord, ni d'affaires du Midi, ni de paix, ni de guerre, ni de théologie ni de métaphysique, ni en général d'aucune matière quelconque. " On voit combien il est difficile, pour l'historien, de reconstituer les conversations qui se sont tenues chez Madame Geoffrin, rue Saint-Honoré. Cette Madame Verdurin du XVIIIe siècle n'est ni une intellectuelle, ni une bas-bleu, ni une féministe, ni une encyclopédiste : sa neutralité couleur de muraille lui fait recevoir tout le monde : les mondains, le prince de Rohan, la comtesse de Brionne, Mme d'Egmont, la marquise de Duras, et pêle-mêle Montesquieu, Turgot, la comtesse de Boufflers, Boucher, Van Loo, Joseph Vernet, Greuze, le comte de Caylus, des artistes, des économistes, des ambassadeurs... N'en jetez plus ! Ce n'est pas une femme, c'est une agence de placement. Une peinture de Lemonnier (à Rouen, Musée des Beaux-Arts) la montre dans son salon de la rue Saint-Honoré. Avec une peau pâle et blanche de femme âgée, en robe grise, le visage allongé dans un serre-tête de dentelle noire, elle ressemble à n'importe quelle grand-mère de n'importe quelle époque. Elle est flanquée de deux hommes en rouge. L'un, à l'air fat et béat, est un prince du Sang (les broderies, le cordon bleu). L'autre, à la grosse lèvre, une espèce de magistrat. Les gens autour d'eux - et ils sont plusieurs douzaines -, sont rangés sur des chaises comme des potiches le long des murs où sont accrochés des tableaux qui montrent des vestales se chauffant subrepticement les mains : on les comprend, il devait faire diablement froid, sous ces hauts plafonds gris où bourdonnaient inlassablement des paroles melliflues, bien élevées, polies, creuses, rabotées... La maîtresse de maison a l'habitude de couper d'un: "Voilà qui est bien! Voilà qui est à merveille" toutes les queues de conversation qui ne lui plaisent pas trop. A voir la liste des interdits si drôlement dressés par Grimm, on ne devait pas s'amuser comme de petits fous, chez Madame Geoffrin.
A ses murs, j'oubliais, deux tableaux connus : la Pourvoyeuse, de Chardin, et tout en haut, sous la corniche de plâtre, la mélodramatique "Mort du Père", de l'incassable Greuze, propre à culpabiliser tout un chacun qui manifestera une idée un peu personnelle. Quelle ambiance !
"En cherchant bien, pensais-je, dans cette scène salonarde, c'est bien le diable si je n'y trouve pas, quelques chaises plus loin et à trois perruques du cardinal de Bernis, notre Amoureux discutant avec M. Partyet, l'Intendant des Invalides..."
Hélas ! Trois fois hélas ! Ce tableau de Lemonnier, qui représente une lecture de la tragédie l'Orphelin de la Chine dans le salon de Mme Geoffrin, n'est qu'un pastiche ! Un misérable pastiche ! Qui si ça se trouve aurait fait éclater de rire ceux qu'y a audacieusement groupés le peintre ! Exposé en 1814, soixante ans après l'événement, "ce motif a fourni à l'artiste le moyen d'offrir dans le même cadre une réunion de personnages célèbres en France à l'époque qu'il a choisie, celle de 1755." (Landon : Salon de 1814).
Madame Vigée-Lebrun, peintresse excessivement bien élevée et du reste femme aimable, décrit poliment cette Madame Geoffrin qui est pour nous une énigme. "Elle réunissait chez elle tout ce qu'elle connaissait d'hommes distingués dans la littérature et dans les arts, les étrangers de marque et les plus grands seigneurs de la cour. Sans naissance, sans talents, sans même avoir une fortune considérable, elle s'était créé ainsi à Paris une existence unique dans son genre. Ayant entendu parler de moi, elle vint me voir un matin et me dit les choses les plus flatteuses sur ma personne et sur mon talent. Quoiqu'elle ne fut pas alors très âgée, je lui aurais donné cent ans ; car, non seulement elle se tenait un peu courbée, mais son costume la vieillissait beaucoup. Elle était vêtue d'une robe gris de fer et portait sur sa tête un bonnet à grand papillon, recouvert d'une coiffe noire nouée sous le menton ».
Le Père Yvel et M. Partyet
Beaucoup de personnes que fréquente l'Amoureux Inconnu sont, soit des gens de la plus haute noblesse, soit des rouages importants de ces administrations compliquées qui peuvent faire obtenir quelque prébende à une fille du plus beau sang malheureusement délaissée par son ingrate famille. Quelquefois, mais rarement, ils sont les deux à la fois : nobles et rouages bien placés. Pour la rente qu'Emilie désire se faire servir par le Clergé, on ne sait à quel titre, il n'est pas question, par exemple, de l'Abbé de Crillon, redistributeur de ces biens terrestres, mais d'un modeste ecclésiastique : le Père Yvel, qui est décoré de l'Ordre de Saint-Michel et qui collectionne les objets d'histoire naturelle, tels que coquillages, papillons... Le Père Yvel est souvent cité en compagnie de M. Parthier, dont le véritable nom, suivant l'Almanach Royal, est Partyet : c'est le Directeur et l'Intendant de l'Hôtel Royal des Invalides, lui aussi décoré de l'Ordre de Saint-Michel. M. Partyet paraît avoir quelque tendresse pour notre héroïne, qui plaît décidément aux vieux messieurs. L'Amoureux montre un certain dépit quand il l'appelle "le vieillard des Invalides." Ce qui indique que lui et M. Yvel sont des gens âgés, certainement de la génération des parents d'Emilie, c'est qu'à une réunion de ce fameux Ordre de Saint-Michel, dont le cordon était noir, l'Amoureux est placé entre eux deux et que tous trois parlent... de la belle Emilie ! Sans vouloir concurrencer Goya dans ses dessins de vieux amoureux et de jeunes filles aux bas bien tirés, le fait est patent...
L'Abbé Béliardi
L'Abbé Billardy ou Belliardy, comme écrit l'Amoureux, est lui, un personnage très important : le consul de France à Madrid ; chargé des Affaires de la Marine et du Commerce. Si on retrouvait les lettres ou des mémoires de celui-là, on en apprendrait beaucoup sur Emilie, car elle dut longtemps le tanner pour avoir appuis, pensions... Il est question de lui dans presque toutes les lettres du voyage en Espagne pour agiter les autochtones, du roi Charles III aux Montijo, en descendant jusqu'à de plus minces caballeros. L'abbé Beliardy est un personnage marquant de l'entourage de Choiseul, le ministre : on l'y voit, dans son magnifique exil de Chanteloup, jouer aux échecs avec le duc, en compagnie de la duchesse de Grammont, soeur du duc, de quantité de marquis, de comtes et d'archevêques, et de l'érudit et si vivant abbé Barthélémy, numismate, auteur du "Voyage du Jeune Anacharsis" et ami de la maîtresse de maison (1).
___________
(1) : Trois ans après le décès de mon père Jean Escande, en octobre 2019, alors que je corrigeais cette étude inédite pour la mettre sur le net, mon mari Frank Dubuisson, tout à fait par hasard, lisant l’ « Histoire de ma Vie » de Casanova, tomba au Chapitre 17 sur ce qui suit, alors que Casanova est en Espagne : « Trois ou quatre jours après le Roi revint à Madrid avec la famille royale et les ministres, chez lesquels j’allais journellement pour l’affaire de la Sierra Morena, où je me disposais à faire un voyage. Manucci, qui continuait à me donner des marques d’une sincère amitié, devait m’accompagner pour son plaisir avec une aventurière qui se nommait Portocarrero, laquelle se disait nièce ou fille du feu cardinal de ce nom, ayant par cette raison de grandes prétentions, quoi qu’elle ne fut en réalité que la concubine secrète de l’abbé Bigliardi, consul de France à Madrid. »
Il ne peut s’agir que de notre Emilie Portocarrero et de notre abbé Béliardi ou « Bigliardi ». Jean Escande, bien qu’il ait lu lui-même les souvenirs de Casanova, comme on le verra par la suite, n’eut manifestement pas connaissance de ce passage – il est vrai que les souvenirs de Casanova couvrent plus de mille pages - qui éclaire pourtant de façon spectaculaire cette étude ; cependant le portrait que Jean Escande fait de la Portocarrero, par simple déduction et intuition, corrobore absolument ce qu’en dit Casanova : une intrigante intéressée, que la vertu n’embarrasse pas outre mesure : « plutôt cérébrale que sensuelle », dit-il dans cette étude page 18 ; elle n’eut pas, visiblement, le privilège de plaire au séducteur Casanova, qui la traite, comme on le voit, avec quelque mépris.
Comme mon père aurait été heureux de tomber sur ces quelques lignes ! Note d’Angélique Escande-Dubuisson, 3 décembre 2019.
M. Giamboni
M. Giamboni, dont parle souvent l'Amoureux, est un Génois, M. Octave Giambonne. Secrétaire du Roi depuis 1759, il habitait à Paris rue Mauconseil. C'est un "banquier pour les traites et remises de place en place" (Almanach Royal, 1765). Sa femme, Marie-Louise de Marny, a été au Parc-aux-Cerfs une maîtresse occasionnelle de Louis XV. (C'est ensuite qu'on l'a mariée à M. Giamboni). Elle en a eu un enfant, ou des enfants ? Toujours est-il que longtemps après, en émigration à Turin le 11 octobre 1789, le marquis d'Espinchal, mémorialiste auquel ont recours tous les bons auteurs, a rencontré M. Giamboni avec sa soeur, la jolie et aimable Madame des Boulets, en nombreuse compagnie, dont encore une fois le duc de Choiseul, le fermier-général Bérenger etc... Vu la différence de dates avec les lettres d'Emilie (25 ans) il doit plutôt s'agir des enfants de ce M. Giambonne, banquier à qui notre héroïne a souvent recours. Je donne gracieusement tous ces détails pour les familles qui voudraient se trouver en Louis XV un ancêtre, afin de devenir à leur tour Présidents de la République.
Le Marquis de La Pailleterie
Le marquis Charles Davy de La Pailleterie est lui aussi un rouage de la Machine à Phynances d’Emilie. Combinant la noblesse et l’utilité, il paraît être quelque chose aux Affaires Etrangères, département des passeports. Il est de mèche avec elle pour quelque vente de pacotille à Saint-Domingue, où il possède d'importantes plantations, un bateau... Depuis 1753 il vit en France et en 1760 a fondé une société commerciale où on vend de tout, même des nègres. Son frère Alexandre se contente d'en faire : c'est le grand-père d'Alexandre Dumas, notre Homère. Le marquis a une propriété à Amilly, près de Montargis, et habite à Paris rue des Vieilles Tuileries (rue du Cherche-Midi actuelle). Je le dis tous net : l'Amoureux ne l'aime pas. Il s'en tient à distance, mais lui fait parvenir les chiens que lui offre Emilie, pour se concilier ses bonnes grâces. Les La Pailleterie sont connus, à leur époque : avec un nom pareil on pourrait croire à un marquisat de pacotille. Pas du tout. En 1702, on trouve un Bailly de La Pailleterie à l'Ordre de Malte, qui commande cinq galères à Dunkerque avec lesquelles il fait merveille sous Jean Bart.
Tout de même... N'est-ce pas amusant de voir en relations étroites le grand-oncle d’Alexandre Dumas, notre gros réjoui, et la grand-tante de... de... Mais n'anticipons pas ! Comme le monde est petit ! (Gilles Henry : Détective de l'Histoire. Ed. In Fine 1992).
Le Comte de Creutz
Avec le comte de Creutz, très souvent cité dans les lettres, nous revenons chez les mondains. "Cet Autrichien finlandais" comme écrit quelque part avec raillerie notre Amoureux, est un personnage très lancé du Tout-Paris sous Louis XV. En effet Gustave-Philippe, comte de Creutz, s'il porte un nom autrichien, est bel et bien né en Finlande en 1731 (mort en 1785). Il est distingué et cultivé. Cet ancêtre de tous les barons de Gondremarck aimait tant la Vie Parisienne qu'ambassadeur en France il résida vingt ans à Paris : il eût tout le temps d'y voir "les divas qui font fureur. "
"Il se lia avec les esprits les plus distingués" dit Larousse au XIXe siècle."Dont Marmontel et Grétry. Pendant son séjour en Espagne (où Creutz avait été auparavant ambassadeur), il étudia ce pays en philosophe et en poète, et communiqua ses observations à Marmontel, dans une suite de lettres écrites en français avec élégance et pureté. Egalement lié avec Francklin, il fut l'intermédiaire d'une alliance politique entre la Suède et les Etats-Unis." N'allons pas si haut, ni si loin. L'Amoureux parle tout le temps à Emilie du comte de Creutz, qu'il appelle souvent "le comte", en compagnie du" baron": le baron de Friezendorff, chargé des affaires de la Cour de Suède. On verra qu'Emilie avait un amoureux parmi ces Suédois. Le comte de Creutz, très lancé, est présent dans toutes les correspondances de jeunes femmes de la haute société qui se sont donné pour mission de former (politiquement) le futur Gustave III de Suède : la comtesse de Boufflers, la charmante comtesse d'Egmont. C'est un des Européens typiques de ce siècle et de cette société cosmopolite qui ne parle que français : habitué des soirées de Mme Geoffrin, amateur de musique, le comte de Creutz protégea Grétry à ses débuts. Il a l'air d'avoir soupiré modestement pour Emilie de Portocarrero, si l'on en croit ce flatteur qu'est l'Amoureux Inconnu.
Le comte de Creutz tenta un jour de fonder son propre salon, et pour cela il piqua les célébrités du salon de Mme d'Héricourt, bourré de beaux esprits comme MM. Chamfort, l'abbé Delille, Rulhière, Marmontel. La tentative échoua. C’est Talleyrand, alors abbé de Périgord, qui nous le raconte dans ses mémoires : "Nous y fûmes trois ou quatre fois, mais Marmontel, à force de lectures de tragédies, dispersa tout le dîner ; je tins bons jusqu'à Numitor." Or, avant Numitor, Marmontel avait passé en revue, dans ses tragédies, Denys le Tyran, Aristomène, Cléopâtre, les Héraclides, etc, etc... On comprend que les dîners de M. de Creutz devaient être un peu soporifiques. Il a lui-même écrit des poèmes : l'Ode à l'Eté (1756) et Atis et Camilla (1761), dont l'édition, deux cent ans après, a été une révélation.
Messieurs Péan et Cassaing
On comprend, par le contexte des lettres, que ces messieurs sont des médecins : l'Amoureux a recours à eux à chaque maladie d'Emilie, ou quand la femme de La Jeunesse, son valet de chambre, doit accoucher, ou pour Mlle Antonia Verner... J'ai retrouvé MM. Péan et Cassaing dans l'inestimable Almanach Royal. Ils sont ensemble, au détour d'une page. Ce sont deux maîtres en chirurgie de la Ville de Paris, tous deux nommés en 1749. Le premier habitait rue Jean-Pain-Mollet, le second rue Mauconseil, "vis-à-vis le cloître Saint Jacques." C'est, comme on voit, dans ce même quartier de Saint-Eustache qu'habitent aussi les Coigny, rue Coq-Héron. C'est à l'Hôtel de Coigny qu'auront lieu, en 1783, les fameuses expériences du Baquet de Messmer.
Monsieur de Saint-Germain
Emilie n'est pas entichée de noblesse au point d'en être aveuglée : elle fréquente du substanciel, et là, non du moindre ! Des financiers, s'il vous plaît. Des grands et des connus. "Tout se fait par intrigue, les moindres places ne s'accordent que par des détours" écrit Mercier. "Les femmes, depuis quelques années, jouent publiquement le rôle d'entremetteuses d'affaires. Elles écrivent vingt lettres par jour, renouvellent les sollicitations, assiègent les ministres, fatiguent les commis. Elles ont leurs bureaux, leurs registres, et à force d'agiter la roue de fortune, elles y placent leurs amants, leurs favoris, leurs maris, et enfin ceux qui les paient." Emilie, qui ne s'occupe que d'elle, n'a pas tant à forcer. Elle change de quartier, passe l'eau au Pont-Royal, et à travers le lacis incongru pour nous de l'amas de maisons du Carrousel nous voilà dans le royaume de la Finance : au faubourg Saint-Honoré. M. de Saint-Germain, Trésorier de France, est le plus constant ami d'Emilie ; il la connait dès sa jeunesse et lui rendra service avec constance jusqu'à son dernier souffle, car il mourra avant elle. Il habite rue de la Sourdière, butte Saint-Roch. Il y est d’ailleurs petitement établi : il n’a qu’un médiocre appartement, une chambre, dit-il, où l'on peut à peine entreposer quelques paquets. En bon Parisien de toute époque, harassé par le remue-ménage incessant de sa ville, M. de Saint-Germain aspirera sur ses vieux jours à la quitter pour les campagnes du Languedoc, mais son espoir sera déçu, et il mourra à Paris sans avoir revu sa vieille amie. On peut supposer sans trop de risques d'erreur qu'il en a toujours été amoureux. Il est marié, pourtant, mais cocu.
Monsieur de Saint-Jullien
M. de Saint-Jullien, ami de M. de Saint-Germain, est un important financier, sans qu'on sache s'il s'agit du père ou du fils, mais plus probablement de ce dernier. Car on trouve deux Saint-Jullien au XVIIIe siècle : le père, François-David Bollioud de Saint-Jullien, Trésorier Général du Clergé de France en 1739, avait eu de Charlotte de la Tour du Pin un fils qui fut comme lui Trésorier Général. Même dans ses ascendants, la famille Saint-Jullien, à qui Emilie fait les yeux doux, s'occupe depuis près d'un siècle des biens du Clergé. Les Bollioud de Saint-Jullien habitaient rue Neuve des Petits-Champs, à l'Hôtel Saint-Pouange. C'est d'eux que cette vipère de Chamfort raconte l'anecdote suivante : "M. de Saint-Jullien, le père, ayant ordonné à son fils de lui donner la liste de ses dettes, celui-ci mit à la tête de son bilan 60 000 livres pour une charge de conseiller au Parlement de Bordeaux. Le père indigné crut que c'était une raillerie, et lui en fit des reproches amers. Le fils soutint qu'il avait payé cette charge. "C'était, dit-il, lorsque je fis connaissance avec Mme Tilaurier. Elle souhaitait d'avoir une charge de conseiller au parlement de Bordeaux pour son mari, et jamais, sans celà, elle n'aurait eu d'amitié pour moi ; j'ai payé la place, et vous voyez, mon père, qu'il n'y a pas de quoi être en colère contre moi, et que je ne suis pas un mauvais plaisant. " (1).
_______________
(1) : Jacques Thilorier, Conseiller au Parlement de Bordeaux, second fils de Pierre Thilorier et de Jeanne Hamelin.
Par la suite, Saint-Jullien le jeune donna dans l'occultisme si à la mode à la fin du siècle. On le trouve inscrit à la Loge des Amis Réunis, "avec tous les grands de la finance officielle." C'est de lui qu'il est question dans les lettres à Emilie comme supérieur de M. de Saint-Germain. "Curieux d'occultisme, et ami de l'hermétisme Duchanteau, il donna à la loge une forte teinte mystique" écrit M. Chaussinand-Nogaret. Elle lui dut "son établissement matériel. Maître en tous grades, ayant tenu autrefois les premiers maillets dans les loges anglaises", le Receveur Général du Clergé "donna à la loge une preuve de son zèle à laquelle elle doit toute son existence et qui assure à jamais son établissement. Il était propriétaire d'un terrain rue Royale. Il eut la générosité d'y faire construire à ses frais le temple et la maison qu'elle occupe et de lui abandonner... la jouissance de ce batiment et d'un jardin très agréable qui fait partie du terrain...” L'étrange personnalité de Bollioud de Saint-Jullien révèle une autre dimension de l'adhésion maçonnique de ce financier, receveur général du Clergé de France, le plus mystique philalèthe de la loge des Amis Réunis. Il avait trouvé en Duchanteau, le Saint-Martin de la loge, un guide pour la recherche des grands secrets. Adepte enthousiaste du Code Théosophique de la Vérité, où Duchanteau exposait le système théosophique, il se livra avec lui à la recherche de la pierre philosophale et tenta de convaincre les Amis Réunis. Il déclarait devant eux, le 20 janvier 1781 : "le résultat de l'oeuvre hermétique est fini, mais sans avoir produit absolument la pierre philosophale, avouant qu'il ne sait pas encore parfaitement l'opération de l'art." Bref, tout était à recommencer. Saint-Jullien fit, la même année, un voyage en Allemagne, d’où il rapporta "les livres les plus précieux... dont on lui avait fait présent. Il mourut peu après..." (1).
Bref, on se trouve en présence d'un richissime fils à papa qui occupe son inutilité, au début de sa vie avec des femmes galantes, et à la fin avec des chimères.
La Comtesse d'Egmont
Les Egmont sont des amis de l'Amoureux Inconnu. Il n'hésitera pas à demander l'appui du comte, César Pignatelli, Grand d'Espagne, pour qu'Emilie ait une recommandation à la cour de Charles III. En 1766, le comte, qui a assisté dix ans auparavant à l'assaut de Minorque et à la prise de Mahon, avec le maréchal de Richelieu, est un officier d'une quarantaine d'années. Sa femme, la comtesse d'Egmont, Jeanne-Sophie-Elisabeth-Armand-Septimanie du Plessis, est la fille unique et chérie du noceur qu'est le Maréchal. "Elle réunissait les qualités aimables de son père sans en avoir les vices", nous dit-on (2). Cette jeune femme, née en 1740, est spirituelle et a une âme romanesque. Elle s'est trompée d'époque : née trente ans plus tard elle aurait pu figurer avec avantage dans la galerie des héroïnes patriotes de la Révolution. Elle ne rêve que gloire et vertus militaires ; son époque lui semble plate et fade. "On annonça, dans une maison où soupoit Madame d'Egmont, un homme qui s'appelloit du Guesclin. A ce nom son imagination s'allume. Elle fait mettre cet homme à table à côté d'elle, lui fait mille politesses et enfin lui offre du plat qu'elle avoit devant elle. (C'étoient des truffes). "Madame, répond le sot, il n'en faut pas à côté de vous." - "A ce ton, dit-elle en contant cette histoire, j'eus grand regret de mes honnêtetés. Je fis comme ce dauphin qui dans le naufrage d'un vaisseau, crut sauver un homme et le rejeta dans la mer en voyant que c'étoit un singe." (3).
____________
(1) : Chaussinand-Nogaret : Les Financiers du Languedoc au XVIIIe s. Paris, 1970. D'après sa lettre à Emilie, Saint-Jullien vivait encore en 1787.
(2) : Amours et Intrigues du Maréchal de Richelieu, p. 574.
(3) : Pour comprendre le très mauvais jeu de mots de ce Du Guesclin, il faut savoir qu'une truffe désigne à l'époque un imbécile. Se truffer de quelqu'un : se moquer de lui. Un Truffaldin (comédie italienne) : un tuteur trompé.
Cette jeune femme cultivée qui cite une fable de La Fontaine se mêlait d'éducation. "Ayant trouvé un homme du premier mérite à mettre à la tête de l'éducation de M. de Chinon, son neveu, elle n'osa pas le présenter en son nom. Elle étoit pour M. de Fronsac, son frère, un personnage trop grave. Elle pria le poète Bernard de passer chez elle. Il y alla ; elle le mit au fait. Bernard lui dit : "Madame, l'auteur de l'Art d'Aimer n'est pas un personnage bien imposant, mais je je suis encore un peu trop pour cette occasion : je pourrois vous dire que Mademoiselle Arnould (Sophie Arnould, une cantatrice peu farouche) seroit un passe-port beaucoup meilleur auprès de monsieur votre frère." - "Eh bien! dit Madame d'Egmont en riant, arrangez le souper chez Mademoiselle Arnould." Le souper s'arrangea, Bernard y proposa l'abbé Lapdant pour précepteur : il fut agréé. C'est celui qui a depuis achevé l'éducation du duc d'Enghien."
On doit ces deux anecdotes - où l’on voit un certain Bernard, poète -, à ce fabricant patenté de nouvelles à la main qu’est Chamfort. Ce qui du coup autorise à lire (car c'est un roman très agréable) les amours de la comtesse d'Egmont et d'un jeune militaire inconnu telles que les raconte Courchamp dans ses "Mémoires de la Marquise de Créquy. "
La comtesse d'Egmont a laissé des oeuvres personnelles : des lettres très intéressantes. Elle fait partie d'un groupe de jeunes femmes qui entreprennent de faire du futur Gustave III de Suède à la fois un Du Guesclin, un sage d'Athènes et un législateur romain, avec beaucoup de naïveté. Ce genre de salade composée était très à la mode. Mais le sujet ne fut pas à la hauteur des aspirations de ces intellectuelles. Il était écrit que les gens du XVIIIe s. ne pourraient donner leur mesure : Gustave III fut assassiné en 1792 au cours d’un bal masqué par un dérangé que nos fiers républicains proclamèrent, bien entendu, un authentique Brutus.
La Suède reçut plus tard un roi idéal et sage législateur. C'était un ancien militaire. Mais il ne sortait nullement de la classe sociale de la comtesse d'Egmont et de ses belles amies. Gageons même qu'elles l'auraient peu apprécié, car il ne plaisait pas aux dames, même pas à sa femme. Ce Français méridional, sorti du peuple palois et qui régna sous le nom de Charles-Jean XIV, est plus connu sous son nom de Bernadotte. Hélas, à son avènement Mme d'Egmont était morte depuis belle lurette, et elle n'aurait certainement pas reconnu son roi idéal dans ce héros de nouvelle fabrique. (L’épée du sacre de Charles-Jean XIV est, je ne sais pourquoi, dans la garde-robe de la chambre du maréchal Soult, à Soult-Berg ; je l'y ai de mes yeux vue).
Monsieur d'Arboulin
Comme il ne faut oublier personne, notons le personnage par l'entremise duquel Emilie reçoit gratuitement son courrier : M. d'Harboulin (avec un H) comme l'appelle M. de Saint-Germain. C’est un proche de la Pompadour, qui l'a surnommé Boubou. (Elle a, comme Louis XV, le goût des surnoms idiots). Jean-Potentien d'Arboulin, Administrateur Général des Postes de 1759 à 1779, secrétaire du Cabinet du Roi en 1769, est un oncle de Bougainville. Il est passé à la postérité pour un trait d'amour bien rare à son époque.
Voici le fait. Dans sa longue carrière d'étalon, Louis XV n'a repoussé que deux femmes. L'une est la femme du Président du Portail. "Jolie, mais d'une vanité extrême", elle eût avec le roi ennuyé un entretien "qui ne fut pas poussé aussi loin qu'elle l'aurait désiré". Pendant un bal masqué, un mauvais plaisant de garde-du-corps, qui ressemblait beaucoup à Sa Majesté, profitant de l'erreur de Mme du Portail "remporta sur elle tous les avantages qu'il put désirer." Comme la Présidente est une idiote "elle osa affecter de rentrer en désordre dans l'assemblée, fort satisfaite de l'accolade qu'elle croyait avoir reçue du roi", pendant que le garde-du-corps, en bon mufle, claironne son triomphe. Telles sont les moeurs élégantes de ce siècle raffiné. Mais ce n'est pas tout. "Quelque temps après, elle fut enveloppée dans une bien vilaine affaire : on l'accusa d'avoir, de concert avec sa cuisinière et son portier, avisé aux moyens d'empoisonner son mari." Vrai ou faux, le Président du Portail voulait étouffer l'affaire, mais la Pompadour, en bonne femelle, fit enfermer dans un cloître par lettre de cachet la rivale qui avait osé venir chasser sur ses terres.
C'est là qu'apparaît M. d'Arboulin, sous les traits respectables de l'amoureux fidèle. "Il y avait dans le service de Mme de Pompadour un marchand de vin très riche, nommé M. d'Arboulin, qui avait été amoureux de Mme du Portail avant son malheur ; croyant que son état présent la rendrait plus favorable à sa passion qu'elle ne l'avait été dans ses beaux jours, il employa son crédit auprès de Mme de Pompadour qui, satisfaite de son triomphe, ne voyait plus rien de redoutable à sa faveur dans une femme perdue pour toujours dans l'esprit du public ; elle accorda donc avec l'air de la commisération la liberté à Mme du Portail qui, séparée de corps et de biens avec son mari, récompensa le zèle de M. d'Arboulin en ne cachant pas sa reconnaissance. Elle vécut publiquement avec lui, disant à qui voulait l'entendre qu'il avait tout ce qu'on pouvait désirer dans un mari : amour et zèle, sans avoir les vices des grands : fausseté et impuissance." (1).
________________
(1) : Mémoires Historiques et Anecdotes de la Cour de France pendant la faveur de Mme de Pompadour, tirées du portefeuille de la Maréchale D... par Soulavie.

Gentil-Bernard, l'ami de ces dames
J'en étais là de mes recherches sur l'Amoureux d'Emilie, que j'imaginais donc comme un homme assez âgé, indulgent, égoïste, peut-être veuf, bien en cour : bref un assez plausible officier supérieur de dragons pendant la guerre de Succession de Pologne, ami de plusieurs maréchaux.
Je n'avais qu'un moyen de l'identifier, en l'absence de toute signature ; dans une de ses lettres, il déclare tout uniment l'arrestation et la mise à la Bastille de son domestique Du Sigur, pincé à passer en contrebande des livres interdits. C'est bien le diable, pensais-je, s'il n'y a pas sur le registre d'écrou une précision du genre: "Du Sigur, domestique de M. de..."
Mais je reculais devant un tel travail. Pour découvrir l'identité du bonhomme, il fallait fouiller dans l'ouvrage de Funck-Brentano : "Les Lettres de cachet à Paris, étude suivie d'une liste de prisonniers de la Bastille (1659-1789) Paris 1903." L'auteur donne la liste des internés dans cette célèbre prison d'Etat, avec, pour chacun d’eux, ses dates d'entrée, de sortie ou de mort ; "le nom du secrétaire d'Etat qui a signé l'ordre d'incarcération et si possible son motif." Ou encore nager dans cet océan que sont les 19 volumes de Ravaisson-Mollien, ou Archives de la Bastille, parues entre 1866 et 1904... Ou finalement aller carrément consulter lesdites archives à la Bibliothèque de l'Arsenal.
Tout cela pour trouver au bout du compte un obscur colonel de cavalerie sur lequel j'en apprendrai un peu moins que sur le tuteur d'Emilie, M. de Flobert ! Deux ans passèrent, et je laissai dormir la belle Espagnole dans son carton.
Puis un beau jour, en relisant pour la ixième fois ces lettres, une phrase me fit tiquer. Dans la lettre du 1er juin 1766 l'Amoureux folâtre : "St Bernard aura aussi mon hommage et ma pensée parce qu'il me rappellera les bonnes oeuvres que vous ferés à mon intention."
Bon. Je ne suis pas plus avancé. Je ne vais quand même pas chercher tous les Bernard du XVIIIe siècle, il y en a peut-être un ou deux millions... A supposer, pour commencer, que ce soit son nom, et non pas son prénom ! Peut-être est-il un des fils de Samuel Bernard, le richissime banquier de Louis XIV et Louis XV ? Emilie voit beaucoup de gens de finance...
Par acquit de conscience, je regarde sans conviction dans le premier dictionnaire qui trône sur ma cheminée : le modeste Bouillet. Je me donne l'impression d'être un de ces naïfs qui, trouvant dans leur grenier un méchant chromo signé Fragonard, en concluent sur la foi du Petit Larousse, qu'ils possèdent une authentique toile de maître...
Il y a une flopée de Bernard dans le Bouillet. Je les lis tous, on ne sait jamais. Le saint, bien entendu. Puis, pêle-mêle, un roi d'Italie, un duc de Septimanie, un troubadour, un graveur, un écrivain calviniste, un libraire, le physiologiste, le financier, que sais-je ? Pourtant, l'un d'eux me tire l'oeil. Un certain Bernard (Pierre-Joseph), poète connu sous le nom de Gentil-Bernard... Secrétaire du Maréchal de Coigny qui commandait l'armée d'Italie... Tiens ! Tiens ! Et qui obtint après la mort du maréchal la place lucrative de secrétaire-général des Dragons... Mais cela ressemble fort à mon bougre ! Le voilà, l'amoureux inconnu d'Emilie ! Le voilà bien ! Vite, prenons cet estimable ouvrage qu'est le Guide Bleu Littéraire de la France : A Choisy-le-Roi, le poète Gentil-Bernard est secrétaire du cabinet de Choisy de Madame de Pompadour ! Et l'Almanach Royal de 1765 confirme : M. Bernard, secrétaire-général des Dragons, rue Coq-Héron, à l'Hôtel de Coigny, Garde des Livres du Cabinet du Roi à Choisy. C'est lui ! Pas de doute ! Car il ne peut y avoir au XVIIIe siècle et à la même époque deux hommes qui habitent Choisy, qui approchent le roi à son petit-lever, qui font partie de la maison de Coigny et qui sont secrétaire-général des Dragons ! Tout en s'appelant Bernard ! De plus, une lettre de M. de Nerel à Emilie parle tout au long de M. Bernard par-ci, M. Bernard par-là !
La solution était donc là, tout simplement, sur cette cheminée de guingois, dans les pages du modeste dictionnaire de M. Bouillet. Comme quoi, on va souvent chercher bien loin ce qu'avec un peu de flair on a carrément sous la main.
Eh bien, je fus très content pour Emilie, ce matin-là : un poète, c'est tout de même plus marrant qu'un officier à particule perdu dans la masse des Carrés d'Hozier et autres Jougla de Morenas.
Différents ouvrages plus volumineux les uns que les autres et qu'il est inutile de citer tous (sans compter la poussière qui s'en dégage) nous laissent entrapercevoir quelques traits de Gentil-Bernard. Singulier amoureux-tuteur que la petite a là. Né en 1708, il a 25 ans de plus qu'elle. C'est un Grenoblois, fils de sculpteur, un de ces enfants de la chance et de la fortune comme en fit éclore beaucoup ce siècle aimable aux gens légers, bien entrants, et moyennement talentueux. On nous dit que Pierre Bernard fit ses études chez les Jésuites lyonnais, puis, comme beaucoup, qu'il devint clerc de procureur. La basoche n'a pas du l'inspirer beaucoup plus qu'elle n'inspirera plus tard Restif ou Balzac. Dans les années 1730, on trouve Bernard à l'armée d'Italie, attaché à un général qui fut tué pendant la campagne, et dont il n'a pas cru bon de nous conserver le nom. "La carrière nouvelle qu'il abordait convenait parfaitement à notre auteur : gai, galant, de bonne mine et brave, il sut promptement se faire aimer de ses camarades et de ses chefs. Pendant cette campagne glorieuse pour la France, il assista de sa personne aux batailles de Parme et de Guastalla, et, dans ces deux affaires, se conduisit fort bien." (Fernand Drujon). Il ne passe pas, on s'en doute, tout son temps à se battre : c'est un Français du XVIIIe siècle. Parlant de ses compagnons, il nous les montre :
Occupés de guerre et d'amour,
Cuirassés, masqués, tour à tour,
Passant de la sape aux ruelles.
On les voit partout aguerris
Tenter des conquêtes nouvelles,
Et des rois venger les querelles,
Et s’en faire avec les maris.
C'est, sur un ton plus relevé, la morale des "Adieux de la Tulipe", de Mangenot, qui se chantait sur l'air de la Mère Michel:
Malgré la bataille
Qu'on donne demain,
Ca, faisons ripaille,
Charmante Catin.
Attendant la gloire,
Songeons au plaisir,
Sans lire au grimoire
Du sombre avenir.
L'avenir ne se montra pas sombre pour Bernard comme il le fut pour tant d'autres obscurs La Tulipe : "L'un des généraux qui avaient commandé en chef, le maréchal de Coigny, consentit à le prendre pour secrétaire ; c'est vraiment de ce moment que commence la fortune de Bernard..." (F. Drujon). Naturellement, il y a un hic : le maréchal n'apprécie pas les vers. "La poésie n'était pas précisément ce qui le séduisait le plus." Bien. On a beau être au XVIIIe s. un maréchal est un maréchal.
Ou apparaît Mme Lenormand d'Etioles
Chez son procureur parisien, Bernard avait pondu de jolis vers ; une Épître à Claudine, un Hymne à la Rose. Aussi peu ancien combattant que possible, après avoir versifié sur "les Campagnes d'Italie en 1733 et 1734", Bernard retourne à ses premières amours : les vers légers. C'est son bagage. De plus, il a le don de plaire : c'est son capital. La fortune ne le quitte plus. Il fréquente des danseuses, la demoiselle Sallé "célèbre et énigmatique", rivale de la Camargo. Il fréquente aussi le salon d'une sous-fermière : Madame d'Etioles, qui s'est jurée de se faire aimer du roi, et y parvient: elle est plus connue sous le nom de Madame de Pompadour. On ne sait la tête que fît le maréchal de Coigny quand, le 24 août 1737 éclata l'opéra de Castor et Pollux, de la plume de monsieur son secrétaire. Joué par l'Académie Royale de Musique, s'il vous plaît, avec musique de Rameau. C'est un succès retentissant. Bernard est un librettiste d'opéras : on ne saura trop s'en souvenir par la suite, et comme tel il a l'esprit facile qui plaît dans ce genre de composition. De plus, il a la très bonne idée de dédier sa pièce à la divinité du jour : Madame de Pompadour. Ne confondons pas : il connaît la favorite depuis bien avant sa vogue : c'est un très vieil ami à elle. Pas ingrate, la favorite royale renverra l'ascenseur : elle fera nommer Bernard bibliothécaire du cabinet de Louis XV à Choisy : sinécure qui ne lui rapporte pas moins de 30 000 livres annuelles, un vrai Pactole... Puis le fils du maréchal, le comte de Coigny, colonel-général des Dragons, fait donner en 1740 à Bernard la charge de secrétaire-général du corps : les Dragons jouissent sous Louis XV de la vogue qu'ont aujourd'hui les Paras. On peut penser que c'est une autre sinécure : elle rapporte pourtant par an à notre rimeur 20 000 livres, une vraie fortune, quand on sait qu'un curé de campagne ne jouissait que de 300 livres de casuel... Après ce beau coup double, Bernard ne se sent plus. Il est beau, riche, aimé, admiré, adulé : c'est le poète de cour qui a réussi. Il va s'en fourrer, fourrer jusque là.
Et d'abord, la célébrité. Voltaire, qui a le goût des surnoms cuculs pour tous ceux qui osent toucher à la sainte poésie, qui est, comme on ne le sait plus, sa chasse gardée -Voltaire qui a surnommé Florian "Florianet" et le Cardinal de Bernis "Babet la bouquetière", afin que nul n'ignore qu'il est le Grand Voltaire -, l'a appelé Gentil. Gentil-Bernard. Le nom lui est resté pour la postérité, pour le différencier de tous les Bernard passés et futurs.
C'est à peu près tout ce qui reste de cet homme comblé au cours de sa vie : un surnom... On ne le lit plus. Pas plus d'ailleurs que les poésies du Grand Voltaire, comme ces vers magnifiques qu'il écrivit un jour à Madame de Pompadour pour lui apprendre le beau langage. Il s'agit de cailles-farcies ou aux choux, on ne sait -, que la marquise avait déclarées "grassouillettes". L'écrivain Voltaire vole au secours de la langue française menacée par tant d’incorrection, en deux vers spirituels et même très fins dont on admirera, au passage, la richesse des rimes :
Grassouillettes, entre nous, me semble un peu caillette,
Je vous le dis tout bas, belle Pompadourette.
Evidemment, Gentil-Bernard ne saurait atteindre à ces hauteurs. Aussi trouve-t-on facilement des universitaires qui d'âge en âge ne rechignent pas à pondre des thèses de mille pages sur Mérope et autres Zaïre. Mais pas sur les oeuvrettes de Gentil-Bernard. Il ne s'est trouvé personne pour thésifier sur Phrosine et Mélidore, les Surprises de l'Amour, et l'Art d’Aimer, sa grande oeuvre dont il lisait si bien, parait-il, les vers. Hélas ! Quand elle parut, en 1775, avant ou après sa mort on ne sait, elle déçut tout un chacun. Gentil-Bernard avait toutes les qualités de son siècle : le brillant, la grâce, l'art suprême de se faire valoir avec des moins que rien, des épigrammes, des poésies on ne peut plus fugitives. Au fond, ni plus ni moins que les poésies de Méchant-Voltaire. Mais celui-ci a écrit Candide...
Comme des ailes d'un papillon, une fois qu'on a les pages de Gentil-Bernard entre les doigts, il ne reste rien qu'un peu de poussière pailletée, de cette poussière qui avait tant d'éclat sur les théâtres royaux.
Mais quelle grâce dans ce qui reste ! Bernard a souvent le charme mystérieux de ces quatre vers anonymes qu'on lit sous une gravure encadrée, comme le célèbre "Glissez, mortels, n'appuyez pas”, qui résume si justement toute cette époque heureuse. Ce ne sont pas ses grands poèmes qu'il faut lire, encore qu'on y trouve de beaux vers, mais les épîtres, telle celle "Sur l'Hiver":
De l'urne céleste,
Le signe funeste
Domine sur nous
Et sous lui commence
L'humide influence
De l'Ourse en courroux.
L'onde suspendue
Sur les monts voisins
Est dans nos bassins
En vain attendue...
On trouve à Bernard des ancêtres les plus honorables, et les plus sensibles de notre langue : Saint-Amant, Théophile de Viau, le La Fontaine de L'Ode aux Nymphes de Vaux. On lui trouve aussi une illustre postérité. Gentil-Bernard est un de ces poètes oubliés qui cent ans après inspireront le Verlaine des Fêtes Galantes et le Rimbaud des premières poésies. On y trouve déjà la naïveté si étudiée et si savante de Verlaine :
Rien n'est si beau
Que mon hameau
Oh! Quelle image!
Quel paysage
Fait pour Watteau!
Ou encore ces beaux vers tirés de l'Automne :
D'une ardeur extrême
Le temps nous poursuit.
C'est un lieu commun de dire que le XVIIIe siècle est une époque sans poésie. C'est plutôt d'une poésie délaissée qu'il s'agit. On est surpris, à lire Dorat, Pamy, et même ce vieux tordu de Voltaire, par le nombre de beaux vers. Dans mon enfance je savais par coeur l'Ode aux Vainqueurs de Philipsbourg, qui m'avait particulièrement enchanté :
Bellonne va réduire en cendres
Les courtines de Philipsbourg
Par cinquante mille Alexandre
Payés à quatre sous par jour...
Et dans les malheurs de la guerre
Le Français chante, boit et rit.
Toute cette poésie, plante fatiguée, mais gracieuse, de notre culture, a été étouffée, occultée par les robustes lierres noirs du Romantisme, qui cachent, cependant, beaucoup de ridicule. C'est par réaction contre l'hugolaille que les Symbolistes redécouvriront la ravissante métrique du XVIIIe siècle, et sans en rien dire à personne, en feront leur profit comme d'une chose à eux propre. A ce propos un petit parallèle entre Rimbaud et Gentil-Bernard ne sera pas sans saveur :
Austère Crisipe, Entends comme brame
Vas-tu follement Près des acacias
Poser un principe En avril la rame
Contre un sentiment ? Viride du pois !
Gentil-Bernard : l'Automne Rimbaud : LXXXII
La nature ordonne, Reconnais ce tour
Mon coeur obéit ; Si gai, si facile :
Sénèque raisonne, Ce n’est qu’onde, flore,
Horace jouit. Et c’est ta famille !
Gentil-Bernard : l'Automne Rimbaud : Age d’Or
En effet, ce n'est qu'onde, flore, et on ne se serait pas attendu à trouver dans Jean-Arthur un arrière-petit-fils de Gentil-Bernard :
Les Amours, au frais Et puis une voix
Aiguisent des traits Est-elle angélique !
Qu'avec peine émousse Il s’agit de moi
La froide saison Vertement s’explique.
Gentil-Bernard : le Printemps Rimbaud : Age d’Or
Mieux même: on trouve une postérité inattendue à Gentil-Bernard dans le Valéry du Cimetière Marin :
Dans le silence, une immobile extase,
Rallume, éteint le feu qui les embrase.
Il me semble qu’on peut facilement continuer par :
Midi le juste y compose de feux,
La mer, la mer toujours recommencée.
Valéry aurait-il plagié notre ami ?
Où suis-je, Amour, et quel feu me dévore ?
Quels traits, dis tu, peux-tu lancer encore ?
« Qui vibrent, volent et qui ne volent pas », aurait enchaîné aussi sec l’immortel auteur d’Eupalinos, qui avait retrouvé, après tant d’autres, le secret de la platitude en poésie.
Gentil-Bernard avait du goût pour l’amitié, et il en a joliment parlé :
Présent des Dieux, doux charme des humains,
O divine Amitié, viens pénétrer nos âmes.
Les cœurs éclairés de tes flammes
Avec des plaisirs purs n’ont que des jours sereins.
C’est dans tes nœuds charmants que tout est jouissance ;
Le temps ajoute encore unlustre à ta beauté
L’Amour te laisse la constance,
Et tu serais la Voluptés
Si l’homme avait son innocence.
Voilà qui est ravissant. La métrique rappelle La Fontaine, et si le fabuliste avait signé ces vers si mélodieux, tirés de Castor et Pollux, ils seraient connus de tous.
De Fontainebleau, en 1766, Gentil-Bernard écrit à Thémire, qui paraît être Mademoiselle Sallé, la danseuse :
J’habite l’asile des rois,
Palais que des sab les arides
Environnent au fond des bois,
Où l’on révéroit autrefois
Le rameau sacré des druides,
Et dont nos maîtres firent choix
Pour lancer leurs meutes rapides,
Et mettre le cerf aux abois.
Le vers est facile et coulant : c’est à peu près toute la description que nous fera Bernard de sa vie près de Louis XV. La suite se ressent de la lecture des poètes du siècle précédent, telle la « Solitude », de Saint-Amant :
J’aime à voir ces chênes antiques,
Et ces tours, ces dômes épars,
Ces rochers vus de toutes parts ;
Le désordre de ces portiques,
Ces magnificences gothiques,
N’ont rien qui blesse mes regards.
La suit est une paraphrase d’un air bien connu : le poète préfère la solitude de l’amour aux fastes des grands. Ce lieu commun se termine par un retour à la réalité :
Mais j’entends retentir les cors,
La chasse a fini, l’heure exige
Que j’abandonne le prestige
Du songe charmant d’où je sors.
Que le bruit des chasses m’afflige !
(Avec Louis XV, il devait être servi). Il est difficile, dans toutes ces épîtres à Thémire, Doris, Batilde, Galatée et autres Thélamire, de trouver quelques allusions précises à des Iris qui ne furent pas toujours en l’air. Cependant, l’épître XXV, A Eglé, paraît bien avoir quelque rapport avec Emilie Portocarrero. On peut y relever une allusion au mariage, qui a bien l’air d’avoir été réel, d’Emilie :
Si toute à toi, ta couche est délivrée
Du froid hymen qui ne t’y gêne plus,
Donne à l’amour la place d’hyménée ;
Ce dieu vengeur lui succède aisément.
Au fond, Gentil-Bernard est le Pierre Louÿs de son époque. Un Pierre Louÿs qui aurait eu la chance de vivre sous un vrai Roi Pausole. L'Epître à Claudine, "une fleur des prés", est le récit d'une aventure qu'il eût, dans un presbytère, en vrai Giglio, avec la servante d'un curé chez qui il était descendu, et qui avait bu assez convenablement pour fermer les yeux. Le reste est à l'avenant. "Il a constamment pris la galanterie pour le sentiment, et les transports des sens pour les impressions du coeur", écrit très justement le biographe inconnu de l'édition de 1821, ornée de six jolies gravures, inconnues elles aussi. On ne saurait mieux dire. Encore ce poème, qui fit son succès, se veut-il le récit d'un souvenir. La majeure partie de l'oeuvre de Pierre Bernard, comme celle de Pierre Louÿs (que de prénoms!) n'est faite que de pastiches d'une antiquité parfaitement mythique, un âge d’or érotique qui n'existe que dans leur imagination. Tous les personnages, jeunes, beaux, élégants et en excellente santé, s'y livrent à des ébats qui n'engendrent (si l'on peut dire) que la monotonie. Cette antiquité non datée est toujours vaguement grecque, de l'Art d'Aimer aux Chansons de Bilitis. Elle manque absolument de vie. La différence saute aux yeux quand on lit les vrais passages érotiques d'un roman grec antique, l'Ane d'Or, par exemple : le moment où après leurs jeux, contés d'une façon charmante, la servante Fotis change Apulée en âne. Mais ici l'auteur est un véritable écrivain, et d'ailleurs il se propose de nous conter, sous le couvert de la fable, tout autre chose que de banals ébats amoureux : comment ces galipettes, indéfiniment répétées pour elles-mêmes, changent effectivement Apulée en âne, animal lubrique, et non en oiseau (l'âme délivrée des soucis du corps) comme il avait cru d'abord ! Les deux Pierre, Louÿs et Bernard, sont bien près eux aussi de se voir pousser de longues oreilles ; en tout cas la description minutieuse de choses si naturelles, si journalières, ne nous amuse guère. La véritable poésie amoureuse, à toute époque, se survit dans d'aimables chansons, généralement ni signées ni datées. Quels vers magnifiques on y pêche, de "Avec le temps, Vénus devient avare", à "L'Amour se fait vieux, il n'a plus les yeux bien en face...” Mais évidemment, écrire comme ça, n'est pas donné à tout le monde.
Gentil-Bernard se rend assez souvent à Dampierre, qui appartient à l'époque à la famille de Luynes. Le Duc, auteur de Mémoires est mort le 2 novembre 1758 à 63 ans, et, nous dit le Père Régnault, jésuite "le salon de Mme de Luynes devenue veuve et infirme n'offrait plus à la reine Marie Leszczynska que l'image de la solitude et de la mort." Qui notre poète érotique va-t-il voir dans ce milieu qui semble même peu folichon à la très pieuse Marie Leszczynska ? Le nouveau duc de Luynes, Louis-Joseph, qui à la Révolution n'émigra pas et vécut retiré à Dampierre ? (Hillairet 240). Ou le cardinal de Luynes qui ne mourut que le 29 janvier 1788 à Paris, en cet hôtel de Luynes dont une petite rue qui donne dans le boulevard Saint-Germain perpétue seule la mémoire ? On ne sait.
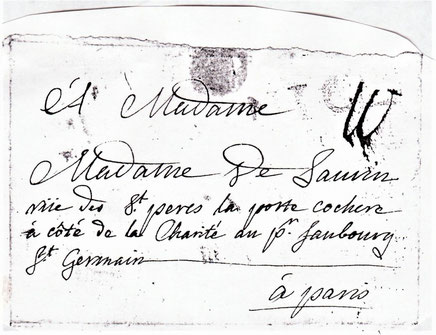
Un mari putatif
Peut-on éclaircir le mystère du nom parisien d'Emilie : Madame de Saurin ? C'est un nom en l'air, Gentil-Bernard le dit. Avec la pudibonderie de 1890, Benjamin Maurel, le curé de Viterbe (Tarn), qui écrivit une notice sur l'abbé de la Mazelière, son prédécesseur cent ans auparavant, donne à Mme de Portocarrero le titre décent et décoratif de "veuve". Il est bien en peine de dire de qui. Veuve suffira.
Or Gentil-Bernard a un ami, académicien comme lui : Saurin (Bernard Joseph). Ils sont de la même génération : celle de 1710. Saurin, avocat au Parlement de Paris, secrétaire du duc d'Orléans, eut lui aussi une belle carrière : Helvétius lui offrit une pension de mille écus s'il consentait à écrire une pièce de théâtre ! Singulière et enviable époque ! Une comédie échoua (1743) puis une tragédie (1752). Mais Saurin persévère : il a la plume facile. En 1761 il entre à l'Académie. Le duc de Nivemois, qui le reçoit, dit que "ses vers sont sans faste, et son commerce sans épines." Tout à fait le genre de Gentil-Bernard. Voilà Saurin lancé, il a pour amis Montesquieu, Voltaire, Saint-Lambert et tutti quanti. On imagine très bien, dans cette époque narquoise, Bernard demandant à son ami de prêter son nom à une Emilie en peine d'état-civil. L'autre s'y serait prêté de bonne grâce. Il a vingt-cinq ans de plus qu'elle et ce fut peut-être un mariage blanc. Marié ou pas, pour lui, quelle différence ? Et pour elle, un nom qu'elle peut arborer, c'est sans doute mieux que rien du tout...
Ce n'est qu'une supposition. M. Saurin est mort en 1781, avant le séjour d'Emilie à Viterbe. Elle pouvait donc se dire "veuve", comme elle s’était dite "mariée". On doit pourtant ajouter que Saurin possédait une femme, tout à fait légitime celle-là, amie de Chamfort. Quand, en 1793, le moraliste en porcelaine qui avait appelé la République de tous ses voeux d'enfant gâté, se tira une balle dans la tête pour échapper aux terroristes, Mme Saurin fut une des femmes charitables qui vinrent soigner l'écervelé. Le farouche moraliste était l'amant de Mme d'Amblimont, la "petite chatte" de Mme de Pompadour : on ne saurait, au XVIIIe siècle comme de nos jours, réformer la société sans s'être acquis, au préalable, une confortable situation mondaine.
Saurin a écrit une foule de pièces de théâtre, toutes plus oubliées les unes que les autres. Elles empruntent un peu à tout le monde, de l'antiquité aux romans anglais. De cette grosse production il ne reste qu'un seul vers - que tout le monde connaît -, sans pouvoir nommer son auteur. C'est celui qu'il fit inscrire, à l'Institut, sous le buste de Molière :
"Rien ne manque à sa gloire, il manquait à la nôtre."
En 1765, l'académicien Saurin, avocat au Parlement habitait "rue Neuve des Petits-Champs, vis-à-vis la rue de Louis-le-Grand." Ce qui complique le problème, car quand Gentil-Bernard parle de la "rue des Petits-Champs", on ne sait s'il désigne M. de Saint-Jullien, le banquier ami d'Emilie, ou Saurin, son mari supposé...
Chamfort montre le caractère réservé, suffisamment rassis et pour tout dire normand de M. Saurin. Ayant quelques soupçons sur la droiture de l'historien Foncemagne, qui édita le "Testament Politique" de Richelieu et mourut fort âgé (85 ans), Chamfort interroge Saurin, camarade de Coupole de M. de Foncemagne. "Je lui demandai s'il l'avoit connu particulièrement ? Il me répondit qu'oui. J'insistai pour savoir s'il n'avoit jamais rien eu contre lui ? M. Saurin, après un moment de réflexion, me répondit : "Il y a longtemps qu'il est honnête homme." Je ne pus en tirer rien de positif, sinon qu'autrefois M. de Foncemagne avoit tenu une conduite oblique et rusée dans plusieurs affaires d'intérêt."
"Il y a longtemps qu'il est honnête homme!" Voilà qui est exquis. Quel chef-d'oeuvre d'indulgence, nuancée de doute bien élevé ! On ne parle plus comme ça, de nos jours.
Portrait physique et moral d'un jouisseur
C’est aux habitués des dîners de Madame Geoffrin, rue Saint-Honoré, qu'il faut demander des nouvelles de Gentil-Bernard. D'abord le peu respectueux Grimm, qui, ô surprise, nous fait un portrait très nuancé du poète : "M. Bernard, avec la plus grande douceur dans le caractère et la plus grande circonspection dans la conduite, s'était fait peu d'amis, par la raison même qu'il n'avait jamais eu le courage ou l'imprudence de se faire un seul ennemi. En se bornant à l'existence d'un homme aimable, il semblait attendre de la société tout son bonheur, et cependant il faisait assez peu pour elle. Sa conversation était trop réservée pour être intéressante. Quoique son imagination fut naturellement agréable, elle ne paraissait ni brillante ni facile ; dans sa pétulance même, elle conservait quelque chose de maniéré, soit qu'il eût reçu de la nature une âme assez froide, ou qu'il l'eût rendue telle, à force d'art ou d'habitude. On eût dit qu'il avait subordonné tous ses sentiments, toutes ses passions, à cet esprit de galanterie qui est le caractère dominant de tous ses ouvrages. Peut-être n'y eût-il jamais philosophe aussi conséquent, aussi fidèle à ses principes que lui. Son épicurisme avait un ensemble admirable, une marche plus soutenue, plus régulière que le stoïcisme d'Epictète ou de Caton. Il avait arrangé sa manière d'être comme on arrangerait le plan d'un opéra. Il avait préparé des fêtes pour chaque saison de la vie, et trouvé le secret merveilleux de cueillir partout des fleurs et de les cueillir sans épines. Peu d'hommes ont été mieux traités des femmes, et peu d'hommes ont su jouir de cette faveur avec moins de trouble et de peine ; cependant jamais homme n'eût moins de fatuité."
Autre habitué du salon de Mme Geoffrin, et autre littérateur, Marmontel, de quinze ans plus jeune que Bernard, le dépeint d'une plume assez cruelle : "C'est une chose singulière que le contraste du caractère de Bernard avec sa réputation. Le genre de ses poésies avait bien pu dans sa jeunesse lui mériter le surnom de Gentil, mais il n'était rien moins que gentil quand je l'ai connu. Il n'avait plus avec les femmes qu'une galanterie usée ; et quand il avait dit à l'une qu'elle était fraîche comme Hébé, ou qu'elle avait le teint de Flore ; à l'autre, qu'elle avait le sourire des Grâces ou la taille des Nymphes, il leur avait tout dit. Je l'ai vu à Choisy, à la Fête des Roses, qu'il y célébrait tous les ans dans une espèce de petit temple qu'il avait décoré de toiles d'opéra, et qui, ce jour-là, était orné de tant de guirlandes de roses que nous en étions entêtés. Cette fête était un souper, où les femmes se croyaient toutes les divinités du printemps. Bernard en était le grand prêtre. Assurément, c'était pour lui le moment de l'inspiration, pour peu qu'il en fut susceptible : eh bien ! Là même, jamais une saillie, ni d'enjouement, ni de galanterie un peu vive ne lui échappait ; il y était froidement poli. Avec les gens de lettres, dans leur gaîté, même la plus brillante, il n'était que poli encore ; et, dans nos entretiens sérieux et philosophiques, rien de plus stérile que lui. Il n'avait, en littérature, qu'une légère superficie ; il ne savait que son Ovide. Ainsi, réduit au silence sur tout ce qui sortait de la sphère de ses idées, il n'avait jamais un avis, et sur aucun objet de quelque conséquence, jamais personne n'a pu dire ce que Bernard avait pensé. Il vivait, comme on dit, sur la réputation de ses poésies galantes, qu'il avait la prudence de ne pas publier. Nous en avions prévu le sort, lorsqu'elles seraient imprimées : nous savions qu'elles étaient froides, vice impardonnable, surtout dans un poème de l'art d'aimer ; mais telle était la bienveillance que sa réserve, sa modestie, sa politesse, nous inspiraient, qu'aucun de nous, du vivant de Bernard, ne divulgua ce fatal secret."
C'est donc bien d'un coup de pied de cet âne de Marmontel qu'il s'agit, Bernard mort... Et quel portrait, d'un fiel bien serré, d'un vitriol justement appliqué, d'un homme de lettres à un confrère ! Sous une apparence sensée et mesurée, que les vacheries sont finement amenées ! "Il n'était rien moins que gentil... Galanterie usée... Jamais une saillie... Froidement poli... Stérile même !" La légère superficie en littérature est, on l'a vu, toute entière de la main de Marmontel : Bernard possède des traces évidentes de La Fontaine, Théophile, Saint-Amant, Boileau, preuves d'excellentes lectures et d'une bonne mémoire, car certains vers sont des pastiches. Pourtant sire Marmontel nous le dit : Bernard était une bûche, il ne pensait à rien. Il ne faisait pas partie du petit clan bafouilleur des philosophes. Il vivait sur la réputation de poésies qu'il avait malgré sa bêtise, la prudence de ne pas publier. D'ailleurs Marmontel l'avait prévu : l'impression serait un four, qui ferait enfin justice de ce galapiat.
Plus mesuré, et à coup sûr plus juste que le portrait de l'homme de lettres, celui de Bernard par le Prince de Ligne, un mondain. Il juge Bernard à sa vraie mesure :
"J'ai beaucoup vécu avec ce Gentil-Bernard, qui ne l'était ni de figure, ni de manières, ni même d'esprit, car il y a plus de grâce, d'esprit et de goût dans ses vers que de gentillesse, qualité qui suppose de l'abandon, de l'enfance et de la gaîté, trois choses qui lui manquaient... Ce nom de gentil m'a toujours fait rire... C'était un grand, assez gras, beau, brun, aimable, facile, complaisant, homme de bonne compagnie, aimé de tout le monde, ne faisant ni esprit ni compliments, bien gourmand et lisant à merveille son Art d'Aimer. »
Ce portrait équitable par le Monsieur de Norpois de l'époque est certainement ce que nous avons de plus juste sur notre poète. C'est un Français typique du XVIIIe siècle, comme le voyaient les féroces et jaloux Hogarth, Gillray et Rowlandson, encore si proches de la barbarie saxonne. "Monsieur François": la race en a disparu entre 1789 et 1815, définitivement. Nos lointains ancêtres, en cela très différents de nos masses robotisées, mécanisées et atomisées, avaient mis leur génie dans leur existence. Une existence légère et facile. C'est là qu'est la poésie du XVIIIe siècle, la dernière époque avant le Déluge. Dans ses tableaux, ses vêtements, ses bijoux, ses gravures, son mobilier. C'est un art aimable et pompéien, un art de vivre qu'ont recouvert les cendres de la Révolution. Sans doute est-ce pour cela que nous ne comprenons pas grand chose à ces gens : leur planète n'était pas la nôtre.
Il manquait, à tous ces portraits masculins, un crayon tracé d'une main féminine. C'est le plus indulgent, et même le plus flatteur. Il est d'autant plus étonnant qu'il provient, non d'une des multiples danseuses amies de Gentil-Bernard, mais d’une dame assez austère, pilier de la Sainte Religion, dont les mémoires, vrais ou faux (mais j'incline, vu l'abondance des détails, à les croire en bonne partie vrais), ont fait les délices de la société cultivée en 1835 et après : les Souvenirs de la Marquise de Créquy. Si elle est pieuse, la marquise n'est nullement bégueule, et visiblement, dans les limites du raisonnable elle a été séduite par notre poète. Voici son portrait : mieux que ceux de MM. Grimm, Marmontel et du Prince de Ligne, parties prenantes en tant qu'hommes, il nous fera percevoir le charme indéniable que Gentil-Bernard exerçait sur les femmes :
"Je vous parlerai présentement d'un personnage dont je ne vous ferai pas un grand éloge et pour qui je vous demanderai votre indulgence. Désiré Bernard, surnommé le Gentil, était un beau garçon robuste comme un chêne et fleuri comme un rosier ; il était franc comme un jonc et doux comme un bon fruit. Mais il était toujours ce qu'on appelle entre deux vins, ce qui ne l'empêchait pas de garder une contenance et de rester dans une mesure parfaite, et ce qui lui donnait seulement je ne sais quel air indifférent ou préoccupé qui ne lui messieyait pas du tout, bien loin de là. Il avait servi sous les ordres de votre grand-père en Italie, et c'était nous qui l'avions fait nommer Secrétaire-Général des Dragons, ce qui lui valait 12 000 livres de rente, avec un logement sous la Galerie du Louvre et l'habit d'officier. Il avait pris toutes les apparences et les habitudes de la meilleure compagnie, ce qui ne l'empêchait pas d'aller souvent dans la plus mauvaise... Il avait eu des succès inconcevables, autant pour la qualité que pour la quantité ; mais la vanité ne pouvait rien du tout sur sa discrétion, et quand ses amis les dragons l'entreprenaient sur ses bonnes fortunes, il s'en impatientait et se débattait comme un diable. Il avait du caractère de M. de Létorières et de la tournure de M. de Lauzun, mais en plus naïf et plus solide. Je n'ai jamais vu que lui qui fut parfaitement heureux de sa position sociale et pleinement satisfait de sa fortune. Il n'était pas, disait-il, assez pauvrement petit pour ne pouvoir approcher des grands, ni assez grand pour ne pouvoir s'associer avec les plus petits. « Je suis deux fois plus heureux qu'un grand seigneur ou qu'un petit bourgeois, par la raison que j'ai deux facultés, deux cordes à mon arc, et parce que je vis double », me disait-il un jour ; il y a du plaisir et de l'intérêt pour moi dans la confiance et la familiarité des petites gens : c'est, pour les émotions du coeur et le repos de l'esprit comme une excursion champêtre ; et si la fatigue me prend, je monte en voiture : j'ai l'honneur de venir vous faire ma cour, madame, et j'ai celui de me trouver chez vous côte-à-côte avec Mgr le Duc de Penthièvre et Mme la Landgrave de Hesse. Il n'est rien de tel que de changer de côté, pour éviter la fatigue et l'engourdissement.
Il avait été l'intime ami de Mme de Pompadour avant sa faveur auprès de Louis XV ; et, si elle ne l'eût pas fait nommer bibliothécaire du roi en son château de Choisy, personne ne se
serait jamais douté que Gentil-Bernard eût été connu d'elle. Il a fait des poésies délicieuses et n'a jamais fait imprimer aucun de ses ouvrages, (à l'exception de son opéra de Castor et
Pollux, attendu que la chose était d'ordonnance et de nécessité rigoureuse). Il avait refusé d'entrer à l'Académie Française en disant qu'il
n'avait aucun titre pour établir et justifier cette prétention-là. Il n'a jamais voulu me lire son poème de l'Art d'Aimer, qu'il a gardé manuscrit jusqu'à sa mort. La philosophie de ce bon enfant
(c'est le mot propre) ne l'avait pas pourtant empêché de tomber dans une décrépitude anticipée. Toutes les femmes le reprochaient à Bacchus et tous les hommes s'en prenaient à Vénus. Comme je n'étais ni homme ni femme, j'en accusais l'un et l'autre."

LETTRES DE GENTIL-BERNARD
ET DE THEODORE DE LASCARIS
A EMILIE DE PORTOCARRERO
Entre 1757 et 1764, Gentil-Bernard écrit plus de cent lettres et billets à Emilie, ce qui montre un sentiment plus constant qu'on n'aurait cru chez ce poète réputé érotique, et donc, soi -disant, volage. Les billets, dont aucun n'est daté ni signé, ont trait à des invitations, de menus détails de la vie quotidienne dont nous sommes aujourd'hui si friands. Où, et chez qui Emilie et Gentil-Bernard, son aîné de 25 ans, se sont-ils connus ? Mystère. Dans quelle société ce poète incroyablement arrivé et cette fille de sang noble mais bâtarde de Grand d'Espagne se sont-ils rencontrés ? On ne sait. Sans doute a-t-elle admiré les relations qu'il pouvait avoir, et lui, en bon snob, l'extraction quasi-royale de son amie. Mais ce n'est pas suffisant. Il y a le sentiment. Certainement Emilie ne fut pas la seule à en inspirer à ce typique poète de cour. Mais aucun d’une telle qualité, qui allie une tendresse quasi paternelle aux aspirations sociales. Gentil-Bernard lui écrit avec constance pendant des années, semaine après semaine. Il se plaint qu’elle ne réponde pas assez, ou pas assez vite. Il s'inquiète de sa santé, de l'avance de son affaire. Pendant ses recherches de paternité en Angleterre, il est plein d'une tendre sollicitude. Emilie est certainement la seule femme qui a su fixer ce papillon, amateur de danseuses et de bien plus minces nymphes de coulisses. C'est une jolie référence.
Furent-ils amants ? Certainement. Des passages de lettres "Ma belle amie que je baise depuis la pointe du toupet d'en haut jusqu'à l'extrémité de celui d'en bas inclusivement" ne laissent là-dessus aucun doute. Mais peut-être Emilie n'a-t-elle pas beaucoup de tempérament. Elle est souvent malade, nerveuse. Quand elle retrouve sa mère : "Je vais attendre avec autant d'impatience que de curiosité l'histoire de la reconnaissance et le dénouement de cette pièce compliquée" lui écrit le poète, qui ajoute, sceptique : "Je crains que l'intérêt ne roule que sur vous..."
BILLETS PARISIENS
"Il ne m'a pas été possible, belle Fanfan, d'aller vous faire ma cour : j'ai été tout bêtement malade pendant un jour. Je me porte aujourd'hui aussi bien que le beau temps et j'aurai le plaisir d'aller vous voir aujourd'hui ou demain.
Je vais travailler à placer votre protégé, qui me parait un bon garçon, car nous restons encore quelque temps fraternellement. Je vous embrasse avec la force d'un Loulou."
*
"On vient à bout de ce qu'on désire, et de ce qui fait plaisir. Je serai libre ce soir, ma chère amie, et je me suis arrangé pour aller passer la soirée avec vous, c'est à condition que vous me la rendrez quelque jour, je vais dîner à la campagne, et je reviendrai à la ville avec plus de plaisir puisque je vous y verrai. Bonjour à l'aimable et sensible Emilie."
*
"Je voudrais bien, belle et chère amie, pouvoir concilier mes devoirs et mes plaisirs ; j'ai des affligés et des malades à garder. Il faut que je dîne avec eux. Mais à 4 h. je puis être libre, passer au faubourg, (1) aller faire un tour de promenade, faire manger de l'herbe aux toutous et ramener Madame chez le Père Bern. R. Voilà ce que je me propose pour ne pas vous perdre et pour reconnaître les attentions aimables de ma belle amie que je baise depuis la pointe du toupet d'en haut jusqu'à l'extrémité de celui d'en bas inclusivement."
________________
(1): Faubourg Saint Germain. Le billet peut être daté entre 1755 et 1757, Madame étant Marie-Jeanne-Olympe de Bonnevie, qui mourut cette année-là. Elle n'avait été que deux ans duchesse de Coigny.
"Vous vous adresséz, belle amie, à un mauvais trésorier : je n'ai pas un brin d'or chez moi. Je viens d'envoyer à la poste, où l'on n'a pu m'en donner parce qu'ils n'en ont jamais à la fin du mois. Je fais boursiller dans la maison. Si je ne vous envoie que 25 louis, c'est que je ne puis en avoir davantage, pardonnez moi de ne faire que la moitié de ce que vous désirez, lorsque je voudrais pouvoir surpasser vos désirs. J'ai toujours ma douleur dans le côté qui ne m'inquiète pas mais qui me tracasse. Je ne pourrais pas vous aller voir aujourd'hui. Je vous embrasse mille fois. Pour plus de sûreté, je vous renverrai par Sigur la somme que vous m'avez adressée. J'ai été merveilleusement surpris de voir arriver votre homme chargé comme le valet d'un Fermier Général. Je vous fais excuse si l'injustice du sort m'empêche de vous considérer comme une femme opulente, au moins ne peut-il m'empêcher de vous voir comme une femme fort aimable."
*
"Je suis arrivé trop tard hier de Choisy pour aller voir Emilie. J'envoie savoir de ses nouvelles, si elle est chez elle aujourd'hui je l'irais voir sur le soir, et demain matin nous pourrions aller faire notre tournée à la foire. Il fait trop vilain aujourd'hui pour cela.
J'envoie le chocolat tel qu'on le désire : à une bonne vanille, et du meilleur faiseur. Je souhaite qu'il restaure ma belle convalescente, et qu'il serve à rétablir entièrement la santé qui m'intéresse le plus au monde. "
*
"J'enverrai demain mon carrosse à 10 h. à Madame du Saurin. Quoique mes chevaux n'aiment pas la musique, ils seront fort aises de lui procurer ce plaisir. En la priant seulement de les renvoyer à une heure chez eux pour leur dîner.
Mille respects aux dames. On fera tout ce qu'on pourra pour souper demain avec elles. On n'est pas absolument sûr de le pouvoir, mais on en a grande envie. "
*
"Voilà notre dépôt retrouvé ; vous ne m'en enverrez plus, je vous prie, de la même manière. Ceux là m'ont coûté trop d'inquiétude ; je m'en souviens, et je ne veux plus trembler pour vos jours. Ménagez bien votre santé, faites tout ce qu'il faut pour la bien rétablir, et je prierai le Ciel qu'il fasse aussi tout ce qu'il faut pour vous rendre heureuse. Bonjour, belle Emilie, je vous embrasse. "
*
"J'ai vérifié sur l'Almanach ce que désire savoir la belle Emilie. En voici la note: elle est sûre. Je vais m'informer de l'endroit où l'on trouve les bonbons méringués propres au rhume, pour en avoir. Je voudrais être instruit des nouvelles de ce rhume qui me fait de la peine. Bonjour, belle dame, on ne vous aime pas plus que je fais."
*
"Vous ne donnez pas des commissions aisées à faire, ma belle amie, aussi on a le déplaisir de ne pouvoir exécuter vos ordre. J'ai été moi-même courir toute la Rue au Fer : point de ruban de cette espèce. On m'a renvoyé chez dix marchands de Modes qui n'en ont pas plus que dans l'oeil, ni en fil, ni en soie ; il faudrait faire monter un métier exprès pour en avoir, et je crois que ce n'est pas la peine, d'autant que j'ai le mauvais goût de penser que ce mélange de ruban et de taffetas découpé ne sera pas bien joli ; pardon de l’audace.
Je ne puis vous envoyer l'Histoire Ancienne à présent, parce que mon homme ne l'a pas. Je chercherai à l'avoir, si je puis, ailleurs. En attendant, je vous envoie une brochure qui parait d'hier, je ne vous réponds pas de son excellente bonté ! Telle qu'elle est, vous me la rendrez quand vous l'aurez lue ; faites dire à mon homme de vos nouvelles. Je crains de n'avoir pas le temps d'en aller savoir aujourd'hui, par moi-même. Ayez bien soin de votre santé, vous savez à quel point elle m'intéresse. Bonjour, belle et très aimable Emilie.
J'écris mal parce qu'on me frise et qu'on me tire. Haïe! Haïe !”
*
"Je reçus hier votre lettre trop tard, ma belle amie, pour pouvoir exécuter vos ordres ; voilà le paquet que je vous renvoie. Le paquet et moi avons eu peur hier du mauvais temps. C'est pourquoi vous n'avez eu l'un ni l'autre. J'espère être plus heureux aujourd'hui. Mon rhume va mieux. J'apprends aussi que ma belle amie fait des progrès consolants : j'en suis comblé d'aise, parce que rien ne m'intéresse plus que sa santé et son bonheur. Mes respects à Madame Dalmés."
*
"Je n'ai pu vous aller voir hier, belle Emilie, parce que le petit Coigny a été fort mal, et il l'est encore. J'ai été toute la nuit debout ; j'ai beaucoup d'inquiétude d'un enfant très cher, qui afflige beaucoup sa famille. Je ferais ce que je pourrais pour aller vous voir un moment aujourd'hui. J'enverrais chercher ce que vous demandez, et vous l'aurez. Je suis bien aise d'apprendre que vous avez bien dormi, l’intérêt que je porte à votre santé égale mon amitié. " (1).
__________________
(1): Ce billet doit être postérieur à 1757, le petit Coigny dont il est question pouvant être un des deux fils du duc : François-Casimir, né le 2 septembre 1756, ou Pierre-Auguste, né le 9 septembre 1757.
*
"Je rends grâce à M. Nerel des nouvelles qu'il m'a donné, et à la malade de ses présents. J'ai été bien fâché de ne pouvoir passer chez elle hier. Je pourrais être deux heures avec elle à côté de son lit, et je ne veux qu'un potage. Je l'embrasse mille fois."
*
"Depuis que M. de Nerel est sorti de chez moi, belle amie, mon cocher est venu me dire que ma nouvelle jument a rendu ce matin deux javardeaux et que je ne pourrais pas m'en servir demain. Je vous en préviens pour que vous ne comptiez pas sur mes chevaux. Je suis très fâché de ce contretemps, qui me privera encore aujourd'hui du moyen de vous aller voir. Si votre projet subsiste pour demain, et si vous pouvez passer chez moi, vous auriez le petit déjeuner tel que vous le voudriez, et les tendresses d'un ami telles que vous pourriez les désirer. J'embrasse la belle Emilie."
*
"Bonjour à ma chère Emilie. Je ne say si je pourray le luy donner moy même ce matin, ayant une visite à faire au Cardinal de Bernis à qui j'ay affaire. J'espère que le souper projetté sera toujours pour ce soir, je ne pourrois pas demain ni après demain, et je serois désolé de ne pas profiter de l'honneur que me veut faire la jeune excellence (1), et du plaisir de passer une soirée avec cette Emilie que j'aime et que j'honore tant.
Faites moy savoir ou, quand, comment il faut vous prendre. Ou sil faut enlever Madame Dalmés que j'assure de mon respect. »
______________
(1) : La jeune excellence : ce billet doit être de 1756-57, Bernis ayant été nommé Ministre des Affaires Etrangères de Louis XV au début de la Guerre de 7 ans. Né en 1715, il avait 41 ans.
*
''Mardi matin.
Je passay hier chés vous belle Emilie en arrivant de Choisy. Je n'ay pas eu le bonheur de vous rencontrer aujourd'huy, il m'est impossible de vous voir, je vais à la campagne. Je compte demain rester à Paris. Je souperay chés vous ou vous souperés chez moy, si vous estes libre. J'iray toujours vous voir après diné. Faites moy savoir par un mot vos intentions, il faut bien que nous parlions de nos affaires. Les vôtres sont plus importantes que les miennes, je vous assure qu'elles m'intéressent aussi davantage. Ne doutés pas de mes sentimens durables et sincères, mettés les à l'épreuve c'est tout ce que je vous demande, j'embrasse ma chère Emilie."
*
"Bonjour à la belle Emilie. Voilà de quoy l'occuper aujourdhuy je ne pourray pas partager ses travaux, mes affaires m'écartent du lieu de sa demeure. Demain je seray plus heureux.
J'entends dire que Toutou est encor malade. Sil continue à l'être il faut voir un médecin de chiens. On vient d'en donner une adresse à La Jeunesse. Sauvons toutou. Et Dieu garde tout ce que vous aimez, aussi tout ce qui vous aime."
*
"Voilà ma belle àmie le résultat de vos idées, je désire que vous le trouviés bien rendu. Vous estes en état dy ajouter ce que vous jugerés convenable. Je vous remercie de l'avis, et bien fâché de ne pouvoir vous prêter mes chevaux demain. Je pars pour Choisy. Je reviendray jeudy au soir et tacheray de vous voir. J'embrasse de tout mon coeur la charmante Emilie.''
*
Où apparaissent les amours.
Le roman d'Emilie et deThéodore de Lascaris-Vintimille,
jeune homme pauvre et gentilhomme de fortune
Emilie voyage. Avec son tuteur, M. de Flobert, et en Italie, dès 1757. Elle fait quelque part connaissance d'une dame du meilleur monde : Madame Lascaris-Vintimille de La Brigue. Les Lascaris descendent d'empereurs grecs du XIIIe siècle : les deux Théodore Lascaris qui régnèrent sur Constantinople. Leurs descendants, on s'en doute, n'en sont pas peu fiers. Mais voilà : nous sommes au XVIIIe siècle, et l'Empire de Constantinople est tombé depuis belle lurette aux mains des Turcs. Madame de Lascaris est une veuve, fort désargentée, d'une branche de cette illustre famille qui, si j'ose dire, bat de l'aile. La pauvreté la force à vivre dans un couvent d'Asti. "Pour des raisons économiques, il y a vingt jours que je ne suis pas sortie de ma retraite" écrit-elle en mai 1758 à Emilie, déjà retournée à Paris.
Si elle a une fille déjà casée, Madame de Lascaris est bien en peine de son jeune fils, Théodore, 18 ans, à qui elle ne sait, faute d'appuis et de fortune, quel parti faire prendre. Madame a bien un beau-frère, évêque de Toulon, Alexandre Lascaris de Vintimille, né en 1721 à Marseille, et qui sera sacré le 12 décembre 1759 à 38 ans - mais hélas c'est un ecclésiastique du genre bien connu : dénué de toute vaine charité. Loin de rien faire pour son neveu en difficulté, il sèmera sa route d'embûches. Monseigneur ne va quand même pas s'encombrer de ce morveux qui pourrait entraver sa carrière...
Rien à espérer, donc, à part des ennuis, du côté de cet aimable pasteur. Un autre membre de la famille, le Comte du Luc, depuis 1755 Colonel-Général des Dragons, qui habite à Paris rue et près la Fontaine Richelieu, parait mieux disposé envers le jeune homme, mais il est lui-même peu argenté et chargé de famille. Bref le jeune Lascaris n'a ni argent ni crédit, et ses puissants parents ont laissé tomber la pauvre veuve.
Elle se raccroche donc à Emilie comme à sa seule bouée de sauvetage. On sait que notre héroïne est proche de la famille des Crillon, qui compte des généraux et un abbé bien renté. Le Rouge ou le Noir : il y a quelque chose à faire d'un côté ou de l'autre. Justement le marquis de Crillon a été fait lieutenant-général des Armées du Roi le 1er mai 1758. On devrait aller voir ce qui se passe au vieil hôtel Fieubet, face au Couvent des Célestins.
Dans son bavardage, Mme de Lascaris donne à Emilie des nouvelles de la comtesse Gioia d'Asti, des dames de la maison de Courtandon et de Castagnole. Elle sait qu'elle touche là un point sensible. Emilie est secrètement flattée que des femmes titrées fassent appel à elle. Les Lascaris, descendants d'emperaires au poing doré, en la prenant comme médiatrice, la rehaussent à ses propres yeux. Voir quelqu'un dans une situation plus critique que la leur incite généralement les humains à la pitié. Surtout, dans le cas des snobs, si cette personne est du rang le plus distingué. C'est le cas pour le jeune Lascaris et sa maman. "Je compte beaucoup sur vous et sur Mr de Flobert ; du côté de mon frère je n'ai pas lieu d'espérer grand chose" écrit la veuve. L'évêque "a passé ici, je ne l'ai pas vu ; je lui ai écrit à Rome, il m'a répondu, mais sans prendre bien à coeur ma triste situation, me disant qu'il ignorait que je fusse à Asti ; ainsi ma chère je vous prie de ne pas m'oublier, et non plus mon pauvre fils." Dès que le jeune homme aura un emploi, elle se retirera dans quelque couvent "ou chez quelque princesse ; il suffit que je puisse m'assurer de quoi vivre pour le reste de mes jours."
Peu à peu la protectrice de 23 ans va se prendre d'affection, puis d'amour, pour son protégé de 18. Le roman durera six ans, jusqu'en fin décembre 1764. Par M. de Flobert et certainement par la puissante famille des Crillon, Emilie fait entrer le jeune Lascaris au régiment Royal-Italien, un des nombreux corps étrangers de la Royauté, qui exista plus de cent vingt ans, de 1671 à 1791, soit du règne de Louis XIV à la fin de celui de Louis XVI. Emilie ne pouvait évidemment pas prévoir que son protégé en deviendrait le dernier colonel : dans les dernières lettres, on verra comment ce régiment fut dissous à la veille de la Révolution, et remboursé par le Roi à Lascaris.
Joli régiment pour uniformologues que ce Royal-Italien. Le drapeau en était, comme tous, à croix blanche, insigne de la nation française, mais semée de fleurs de lys ; et les quatre cantons coupés de rouge et de marron. Ce rouge et ce marron insolites sont d'ailleurs la couleur de l'uniforme : marron à parements, gilet et culotte rouges jusqu'en 1750. A partir de cette date, c'est un habit blanc à revers et plastron bleu de ciel, boutons de cuivre, une bordure d'or au chapeau noir. En 1776 l'uniforme change encore, pour un panachage peu gracieux : bleu de ciel foncé, à plastron jonquille et collet rose. Le Royal-Italien portait dans l'infanterie le n° 65. A sa dissolution, en 1791, il fut transformé en bataillons de chasseurs. On y trouve effectivement des noms italiens, mais aussi multitude de patronymes corses, l’île étant française depuis 1768.
Quoiqu'il en soit, rien de plus naturel que le jeune Lascaris serve sous ce drapeau. Car il existe toujours en Provence plusieurs châteaux ruinés de sa famille : à Gorbio, au-dessus de Menton ; à La Brigue. Celui de Tende "construit à la fin du XIIle siècle, et démantelé en 1692 : il en reste un énorme pan de muraille, haut de 20 mètres, qui semble défier les lois de l'équilibre et se dresse au-dessus d'un curieux cimetière en terrasses étagées” (Guide Bleu de la Provence). Ces maisons aériennes, ouvertes à tous les mistrals, et déjà dignes, à l’époque, d'un Cadet Roussel, comptent parmi les dernières acquisitions du territoire français : le Comté de Nice nous revint, comme on sait, par plébiscite en 1861, et les vallées de Tende et de Brigue en 1947. Mais les Lascaris n'avaient pas attendu ces ratifications pour être Français de coeur.
Roman d'amour dans un climat froid : malgré le souvenir qu'a laissé le XVIIIe siècle sur les boîtes à bonbons, il n'était pas plus hospitalier qu'un autre. Qu’Emilie et Théodore soient des Européens méridionaux ne change rien à l'affaire : ce n'est pas là qu'on verra les eruptions volcaniques de Carmen. Nous sommes dans une société ultra policée, pas chez les Gitanes qui roulent des cigares freudiens sur leurs cuisses. Roman avant tout, de la solitude : Emilie est une bâtarde, de bonne maison mais bâtarde tout de même, élevée sans mère par les religieuses de Pontoise, puis dans une maison exclusivement militaire. Le comte de Lascaris, dont nous savons par les notices généalogiques qu'il se prénommait Théodore-Honoré, comme tous les mâles de sa famille (ce qui ne nous avance pas beaucoup...) est un tout jeune homme, fils de veuve, élevé dans la pauvreté. Entré dans ce Royal-Italien il y végète comme il peut : toutes les grâces qu'il reçoit viennent d'Emilie. Comme ces deux personnes jeunes et solitaires sont loin de l'image si menteuse d'un siècle poudré, décadent, qu'on nous présente rituellement depuis l'immortelle Révolution ! Ce sont les modes, les gravures, les objets de cette époque qui nous font illusion : les contemporains souffraient tout comme d'autres humains ailleurs et dans d'autres temps.
Entre nous soit dit, Emilie Portocarrero n’est pas très avisée. Elle passe sa vie, comme le chien de La Fontaine, à lâcher la proie pour l'ombre. Une plus raisonnable aurait sauté sur l’occasion de ce mariage avec son amoureux. Bien né, visiblement honnête, respectueux, Lascaris la courtise pour le bon motif. Il lui doit tout et il le lui dit. Il aurait fait un mari charmant. En se montrant véritablement généreuse et désintéressée, c'est-à-dire en l'épousant, elle aurait assuré sa sécurité et son bonheur. Les Crillon et M. de Flobert auraient été ravis de la marier à quelqu'un dont ils pouvaient pousser l’avancement. Au lieu de quoi, elle s'avise d'aller passer des mois à Londres pour rechercher une mère hypothétique, qui s'est toujours souciée d'elle comme d'une guigne. Mieux que ça : quand elle l'aura retrouvée, ladite mère s'accrochera à ses basques... Tel est le Destin : si nous ne saisissons pas au vol le plus qu’il nous présente, nous serons forcés d'ingurgiter un moins que nous n'avons pas prévu... Du reste Emilie patauge à plaisir dans son destin : quand elle rentre de ce voyage londonien raté, elle ne trouve pas un moment pour aller voir le gentil Lascaris dans sa garnison de Mézières.
Enfin, elle va perdre sept ans en Espagne à rechercher une famille qui se moque d'elle comme de Colin-Tampon, et ne lui lâchera finalement les pesetas qu'avec les plus grandes difficultés... N'y a-t-il pas là une inconséquence flagrante, un manque de jugeote absolu ? Comme beaucoup de filles d'Eve, Emilie est persuadée que la sécurité est dans l'argent. Celui-ci la lui fera payer cher. Comment ! Elle possède, à quelques lieues de chez elle, un amoureux jeune, qui ne demande qu'à faire son bonheur, et elle court le monde en tout sens pour retrouver une mère d'occasion, et un demi-frère avare qui la voit arriver, en bon Espagnol, du plus mauvais œil !
Elle n'est pourtant pas sotte : coquette comme cent ans plus tard la Grande Duchesse de Gerolstein, Emilie s'avise d'un vieux stratagème pour connaître les sentiments de son Lascaris :
- Si une dame s'intéressait à lui, en tout bien tout honneur évidemment, que dirait-il ?
Aussi éculée que soit cette balançoire, elle marche...
Madame Lascaris de Vintimille à Madame de Saurin
Madame
Votre lettre, Madame, m'a fait un plaisir bien sensible, et si vous me favoriserez souvent de vos chères nouvelles, elles me consoleront en partie de la perte de votre aimable compagnie. Je connois assez votre bon coeur pour douter que vous oublier mes interets, aussi c'est en vous, et en Mr de Flobert, auquel je vous prie de faire mes respects, que j'ai mises toutes mes espérances, et de qui j'attend quelque soulagement à ma triste situation, vous priant instamment en tems et lieu propre, avec toute la chaleur, de parler pour moi au Personage en question, espérant qu'il ne se refusera pas à des intercesseurs aussi dignes, et que le Bon Dieu voudra bénir vos bons offices, et mes justes intentions, et moi ne pouvent autrement vous marquer ma recconoissance je prierez incessamment le Seigneur pour la prospérité et consolation de tous les deux. J'ai fait vos compliments à la Supérieure, à la Soeur Mo, et à toutes mes compagnes ; elles vous remmercient infiniment du votre gracieux souvenir, et m'ont chargée de vous offrir ses respects, et nous priont toutes bien de coeur pour un parfait rétablissement de votre santé, et je ne manquerez pas de dire au Médecin Argenta que vous n'avez pas oublié ses attentions et ses leçons. Il sera bien charmée d'aprendre que vous vous portez toujours mieux, ce de quoi je vous en fait mes congratulations. Pour moi grâce à Dieu je me porte assez bien, pourtant je ne fait pas d'exercisse, car pour des raisons oeconomiques il y a vint jour que je ne suis pas sortie de ma retraite.
A l'égard du Marquis Busca je vous direz ma très chère, que j'en scai aussi peu que vous, n'ayant rien fait jusqu'à cette heure comme je vous l'ai prédit. Pardonnez Madame si je vous détourne trop de vos affaires par ma longue lettre, mais puisque mon sort cruelle me sépare de vous, jéprouve un sensible plaisir à m'entretenir avec vous par lettre ; que le Seigneur en attendent vous bénisse autant que je le désire, et que vous mérité, continuéz moi votre chère amitié, et soyez persuadée que je suis telle que j'ai l'honneur d'être sans réserve
Madame
Votre très humble et très obéissante servante
Lascaris Vintimille de la Brigue
Je vous prie de mes saluts à Antonia. (1).
Asti ce 21 May 1758.
______________
(1): La femme de chambre d'Emilie.
Madame
J'ai retardé jusqu'à présent à répondre à votre chère lettre, Madame, à cause de l'absence de la Comtesse Zoja d'Asti, parce que sa fille a été bien mal à Turin,laquelle pourtant s'est rétablie, étant de retour depuis quelques jours ; ainsi je ne veux plus retarder à vous écrire, et vous remercier en même tems des bontés que vous avez toujours pour moi, et le Bon Dieu vous en donnera la récompense, le prient bien de bon coeur pour le parfait rétablissement de votre santé, et pour la satisfaction de vos désirs, et dans vos affaires, desquelles je vous prie de m'en donner des nouvelles pour ma consolation.
Je vous rends mille grâces des soins que vous vous donnez pour mon fils, je compte beaucoup sur vous et sur Mr de Flobert. Du côté de mon frère, je n'ai pas lieu d'espérer grande chose, il a passé içi, je ne l'ai pas veu, je lui ai écrit à Rome, il m'a répondu, mais sans prendre bien à coeur ma triste situation, me disant qu'il ignorez que je fusse à Asti. Ainsi ma Chère je vous prie à ne pas m'oublier, et non plus mon pauvre fils. J'écriré pour celà Mr de Flobert n'adressant pas la lettre à vous, de peur que vous ne l'aprouviez pas, et mon fils en fera de même. Joignez y de grâce vos instances aux miennes, et je me flatte d'avoir la consolation avant mourir de voir mon fils établi. Quand il y aura de l'apparence de celà, je vous prie de me le faire scavoir, et même je veut que vous me donniez votre conseil sur ce que je pense d'aller accompagner mon fils à Paris, en cas qu'il aye de l'emploi, et puis je me retirerez dans quelque Couvent, ou chez quelque Princesse. Il suffit que je puisse m'assurer de quoi vivre pour le reste de mes jours.
*
J'aprend avec un sensible plaisir que vous vous portez mieux, et que les bains vous sont utiles, et le Médecin Argenta est bien charmé du meilleur état de votre santé. A l'égard de vos lettres soyez sure que je n'en ferez pas mauvais usage, ainsi continués moi cette consolation, et votre précieuse amitié, vous prient d'être persuadée que je ne cesserois pas d'être toute ma vie telle que j'ai l'honneur de me dire. Toute cette noblesse de votre connoissance vous fait ses compliments, et particulièrement la Maison de Courtandon, et Castagnole
Madame
Votre très umble, et très ob. Serv.
Lascaris de la Briga née Vintimiglia
Ce 30° Aoust 1758.
*
Asti ce 15 Xbre 1758
Vous ne devez pas douter, Madame, du sensible plaisir que me donnent vos nouvelles, et vôtres chères lettres, ni de l'empressement que j'ai à y répondre en vous témoignant toujour ma reconnaissance pour votre mémoire et bonté à mon égard. Vos reproches sont trop gracieux pour qu'ils me fassent de la peine, mais j'étoit beaucoup inquiète sur le sort de mes lettres dans lesquelles je vous prié instament à ne pas m'oublier, ni les interests de mon fils, n'ayant autre espérance et ressource que dans vos bons offices, et ceux de Mr Flobert, au quel je vous [prie] de faire agréer mes respects, et mes instances, ajfin qu'il m'aide dans ma triste situation à rapport de mon fils. Je supose, que vous aurez reçu des nouvelles de la Comtesse Zoja, ainsi il est inutile que je vous en donne, ayant eu de vos nouvelles d'elle. Je prends un sensible plaisir, aprennant que votre santé est bonne et je ne cesserois pas de prier le Bon Dieu pour la continuation. Continuez moi de grâce votre chère amitié, et en attendent des bonnes nouvelles de mon affaire, je vous offre les respects de toutes mes compagnes, et mes petits services me donnent l'honneur de me dire avec tout la considération
Votre très umble et obb. servante
Lascaris de la Briga.
*
Monsieur de Flobert, corsaire par erreur
Et dans tout ça, Monsieur de Flobert, direz-vous? Comme ses patrons, les Crillon, il monte en grade. Du temps qu'Emilie coquette avec son Lascaris, Louis XV fait de M. de Flobert un brigadier d'infanterie, le 13 avril 1759 : il s'agit d'accompagner, comme chef des troupes de débarquement, une escadre commandée par un célèbre corsaire d'une trentaine d'années : François Thurot, protégé du maréchal de Belle-Isle et de Madame de Pompadour. Thurot, lui, a fait ses preuves en s'évadant deux fois d'Angleterre et en captivant nombre de navires britanniques, mais voilà, c'est un pur roturier, et Monsieur de Flobert, dont on ne connait guère d'autres preuves que généalogiques, n'aime pas du tout être le subordonné du fils d'un maître de poste bourguignon, qui ne doit qu'à sa valeur d'avoir été fait capitaine à 20 ans... L'idée de Thurot est de débarquer en Irlande pour faire une diversion dans la guerre franco-anglaise. Son escadre est composée du Maréchal-de-Belle-Isle, de la Terpsichore, de l'Amaranthe, la Blonde, le Begon, le Faucon : 165 canons, 743 marins et 1 400 soldats d'infanterie, tirés des gardes-françaises et suisses, des régiments d'Artois et de Bourgogne, de volontaires irlandais et écossais. L’expédition appareille de Dunkerque le 15 octobre 1759.
Malheureusement, par la faute des éléments et de la mauvaise volonté des officiers nobles, furieux d'être soumis à un vil roturier, elle tourne vite au désastre. Le Begon coule, la Blonde, dans une tempête, est obligée de couler ses canons. M. de Flobert ne joue pas, dans la circonstance, un bien beau rôle : il menace Thurot de le mettre aux fers. Il devrait pourtant savoir que sur mer, il n'a rien à objecter aux ordres du chef d'escadre. Il y a des scènes déplaisantes, qui font le plus mauvais effet sur les équipages et l'infanterie : menacé, Thurot sort de sa cabine pistolets aux poings. Forcé de débarquer le 22 février 1760 en face de Carrickfergus (Irlande) Thurot fait des prodiges de valeur : on ne nous dit rien de M. de Flobert (1). Après un bon début, c'est de nouveau la mauvaise chance. Devant les Anglais, la Blonde et la Terpsichore désertent honteusement. A bord du Maréchal-de-Belle-Isle, après un combat acharné, Thurot, abandonné des officiers de terre, est frappé à mort. Il meurt dans les bras de sa maîtresse, miss Smith, fille d’un apothicaire londonien. Le "gallant and gentle Thurot" est entré dans la légende - en Angleterre, pas en France, où il est bien oublié -. Quand la mer eût rejeté son corps à Lucy Bay, cousu dans un drap rouge par sa maîtresse, il fut enterré à Kirkmaiden : on peut voir au musée d'Edimbourg son épée à poignée d'ivoire. Madame de Pompadour s'occupa de sa veuve et de leur petite fille.
Bref, l’expédition de Thurot sur les côtes d'Irlande échoua comme, une quarantaine d'années après, celle de Hoche, bien connue de nos jours par un roman à succès : l'Année des Français. L'échec dans l'opinion avait été assez retentissant : on l'attribuait, évidemment, à la favorite maudite : Madame de Pompadour. Vingt ans après, en 1779, un pamphlet assez ignoble de Théveneau de Morande, agent secret du Cabinet Britannique, "la Cassette Verte de Monsieur de Sartine", rappelle perfidement: "Plût au ciel que le peuple de France put oublier le nom de Thurot. Ce qu'il y a de pire, c'est que les Irlandois sont des étourdis, et quoiqu'ils nous invitent à leur faire visite, il ne seroit pas étonnant qu'ils nous prissent pour des ennemis aussitôt que nous serions chez eux." Théveneau de Morande est un espion à la solde de l'Angleterre que Beaumarchais se chargea de réduire au silence. Malheureusement, en France, on écrit souvent l'histoire avec l'opinion de nos ennemis, et l'héroïsme de Thurot est complètement oublié.
Et Monsieur de Flobert, le tuteur d'Emilie ? Il ne joue pas un bien joli rôle dans cette histoire. Provocateur, imbu de sa personne, et du titre provisoire de général qu'il ne doit qu'au fait d'avoir accompagné le brave Thurot, il rentra dans le néant à la suite d'une expédition qu'il avait su si bien transformer en désastre. "Il retourna en Espagne et y mourut" nous dit confidentiellement son seul biographe (2). Un point c'est tout.
_________________
(1) : L'Hermite de la Chaussée d'Antin a sur le débarquement de Carrick Fergus son opinion particulière: "Je m'embarquai sur un des vaisseaux de l'escadre destinée à parcourir les mers du Nord sous le commandement de Thurot, qui passait pour une créature du maréchal de Belle-Isle. M. de Flobert, qui commandait les troupes de débarquement, et qui croyait avoir à se plaindre du maréchal, fit de son mieux pour faire manquer l'expédition. Thurot et son conseil avaient décidé qu'il fallait opérer une descente à Belfast (en Irlande); mais Flobert, qui avait demeuré deux ans à Carrick Fergus, chez une jeune veuve anglaise dont il avait conservé un tendre souvenir, voulut à toute force effectuer le débarquement sur ce point, et cette considération fut cause, en grande partie, des désastres de cette campagne." (Le Chapitre des Considérations, 30 janvier 1813).
(2) : Article Flobert, Biographie Française, Letouzey et Ané, 1976 ; et lettre de Lascaris du 8 août 1763 à Emilie.
Mais cette petite phrase révèle un des désastres d'Emilie, qui essaya bien des années après de récupérer les sommes confiées, pour son éducation, à son protecteur. Il n'en restait rien. Monsieur de Flobert nous apparaît comme ça, au détour d'une tempête, dans des paquets d'eau de mer, avec sa perruque, sa longue-vue et sa croix de Saint-Louis si petitement gagnée ; et le temps d'une canonnade entre corsaires et goddams, il disparaît dans le brouillard où Thurot se fait tuer. Puis il étouffe la dot de sa pupille. Ce n'est pas très reluisant. Pour guère plus, de plus minces sires ont servi de modèle au Mac Orlan de l'Ancre de Miséricorde ou au Schwob des Vies Imaginaires (1).
Il me semble que j'ai retrouvé ce Monsieur de Flobert, dans les "Amours et intrigues du Maréchal de Richelieu." C'est cet officier dont le maréchal n'a eu qu'à se louer, en 1756, à la fameuse expédition de Minorque. Les mémoires disent, à propos de la prise du fort : "Le maréchal... se détermina à ne parler à personne de ce qu'il voulait faire ; il ne disait ce qu'il pensait qu'au seul [ici, un blanc] commandant de l'artillerie et du génie, qui venaient d'être fondus sous la même autorité, et qui se trouvaient réunis la première fois pour une opération militaire ; mais M. le Maréchal avait eu avec lui à Gênes cet officier..."
Or cet officier qui commandait le Génie pendant la campagne de Gênes, c'est bien M. de Flobert.
Pendant que son ex-tuteur guerroie, Emilie remporte une victoire : ses recommandations ont fait leur effet et son protégé, le jeune Lascaris, a obtenu une place à l’armée.
____________________
(1) : Voir l'histoire de François Thurot dans "Corsaires oubliés” de François Tuloup, Ed. Maritimes et d'Outremer, Paris 1970.
Madame,
Je serez une ingrate, quand je ne vous remmerciez pas des bontés, que je vient de recevoir par Mr de Flobert à l'égard de mon fils. Je vous assure que ma joie et ma recconoissance est sans bornes, ainsi je vous prie d'unir vos remerciements aux miens à Mr de Flobert, le supliant de vouloir me continuer sa grâce, et à mon fils particulièrement. Procurés moi en attendent quelquefois de vos chères nouvelles, et vous offrant les compliments de tous coeur, qu'il ont l'honneur de votre connoissance, je me dis sans réserve
Madame
Votre très Umble, obéis, et affect, servante
Lascaris Ventimiglia de la Briga
Asti ce 8° May 1759.
*
Madame et très chère amie
L'empressement avec lequel vous avez emploié votre crédit pour moi et pour mon fils, et l'amitié que vous m'avez toujours fait l'honneur de me témoigner, m'ont pénétrée d'une si grande reconnoissance et m'ont inspiré un si grand attachement pour votre aimable personne, qu'il me paroit qu'il y a déjà un siècle que je n'ai pas eu de vos chères nouvelles. Tout ce qu'il y a de gens de qualité tant à Casai qu'à Asti, qui savent avec quelle bonté vous vous êtes intéréssée, et comment vous avez réussi à procurer un établissement à mon fils, sont remplis d'estime et de vénération pour vous. Je me trouve depuis quatre mois à Nice, où je suis venue pour mettre mon fils en état de faire le voiage, et n'aiant en partant d'Asti demandé la permission que pour deux mois, je crains que quelque personne mal intentionnée ne donne quelque mauvaise tournure à mon voiage, et ne me fasse perdre la place que j'ai dans cette ville, laquelle, quoique peu avantageuse, ne laisse pas de m'être fort nécessaire dans mes besoins. Je vous supplie donc, ma chère Dame, de vouloir bien avec votre bonté ordinaire interposer vos soins auprès de Mr de Flobert, afin qu'il détermine Mr le Comte du Luc à me tenir parole. Je ne doute pas de la bonne volonté de l'un et de l'autre, mais je crains toujours les traverses de mes ennemis. Mr de Flobert et Mr le Comte du Luc m'écrivirent dernièrement que le départ de mon fils auroit lieu dans le mois de septembre, et comme nous sommes à la moitié du mois, j'avois d'abord résolu de récrire à Mr du Luc, mais craignant de me rendre importune, j'ai pensé qu'il étoit mieux que je m'adresse à vous et à Mr de Flobert de qui la bonté m'est connue, pour vous prier, si vous pouvez, de hâter le départ de mon fils, n'attendant pour celà que les ordres et le secours que le dit Mr du Luc m'a promis dans le cours de ce mois. Madame la Comtesse Gioia me charge de vous faire agréer ses complimens, c'est elle qui m'a envoié votre adresse. Je vous prie donc de me donner des nouvelles de votre santé qui m'est si chère, et de me faire savoir si Antonia est toujours bien avec vous. Faites lui, s'il vous plait, agréer mes complimens, ma famille vous prie d'agréer ses respects et particulièrement mon fils qui attend avec impatience l'heureux moment qui lui procurera l'honneur de vous assurer à vive voix des siens. J'attens avec impatience l'honneur de votre réponse, et j'ai l'honneur d'être avec le plus respectueux dévouement,
Madame et très chère amie
Votres très humble servante et très affectionnée amie
Lascaris Vintimille de la Brigue
Nice ce 15 7bre 1759
Dans la crainte qu’à la poste on ne prenne mes lettres, je vous prie de les adresser à ma fille. Son adresse est à Madame Cotta de Bonvillar, née de Lascaris.
*
Naturellement, nous sommes au XVIIIe siècle, et rien ne va très vite : trois mois après, en décembre 1759, le jeune Lascaris écrit à son tour à Emilie : il n'est toujours pas parti ! Ou plutôt si : il est à Paris, mais toujours sans emploi. Il doit habiter quelque hôtel garni et attend incessamment un ordre pour rejoindre un régiment. Le jeune Théodore de Lascaris vient d'avoir 19 ans et appeler "ma chère mère" une jeune femme de vingt-quatre ans est un peu excessif. Mais tel est le XVIIIe siècle ; il est entendu entre Emilie et Madame de Lascaris qu'elle servira de maman au jeune Théodore dans ses tribulations.
Ma trés-chére Mère
Il est venu içi un domestique m'avertir de ne pas m'écarter de la part de Mr l'abbé Borillon. Je crains qu'il ne vienne m'anoncer qu'il faut partir et que je n'ai plus le tems de vous en avertir, c'est pour celà chère maman que je vous écris ces deux lignes en cas que je ne puisse plus revoir ou vous écrire, et pour vous dire aussi que je n'ai pas eu le tems d'écrire à Mr l'abbé de Crillon parce que la maitresse de l'Hotel m'a dit qu'il devoit venir de moment en moment, et je craignois d'être surpris en écrivant, et n'être pas décovert [sic]; je vous prie donc instemment, ma chère et tandre mère, de le remercier pour moi, et lui faire concevoir combien je suis sensible à ses bontés et à ses bienfaits, chose que je ferai moi même. Je reste encore içi vint quatre heures. Je vous prie aussi de faire sentir ma reconnaissance à cette dame votre amie qui se prêtoit de si bonne volontés pour moi. Ce sont des choses, chère mère, que je devrois faire moi même mais je suis si troublé et chagrin que j'oublie tout ce qui me regarde. Si je ne part pas demain je seray chés vous pour être soulagé par votre vüe et par votre amitié.
Je vous demande bien pardon si j'ose m'appeller votre fils, et si j'ose si librement m'adresser à vous, je ne le ferai pas si je ne savois que vous avez le coeur de mère pour moi, comme j'en suis à l'épreuve, et que vous vous faites une gloire d'être utile aux misérables je puis donc m'adresser à vous avec confiance, et vous suplier d'être dans un tems ma protectrice et mère. Le tems abrégé que j'ai ne me permet d'en dire davantage, je voudrois pouvoir vous mettre davant les yeux mon coeur pour vous faire voir ce que je pourrois pas vous écrire, vous pouvez compter sur l'obbéïssence d'un fils, quand il recevra l'honneur de vos comendemens. Je suis, ma très chère et tendre mère, en vous embrassant, et vous baisant la main, avec respect,
Votre fils très obbéïssent et très affectionné
Lascaris Vintimille della Brigue
Ce 11 décembre 1759.
*
A Madame Saurin
Ma très chère mère,
Je vous envoie la lettre pour Monsieur l'abbé de Crillon ; elle n'est pas assez (1) touchante que mon coeur le désire, mais la valeur de vos paroles pourra suplaire (2) au manquement de mon éloquence, oui, ma chère mère, votre coeur tout rempli des bontés trouvera le moïen d'engager les autres pour un fils infortuné, et que sans vous un désespoir auroit assurément perdu.
J'ai diné ce matin avec monsieur l'abbé Bourillon, qui venoit de voir Monsieur le Comte du Luc et il m'a assuré que la lettre que je lui ai écrit l'a vivement touché et qu'il a dit que quoique mon oncle ne fasse rien pour moi, il ne m'abandonnera jamais.
Mon affliction à présent n’est pas seulement de retomber entre les mains des parens qui ont conjuré contre moi, mé plus vivement suis touché de vous quitter, et peut être à jamais, je souffre tout ce qu'un fils peut souffrir en quittant une mère.
Il est vrai que jusques à présent [je] n'ai rien fait pour mériter d'être votre fils, mais j'ose vous assurer que pour une obéïssence sans réserve à vos comendemens, et pour une reconnoissence éternelle, j'arriverai à mériter ce nom que je ne changerai jamais.
Le peu de tems qui me reste ne permet que de vous embrasser encore une fois, et vous baiser les mains, et suis, ma très chère mère
Votre fils très afectioné
Lascaris Vintimille Brigue
Ce 12 Décembre 1759
_____________
(1) : Aussi.
(2) : Suppléer.
De Turin, ce même mois de décembre 1759, Madame de Lascaris remercie vivement Emilie de s'être entremise auprès de tant de hauts et puissants personnages pour son fils : d'un autre côté je suis au désespoir de voir le mauvais accueil de mon frère, (1) qui bien loin de vouloir contribuer à sa fortune, fait tous ses efforts pour la traverser."
Elle n’est d’ailleurs pas contente : on veut se défaire de son fils "puisqu'on veut l'envoyer à Mahon. Il étoit bien plus à portée de Paris que de Nice, puisqu'il faut qu'il se rende en Catalogne, qui est sa véritable route, et la plus courte, cependant mon frère veut qu'il se rende à Nice, et puis pour suivre son idée, il faut qu'il traverse une autre fois la France, pour se rendre à Mahon..." Elle pense qu’on veut éloigner son fils de l’armée pour lui faire prendre le parti de l’Eglise "auquel il me paraissait beaucoup porté, aiant fait jusqu'à présent tous ses études avec beaucoup de succès, et puis tout d'un coup on veut lui faire prendre celui des armes ! On ne fait pas réflexion qu’une personne de condition chez nous ne peut pas servir un autre prince sans une permission expresse du Roi. Voiez, Madame, dans l'embarras que je suis : j'ai demandé la permission pour envoyer mon fils en France continuer ses études, assurant qu'il se fairoit eclésiastique ; présentement il faut que je demande une nouvelle permission pour le faire servir ; il est vrai que j'espére qu'on me l'accordera facilement, mais en attendant je ne voudrois pas que mon fils vint à Nice jusqu'à ce que je l'aie obtenue, car outre qu'il s'exposerait à la risée de tous ses ennemis, risqueroit aussi la confiscation de tout son petit bien. Tout celà me déséspère. Ah si jétois à Paris, je ferois bien voir à mon frère que quand il est allé en France il étoit dans un équipage beaucoup plus mauvais que mon fils, je lui prouverais bien authentiquement que c'est lui qui porte le nom de mon fils, et que mon fils ne porte pas le sien, puisqu'il est reconnu par tout le monde pour l'aîné de notre famille, je le prierois, s'il ne veut pas le secourir, de ne s'opposer pas au moins à sa fortune. J'ai écrit à Mr le Comte du Luc le courier passé, et je n'ose pas lui écrire de nouveau, crainte de l'importuner. Je vous prie de lui faire entendre raison sur le préjudice qu'il peut causer à mon fils par son retour à Nice, outre le ridicule auquel il s'expose, et si vouz aviez moien, comme vous me dites, de le retirer à Paris pendant deux ou trois mois, vous me feriez le plus grand plaisir du monde, car je prévois que le Marquis Monti répondra qu'il n'y a aucune place dans son régiment, Mr Milo son major qui est passé à Nice m'aiant assuré qu'il y en avoit dans le dit régiment plusieurs surnuméraires. J'écris à Nice afin que, en cas que mon fils soit en route, on le fasse arrêter dans quelques villes de Provence, jusqu'à ce que je sois assurée de son sort. Faites, s'il vous plait, agréer mes très humbles remerciements à Mrs le marquis et abbé de Crillon, et en vous souhaitant dans ce commencement d'année toutes les prospérités et bénédictions du ciel, j'ai l'honneur de me dire avec un parfait dévouement,
Ma très chère dame
Votre très humble et très obéissante servante,
Lascaris Vintimille de la Brigue
Je ne manquerai pas de faire vos complimens à la Comtesse Gioia.
______________
(1) : Chaque fois que Madame de Lascaris parle de son frère, il faut comprendre qu’il s'agit de son beau-frère, l’archevêque de Toulon, qu'on appelle aussi, tout simplement : M. de Toulon.
*
Ma chère dame,
Mr le Marquis Monti (1) vient enfin de m'écrire qu'il a nommé mon fils à une lieutenance en second avec appointement, et qu'il en a fait part à Mr le Comte du Luc, que mon frère ne lui en a pas seulement écrit ; ce qui me confirme toujours dans l'idée que mon frère n'est en aucune façon porté à lui procurer le moindre avantage, et qu'après vous j'en ai toute l'obligation à Mr du Luc. Je pense qu'à présent ils ne pourront plus reculer, hormis que Mr l'evêque trouve encore quelque anicroche. Ce pauvre enfant, comme vous savez, se trouve à Salon chez Mr de Natoire, c'est une petite ville à trois lieües de Marseille où il se trouve plus à portée de s'embarquer pour Mahon. Je vous supplie, ma chère Dame, de vouloir bien faire vos derniers efforts afin qu’on le dépêche, et qu'on le pourvoie du nécessaire, comme on lui a promis, vous savez mieux que personne sa situation et ses besoins, et j'ose espérer que, puisque vous vous êtes donné tant de soins et de peines pour lui, vous ne voudrez pas l'abandonner à présent qu'il a besoin plus que jamais de votre protection. Je me flatte qu'à cette heure Mr de Flobert sera retourné à Paris, je vous prie de m'en donner de nouvelles, et de lui faire agréer mes plus chers complimens, sans oublier Antonia. La Comtesse Gioia e Ramela vous font ses complimens, son dîné s'est fait chartreux. La maison de Courtendon et de Castagnole me chargent de vous faire agréer leurs devoirs trés-humbles. Donnez moi des nouvelles de votre santé, et soiéz assurée de toute la reconnoissance avec laquelle je serai toute ma vie, Ma Chère Dame
Votre très-humble et très-obéissante servante
Lascaris Vintimille de La Brigue
Asti ce 6 avril 1760.
___________
(1): Le marquis de Monti, lieutenant-général des Armées du Roi le 25 juillet 1762. Il s'était illustré en 1748, pendant la campagne de Gênes, en défendant Voltri contre le général autrichien Nadasty.
Souvenez-vous que mon frère l’évêque m’écrivit dernièrement que dès que Mr Monti nommeroit mon fils à l’emploi, il enverroit d’abord de quoi faire son équipage, il lui sera plus aisé présentement que mon fils est proche de Toulon d’envoier ordre pour cela à un de ses vicaires.
*
Ma chère Dame,
Madame la Comtesse Gioia qui m’a fait part de vos nouvelles m’a apris que Mr Flobert devoit bien-tot arriver à Paris. Vous devez être persuadée de la part que je prens à son retour ; je suis obligée de m’en réjouir ; tant pour une inclination particulière que pour la fortune de mon fils qui est attachée à sa personne, et que je vous prie de vouloir lui recomander à son retour. Je lui écris une longue lettre que je me prens la liberrté de vous addresser, pour l’informer de tout ce qui s’est passé pendant son absence à l’égard de mon fils, que j’espère qu’il ne voudra pas abandonner. Vous pouvez juger si ses simples appointemens pourront lui suffire pour se soutenir avec honneur, suppliez le de faire ses efforts pour que Mr le Comte du Luc lui tienne parole, et porte mon frère à avoir pour lui des sentimens plus favorables (1). J’ai apris avec bien de chagrin la maladie de votre fille de chambre, que je vous prie de saluer. Je voudrois avoir des ailes pour aller vous embrasser, et vous convaincre du parfait dévouëment et de toute la reconnoissance avec laquelle je serai toute ma vie
Ma Chère Dame
Votre trés humble et très obéissante servante
Lascaris Vintimille de la Brigue
Asti ce 12 juillet 1760.
Le jeune Lascaris est reçu lieutenant au Royal-Italien
Ma très-chère Mére
Ne croiez pas, Madame, que j’ai oublié en si peu de tems ce que je vous dois, quoi que vous n’aiez point reçu de mes lettres depuis deux mois que je suis dans l’Isle de Minorque. Le tems et l’absence n’auront jamais assez de force pour affoiblir ma reconnoissence. Dés que je fus dans l’Isle, mon premier empressement fut de vous faire part de mon arrivée et de ma réception en qualité de lieutenant en second dans Roïal-Italien. L’impatience de vous apprendre cette nouvelle me fit remettre votre lettre à un marchand qui passoit en France, parce que le courrier ne partoit pas encore de Mahon, j’ai sçu depuis qu’il a été arrêté par un corsaire, et que votre lettre par conséquent s’est perdüe.
Je dois donc vous apprendre que je suis arrivé dans l’Isle de Minorque le 18 et j’ai été reçu dans le Régiment le 22 Mai : ce changement est heureux pour moi, et je suis à présent en chemin pour vous donner des preuves de ma conduite malgré tout ce que mon oncle, et Mr le Comte du Luc peuvent avoir trouvé de ma placé dans ma conduite passée.
Je devrois vous instruire de tout ce qui m’est arrivé depuis la dernière lettre que je vous ai écrit, mais le moment est trop court pour l’emploïer à une chose qui n’a que du lugubre et qui n’est qu’une suite de ce que vous savez ; je pense que je ferai mieux si je vous prie instemment de me donner des nouvelles de votre santé, c’est depuis que je suis parti de Paris que j’en demande sans jamais en avoir reçu, j’espère cependant que cette fois ci vous ne me refuserez pas cette satisfaction, d’autant plus si vous vous intéressez à ce qui me regarde, comme je dois en être convaincu pour tout ce que vous avez fait pour moi.
J’attens, Madame, avec impatience de vos nouvelles et je vous prie en même tems de me faire savoir si Monsieur de Flobert est à Paris, pour que je puisse lui écrire, et lui exposer mon état présent. Si vous me faites l’honneur de m’écrire voiez ci-dessous mon adresse. Je suis, Madame, en vous baisant la main avec un profond respect
Madame, votre très humble et très obéissant serviteur et fils très affectionné,
Lascaris de Vintimille Comte de la Brigue
Citadella, Isle de Minorque ce 22 Juillet 1760.
__________
(1) : La solde d’un officier étant notoirement insuffisante, Mme de Lascaris espère que le Comte du Luxc persuadera l’évêque de Toulon de donner quelque argent à son fils - ce qui est tout à fait improbable, vu l’absence de cœur de l’ecclésiastique.
*
Rien n'est simple. Un accident se met en travers de la carrière naissante du jeune comte de Lascaris : son colonel, M. Monti, ne peut le garder au régiment déjà encombré de surnuméraires. Le chômage n'est pas une nouveauté. Le jeune homme est renvoyé, et Mme de Lascaris se désespère.
Madame,
J'ai été pénétrée de la plus vive reconnaissance en aprenant les politesses que vous avez, faites à mon fils, et les soins que vous vous êtes donnés pour lui ; je vous écris ces deux lignes pour vous en témoigner mes plus sincères remerciemens. J'ai apris par la même que la faute est toute tombée sur moi ; ça ne me feroit aucune peine, et je sacrifierois volontiers ma réputation, si je savois que celà fut avantageux à mon fils. Mais son retour précipité me chagrine beaucoup, et je n'entrevois de tous côtés qu'obstacles à sa fortune. S'il y a quelque chose qui puisse me rassurer c'est votre bon coeur, ma chère Dame, celà me console, et je suis sûre qu'avec votre appui mon fils ne peut que parvenir. C'est vous qui avez commencé cette bonne oeuvre, je la laisse entre vos mains, me flatant que vous aurez le bonheur de la conduire à sa fin. A cette heure Mr le Comte du Luc doit avoir eu réponse de Mr le Marquis Monti, lequel me répond en ces propres termes : "Je ne manquerai pas de donner à votre fils une lieutenance en second dans mon régiment quand j'aurai rempli mes premiers engagemens." Il me paroit que celà trainera bien en long, et je n'ose pas écrire à Mr du Luc cette réponse de crainte qu'on ne me fasse quelque grief de ce que j'ai écrit à Mr le Marquis Monti. J'écris par ce courier à Mr du Luc, à mon frère, et à Mr l'abbé de Crillon, mais je ne leur parle point de ce que Mr Monti m'a écrit, faites en l'usage que vous trouverez à propos. En attendant mon fils qui dans ces circonstances n'est pas convenable qu'il reste à Nice, doit aller attendre ses ordres dans un village de Provence que je vous nommerai quand il y sera, que sait-on si mon frère ne pourra pas sur ceci trouver un autre prétexte de ma mauvaise conduite. Ce pauvre enfant se trouve présentement désoeuvré, aiant quitté ses études, vous savez le préjudice que l'oisiveté peut porter à un jeune homme de son âge. Tout celà m'afflige infiniement, et ce qui met le comble à mon désespoir, c'est d'aprendre par votre dernière lettre que vous êtes malade. Je prie continuellement le Seigneur qu'il veuille bien vous rendre votre santé que vous emploiez si charitablement et si généreusement à protéger les malheureux, et je me flate qu'il voudra bien exaucer ma prière. Je suis inquiétte jusqu'à ce que je sache des nouvelles de votre santé, je vous supplie de ne me refuser pas cette consolation à la première occasion. Faites, s'il vous plait, mes complimens à Antonia. Je dois partir demain pour mon couvent d'Asti ; je vous y offre mes petits services, ne souhaitant que des occasions pour vous convaincre de mon dévoilement, et de toute la reconnaissance avec laquelle je serai toute ma vie, Ma Chère Dame...
Turin ce 20 Décembre 1760.
*
Soeur Saint-Ambroise
Emilie n'a pas perdu contact avec le monde de son enfance. Une nouvelle religieuse, Soeur Saint-Ambroise, du couvent des Ursulines de Pontoise, est désormais sa correspondante.
Le Couvent des Ursulines de Poissy, à Pontoise, avait été mis à la mode par une ancienne élève qui s'y était beaucoup plu : Jeanne-Antoinette Poisson, dite Reinette, qui y demeura de 8 à 12 ans, entre 1729 et 1733. C'était bien avant la naissance d'Emilie. Avec un surnom aussi prémonitoire, Reinette devint maîtresse de Louis XV et marquise de Pompadour. Et pendant 20 ans, elle entretint le couvent où elle avait passé d'agréables années d'enfance. La Supérieure des Ursulines, Mère Sainte-Perpétue, née de La Motte, était la tante maternelle de Reinette. Aussi fut-il de bon ton dans la société, pour faire sa cour à la favorite, ou se décerner un brevet de bon genre, d'envoyer ses filles à Pontoise. Emilie, elle, recommande une demoiselle de Neuilly, et Soeur Saint-Ambroise, qui l'appelle Madame et Chère Amie, s'excuse de n'avoir pu faire recevoir la jeune fille : il n'est pas plus facile de faire entrer une jeune fille dans un couvent qu'un jeune homme dans un régiment ; toutes les places sont prises. "C'est un sacrifice pour moi de ne l'avoir pu accepter, il suffit que vous vous y intéressiez, elle m'aurait été chère." Elle ne lui conseille pas non plus d’envoyer cette demoiselle à son ancien couvent de Gisors : "Vous applaudirez peut-être dans peu qu'elle n'y ait point été, la maison va fort déclinant pour le temporel, j'apprends que la misère augmente tous les jours, surtout par le retranchement de certains secours qui leur étaient accordés."
Soeur Saint-Ambroise est charmée que Marie-Emilie quitte Paris "puisque l'air ne vous en est pas bon, mais, ma chère dame, je suis fort affligée qu'il ne soit plus question du voyage d'Espagne" : elle le regrette parce qu'elle espérait que Marie-Emilie passerait par Pontoise pour la voir ; elle le lui avait promis. On verra que ce fameux voyage, qui pointe là son nez, n'est que partie remise.
Comme dans toute correspondance féminine qui se respecte, on se demande des nouvelles des amies : Mme de Salle : "marquez lui mon regret d'être privée de l'honneur défaire une plus ample connaissance avec elle..." On en donne : "ma soeur prend le lait d'ânesse pour une chaleur de poitrine dont elle est incommodée depuis fort longtemps ; on espère qu'il lui fera du bien." Enfin on se fait de petits cadeaux, qu’on a ourlés et brodés soi-même, ce qui est charmant et véritablement affectueux : "J'avais fait un petit ouvrage pour le temps de votre voyage je pense que c'est un petit meuble bon encore pour la campagne, que je vous prie d'agréer..."
Deux ans passent sans correspondance de personne. En janvier 1763, soeur Saint-Ambroise est accablée d'ennuis : "Ma santé est des meilleures, grâce au ciel, et j'en suis surprise, étant dans une situation fort triste, non de la part de ces dames (les Ursulines de Pontoise), mais par celles que je prends aux peines dont ma soeur est accablée, chargée de neveux et nièces pour qui il faut faire de grandes avances, des pertes assez considérables qu'elle vient de souffrir, m'ayant en grande partie à sa charge, et par dessus tout celà, le régiment dont son fils est major devant s'embarquer incessamment, et lui conséquemment je ne sais encore pour quel endroit. Je crains qu'on ne lui conserve point son poste, le Roi se réservant d'y nommer. Il y a cependant bien des années qu'il sert avec honneur... Il y aurait de quoi périr par les réflexions que me fournissent tant de circonstances affligeantes…" Fin mars, la santé de Marie-Emilie est de nouveau mauvaise, et son amie s'en désole : "Je déteste pour vous le séjour de Paris qui est si contraire à votre santé. Je souhaiterais qu'un établissement bien avantageux vous fixât gracieusement ailleurs, il semble qu'on soit à la source pour tout dans la grande ville, cependant celui qui vous a traité dans votre dévoiement n'a pas agi en habile homme ; rien de plus dangereux que de les arrêter trop vite : vous en avez fait la cruelle expérience, je lui en veux beaucoup et ne lui pardonnerai point de mauvais coup que je n'apprenne votre parfait rétablissement..."
Marie-Emilie a envoyé à la soeur son amie madame Dalmes : "il faut que je vous avoue que n'ayant point encore l'honneur de la connaître, et n'étant pas facile à me livrer, sa présence m'a beaucoup génée. Ce qui m'a fait supprimer beaucoup de petites questions qui n'auraient point eu pour principe une curiosité trop ordinairement attribuée à des religieuses" écrit Soeur Saint-Ambroise avec assez d'esprit, "je n'en suis susceptible que par l'intêret sincère que je prends à tout ce qui vous regarde. Oserais-je par exemple, ma chère amie, m'informer s'il n'aurait pas été possible que vous fissiez par vous-même la demande de vos papiers à l'ambassadeur à qui ils ont été confiés?" Ici la curiosité, conventine ou non, reprend le dessus : ces histoires mystérieuses d'enfants inconnus apportées dans des maisons pieuses par des dames voilées, dans des serviettes marquées au bon coin d'une discrète couronne de duc et pair, avouez qu'il y avait de quoi piquer d'autres curiosités que celles de saintes femmes confites en bénédicités... "Rien de plus juste en soi que de vous les délivrer, et je suis persuadée que charmée de vos grâces et de votre esprit, ce qu'à d'autres il nie avoir" (qui est visé ici ? M. de Flobert ?) "Il vous les remettrait. Employez au moins vos plus puissants amis pour finir cette affaire qui me parait bien essentielle et nécessaire pour terminer les autres" (quelles autres ?) "dont je souhaite la prompte et heureuse réussite pour votre bonheur. Donnez cependant le temps convenable aux réflexions pour faire un bon choix. Intéressez-y le ciel, faites dire des messes : ne le pouvant pas, je vous promets d'en beaucoup entendre à cette intention."
Phrases sibyllines en diable, et la soeur, on le voit, promet de faire ce qu'elle peut, même si ce n'est pas grand chose sur le plan matériel. Nous ne sommes pas plus avancés que 13 ans auparavant. Marie-Emilie non plus, apparemment, car Soeur Saint-Ambroise lui dit : "A l'égard du voyage de Londres que vous projettez, et auquel les raisons les plus fortes et les plus engageantes peuvent vous décider, trouvez bon que je vous représente qu'outre les dangers que vous courez, en y mettant si peu de jours c'est exéder ses forces et détruire celles du tempérament. Il parait que vous l'avez excellent : ménages-le et conservez une santé chère à tous ceux qui ont l'avantage de vous connaître et plus à moi qu'à personne."
En passant, la soeur en profite, mine de rien, pour faire la leçon à notre belle inconnue : il se trouve qu'elle a du goût pour l'art cynégétique, chose dont nous ne nous serions guère doutés.
"Permettez que je parle à présent sur le ton dévot.Votre belle âme m'en donne la confiance, et ce que je vais dire n'est pas tiré des statuts monastiques.Votre goût pour la chasse est fort de mode et parait innocent cependant vous savez mieux que moi qu'il est marqué dans l'Ecriture : "Maudit l'homme qui prend l'habit d'une femme, et la femme celui d'un homme." Cela sans restriction. Je crains que les explications qu'on peut donner pour l'autoriser ne soient pas fort sûres. Ne le serait-il pas davantage, ne voulant pas se priver de ce divertissement, d'y aller en amazone ?"
Voilà qui est au moins inattendu, de voir notre amie en culottes à cheval sur un alezan, telle Marie-Antoinette en semblable équipage peinte par Louis-Auguste Brun... La reine suivait la mode lancée par ses belles-soeurs, les comtesses d'Artois et de Provence, et Marie-Thérèse, sa mère, l'impératrice d'Autriche, n'en était pas fort contente : "Le monter à cheval gâte le teint, et votre taille, à la longue, s'en ressentira... J'avoue, si vous montez en homme, dont je ne doute, je trouve même dangereux et mauvais pour porter des enfants..." écrit cette digne mère. Marie-Emilie n'a pas à avoir de telles craintes pour sa progéniture ; d'ailleurs cette mode est propre à la "bonne société" à la frange de laquelle vit notre chasseresse de rencontre. "Ce sont là de ces réflexions que je n'ai osé hasarder devant Madame votre amie" lui écrit soeur Saint-Ambroise, "qui ne naissent que de cet intérêt essentiel que je prends ma chère amie à tout ce qui vous touche, j’espère que vous en jugerez ainsi... "
Sur cette aimable homélie se terminent brutalement les lettres de soeur Saint-Ambroise. Marie-Emilie s'en est-elle offusquée ? Nous n'en savons rien. Elle vit de toute façon désormais dans un milieu beaucoup plus mondain que celui des soeurs de Pontoise. "M. de Nerel m'a paru d'un caractère parfait, écrit encore la soeur. Mais je pense que s'il demeurait à Pontoise, il aurait la même aversion qu'ont tous Messieurs les officiers pour la grille (du couvent), vous, ma chère amie, n'y étant pas..."
La lettre est d'octobre 1764 et notre héroïne a 29 ans.
*
On est passés de décembre 1760 à mai 1763 ; bien des détails nous ont échappé. Le comte de Lascaris a réintégré son régiment et Emilie a changé d'adresse.
A Monsieur Chapais rue de l'Echelle Saint Honoré pour remettre s'il lui plaît à Madame Saurin, Paris.
Montargis ce 26 May 1763
Madame
A l'occasion que le régiment passe dans les environs de Paris, Sans que peut-être je puisse avoir l'honneur de vous voir, je ne saurois passer outre, Madame, sans vous donner quelque marque de mon souvenir et vous témoigner combien je serois flaté d'avoir cet avantage, quoique selon les aparences vous aiés abandoné votre fils à son mauvais sort, puisque vous lui avés refusé jusqu'à présent la douce satisfaction d'avoir de vos nouvelles ; vous ne sauriés croire combien j'ai été sensible à votre silence, en sorte qu'aprés avoir écrite plusieurs lettre de toute part, je me suis imaginé ou que vous n'abitiés plus Paris, ou que quelque malheur vous étoit arrivé, et je suis encore indécis sur votre sort.
J'espére, Madame, que si la présente vous parvient, vous ne serés pas assez rigide à mon égard pour me refuser une de vos lettres, d'autant plus que le régiment doit passer à Meaux, à Chaume et à des autres viles qui sont très à portée de Paris, pour se rendre à Lille ; j'ai pensé plusieurs fois d'écrire à un abbé qui étoit autre fois aumônier de Mr de Toulon, et lui donner votre adresse pour voir s'il me donneroit de vos nouvelles, je ne l'ai pas fait crainte de vous déplaire.
Si cependant j'ai la satisfaction de revoir encore une fois votre caractère, je vous prie de me donner l'adresse de Mr de Flobert pour que je puisse lui écrire. Je ne vous détaile pas mon sort parce que je ne sais si ma lettre vous sera rendue, je puis cependant vous dire qu'il n'a pas changé ; soiés assurée Madame, que je n'oublierai de ma vie ce que je vous dois malgré qu'il en soit, et que je serai toujours inviolablement, Madame, Votre très humble et très obéissant serviteur
C.e Lascaris de Vintimille de La Brigue officier au régiment Roïal Italien
*
Mort de M. de Flobert
A Madame Saurin rue des Saints Pères la porte cochére à côté de La Charité au faubourg Saint Germain, Paris.
Lille en Flandres ce 8 Aoust 1763.
Madame,
A la réception de votre chère lettre, mes transports auraient été trop vifs, et ma joie trop parfaite, si elle n'avoit été modérée par la mort de Mr de Flobert et par votre maladie, que vous m'aprenés avoir été des plus cruelles ; j'ai senti d'autant plus vivement cette perte qu'elle est irréparable pour moi et qu'elle doit vous avoir causé un chagrin dont les suites pourroient de nouveau altérer votre santé. Cette idée m'alarme, et me fait ressentir d'avance un mal que votre raison peut vous épargner. Si jamais votre coeur généreux a été sensible à mes peines, n'augmentés pas mes malheurs par vos chagrins, je ne saurois vivre, ma chère dame, sans les partager.
Quant à ma situation, elle est des plus tristes, et il y avoit très longtems qu'une noire mélancolie m'occupoit tout entier ; votre lettre a ranimé mes esprits, et dissipé mes chagrins. Quoique la fortune paroisse déchainée contre moi, je ne saurois m'affliger, votre coeur me tient lieu de tout : malgré les bonnes relations que le marquis de Botta notre colonel commandant a eu la bonté de faire plusieurs fois à mon oncle, et au Comte du Luc, il n'a pas été possible de les fléchir ; il est depuis prés d'un mois à Paris, et il m'a promis de s'emploièr vivement auprès du comte du Luc, je ne sais ce qu'il obtiendra, mais les aparences sont très-mauvaises puisque je n'ai pas encore reçu de lettres ; je vous serai infiniment obligé si vous faites parler pour moi Mr l'abbé de Crillon, j'ai lieu de tout espérer de son zéle, et d'un coeur aussi généreux que le votre ; je lui écrirois, si je n'avois pas oublié son adresse.
Ne céssés pas de m'écrire, et de moraliser, votre morale est le plus grand et le plus cher des présents que vous puissiés me faire, puisqu'en la suivant je ne puis que m'attirer vos sufrages, qui sont à mes yeux d'un prix inestimable, une grâce que je vous demande, avec l'ardeur la plus vive, est de ne pas me refuser la satisfaction de recevoir de tems en tems de vos nouvelles. Le plus grand, et le seul plaisir que je puisse goûter, est celui de relire vos lettres que je garde soigneusement, j'y trouve des motifs de consolation qui me font oublier tous mes chagrins. Ne ménagés pas vos conseils, donnés les tels que votre coeur les dicte, la source m'en est trop chère pour ne pas les respecter et les suivre. Soiés assurée d'une reconnoissence sans bornes, d'un atachement sans réserve, et des sentiments les plus tendres et les plus affectionés, croiés toute ma vie, de toute mon âme
Votre très humble et très affectionné fils et serviteur
Lascaris Vintimille
*
A Lille ce 3 Novembre 1763
Madame
Quoique je n'ai rien de bien intéressent à vous aprendre je ne saurois rester plus longtems sans demander des nouvelles de votre santé, j'espére que vous ne m'en refuserés pas étant si proches que nous sommes l'un de l'autre. J'ai reçu depuis votre dernière lettre des nouvelles de ma chère mère, elle se trouve actuelement résidante à Nice, me charge de vous faire ses compliments, et demande un peu de part dans votre souvenir ; je vous ai mandé par ma dernière lettre que notre colonel commandant, le Marquis de Botta, etoit à Paris, et qu'il avoit promis de s'intéresser pour moi auprès du Comte du Luc, j'ai reçue dernièrement une de ses lettres, il me marque qu'il s'assure sur la noblesse des sentiments de Mr le comte du Luc, que je serois dans une position plus heureuse si des affaires mal rangées, et des enfans ne metoient des entraves à sa générosité, qu'il avoit convenu cependant avec lui, des voies qu'il faloit tenir pour adoucir ma situation, qui empire journelement, il me dit en même tems de m'assurer de patience, parce que ces sortes d'affaires, et surtout celles dont il étoit question, étoient d'une éxécution fort lente ; voilà ce qu'il me marque de plus positif sans me parler d'aucun autre arrengement ; après cette réponse je me suis décidé d'aller voir des parents, qui sont à quatorze ou quinze lieues d'içi, qui m'ont fait la politesse de m'écrire, ce qui m'épargnera en même tems certaines dépenses qu'on est obligé de faire en garnison, et auqueles il est impossible que je puisse suffire, si quelque événement ne fait changer de face à mes affaires, je partirai dans deux jours d'içi. Si vous me faites l'honneur de répondre à ma lettre, adréssés la toujours à Lille en Flandre au Régiment Roiàl Italien, elle me parviendra sans faute ; je sai, Madame, que vous avés le coeur trop bien placé pour ne pas vous intéresser au sort des malheureux, si vous prenés quelque part au mien, il ne tient qu'à vous de l'adouçir, en m'aprenant l'état de votre santé, vous ne devés pas douter de l'intérêt que j'y prens, puisque je vous dois toute ma reconnoissence, et que vous êtes par conséquent la seule personne qui m'intéresse le plus, et à qui je dois un sincère attachement, et un profond respect avec lequel j'ai l'honneur d'être, Madame
Votre très humble et très obbéissant serviteur et fils très affectionné
Lascaris Vintimille
Emilie a une idée derrière la tête. Son jeune protégé ne ferait-il pas un mari convenable ? Elle s'enquiert de ses biens et de son avenir.
A Belval ce 16 Novembre 1763
Madame
Mon absence du régiment, et les occasions peu fréquentes pour envoier mes lettres à la poste de la campagne où je suis depuis un mois, m'ont empêché jusqu'à présent de répondre à votre lettre ; j'ai reçu en même tems la lettre de change de deux louis que vous avés eu la bonté de me faire toucher pour supléér à mes besoins ; je ne saurois dans les présentes conjectures refuser du secours d'une personne que je dois aimer, et estimer pour tant de titres, vous devés par conséquent être assurée que je ne rougirai jamais de vous être redevable, vous soufrirés cependant, quoique vous aiés le coeur d'une tendre mère pleine de générosité, que je m'aquitte envers vous de ce dernier bienfait le plutôt qu'il me sera possible, pour ne pas contredire aux loix établies dans la société des hommes.
Vous me marqués dans votre lettre que vous avés des vües pour mon bonheur que mes parents ont intérêt de ne point avoir, vous demandés le détail de mes biens, de la discrétion, de la prudence, de ma part ; vous ne risqués rien de me découvrir ardiment vos projets, et me parler avec la même franchise que vous parleriés à vous même, vous ne devés craindre aucun tour d'étourderie de ma part, encore moins d'imprudence, et je perdrois toute la confience que j'ai en vous, si je pouvois imaginer que vous pensés autrement sur mon compte. Quant à mes biens vous savés aussi bien que moi qu'ils ne sont pas considérables, quoique j'aurois de quoi vivre passablement dans ma terre s'ils étoient entretenus, et si je n'avois pas une tante et un oncle paternels d'un âge qui les met hors d'état d'en avoir soins. Pour mes prétentions, il ne m'est pas possible à présent de vous en faire un détail exacte, je vous dirai simplement que je serois fort au large si j'avois les moiens d'en faire valoir la moitié ; je me réserve à vous mettre les choses au clair en cas que vous le jugiés nécessaire par les vües que vous pouvés avoir ; pour ce qui regarde l'entrevüe que vous voudriés avoir avec moi, vous ne devés pas douter que je la souhaite avec l'ardeur la plus vive, et il me paroit que j'oublierois dans ce moment toutes les traverses de ma vie ; je saurois même, peut-être, ménager une absence du régiment sans que personne puisse se douter de mon voïage, j'attend les occasions favorables pour ôter toute sorte d'obstacle, et vous pouvés être persuadée que je les saisirai avec beaucoup d'empressement.
Je suis içi chez Mr de Belval ancien lieutenant colonel du régiment où je suis, c'est un parent qui m'est affectioné, qui m'a engagé à venir passer une partie de l'hyver avec lui, pour m'aider à païer les détes que j'ai trouvées attachées à mon emploie, il s'est brouillé avec l'evêque de Toulon pour l'avoir plusieurs fois sommé de sa parole, j'ai reçu quelques jours après votre lettre quatre louis que tria mère m'a envoïé, en sorte qu'à mon retour à ma garnison j'aurai de quoi m'abiller, et diant épargné mes apointements depuis que je suis içi, je me trouverai au courent de ma paie ; les affaires ont mieux tourné peu à peu depuis que j'ai reçu votre première lettre, en arrivant en Flandre elles tourneront encore mieux. Si vous continués à me donner de vos nouvelles, du moins je suporterai avec plus d'aisence ma triste situation ; je dois vous prévenir que le régiment est parti de Lille pour aler en garnison à Donkerque. Dés que je l’aurai joint je ne manquerai pas de me donner aux exercices que vous me marqués dans votre lettre, quoique je n'ai rien oublié autant que mes forces me l'ont permis. Je vous prie en m'écrivant d'adresser vos lettres à St Paul en Artois pour Belval, elles me parviendront, et comme il y a içi dans les environs un Lascaris établi, ne manqués pas de mettre Officier au régiment Roïal Italien.
Je vous demande mille pardon si je vous écris une si longue lettre, je ne finirois plus si je voulois vous faire tous les remerciements que je vous dois, et si je voulois vous entretenir des sentiments de reconnaissance et de respect avec lesquels j'ai l'honneur d'être, Madame
Votre très humble et très obéissant serviteur et fils très affectionné
Lascaris de Vintimille
Madame Lascaris de Vintimille à Madame de Saurin
Nice ce 6 Décembre 1763
Je suis autant sensible, ma chère Dame, à l'honneur de votre gracieuse lettre, comme je suis touchée de la mort du cher Mr Flobert, d'autant plus qu'elle a causé quelque dérangement à vos affaires. Vous savez la perte que mon fils a faite en la personne de ce seigneur auquel nous avons tant d'obligation, elle seroit irréparable si je ne connaissais la noblesse et la générosité de vos sentimens en qui je mets toutes ma confiance. Vous avez été sa première protectrice, par ainsi j'ose me flatter qu'il retrouvera en vous l'azile et l'intérêt qu'il doit espérer de votre âme et de votre naissance. Vous n'ignorez pas la façon indigne avec laquelle il est traité par ses parens, ne l'abandonnez pas dans des circonstances si critiques, et puisque vous voulez bien souffrir qu'il vous appelle sa mère, je vous supplie de vouloir bien le traiter en fils, autant que par sa conduite il se rendra digne de ce nom. Mon éloignement et mon impuissance m'empêchent de m'acquiter envers lui des devoirs de mère, je vous prie de vouloir bien prendre ma place et mon autorité que je vous remets de tout mon coeur, et de faire pour lui et pour son avancement tous les pas que je pourrois faire si j'étois à la capitale. Une dame de votre mérite et de votre qualité n'a qu'à entreprendre pour réussir, par conséquent, si vous voulez bien l'appuier auprès de vos amis, je suis sur de son bonheur.
Je reçois avec autant de joie que de reconnaissance les marques obligeantes d'amitié dont votre lettre est remplie, et vous prie d'être persuadée que je ne vous cède pas sur cet article, et que la mienne est au-dessus de toute expression. Je suis au désespoir que des coquins de domestiques aient eu l'impudence de vouloir vous noirçir auprès de quelqu'un, vous devez pourtant être au-dessus de tout celà, et être assurée que des gens de cette espèce ne seront jamais crus que de la canaille, et que les gens de bon sens vous rendront toujours la justice qui vous est düe. Je suis fâchée de ne pouvoir faire à vive voix les complimens dont vous me chargés envers la Comtesse Zoia, la Comtesse Ramela et les Religieuses : ne pouvant plus me soutenir dans cette retraite à cause de secours qui m'ont manqués, j'ai été obligée de me retirer içi, chez Mr de Cotta mon beau fils, où je me trouve depuis quelques mois, et je ne compte plus de retourner à Asti, je n'ai pourtant pas manqué d'écrire aux Comtesses Zoia et Ramela, dont l'abbé aiant quitté le petit collet est présentement officier au service du Roi de Sardaigne. Je suis sure qu'elles seront enchantées d'apprendre de vos nouvelles, et particulièrement la Comtesse Zoia qui vous aime tendrement, et qui etoit fort en peine de votre silence, aussi bien que moi qui vous aiant écrit plusieurs fois, je craignois qu'il ne vous fut arrivé quelque malheur, ou bien que vous ne fussiés plus à Paris. Vous pouvez penser la joie que j'ai eu à la réception de votre chère lettre. La Soeur Mo est sensible à votre gracieux souvenir ; je l'ai conduite avec moi à Nice où je lui ai procuré une place dans le couvent de la Visitation, où elle est religieuse. L'Evêque d'Asti est mort depuis environ trois ans, aussi bien que Mr le Chevalier Ossorio, ministre d'état. Continuez moi je vous prie vos chères nouvelles, et faites moi la grâce de m'apprendre quand vous aurez opéré quelque chose en faveur de mon pauvre fils ; en attendant soiés assurée que je n'ai rien qui me soit plus à coeur que de vous donner quelques preuves du tendre attachement, et de toute la reconnoissance avec laquelle je serai toute ma vie,
Ma chère et aimable Dame,
Votre trés-humble servante et amie très affectionnée
La Comtesse Lascaris de Vintimille de la Brigue
Souvenez vous d'affranchir vos
lettres, sans celà elles ne me parviendront pas. Mon adresse est tout court à la Comtesse Lascaris de la Brigue.
*
Le Comte de Lascaris à Emilie
A Belval ce 21 Décembre 1763
Madame
J'ai reçu, ma très chère Dame, votre lettre datée du 5 décembre. Vous pouvés être persuadée que si j'ai marqué beaucoup d'empressement de m'aquitter de ma dette, ça n'a été que par un sentiment de délicatesse comun à tous les hommes qui pensent bien, qui sont au désespoir d'être à charge aux personnes auxqueles ils sont le plus attachés ; bien loin par conséquent que votre amitié puisse en être offensée, elle doit prendre des nouvelles forces, puisque mon empressement n'est qu'une juste compensation de mon amitié. Au reste, de tele façon que vous puissiés m'obliger, ce sera toujours au dessus d'un mérite qui est borné malgré lui à la seule reconnoissence et à l'amitié la plus sincère. Vous me reprochés de ne pas vous avoir donné le nom de mère, qui étoit dites-vous une preuve de mon attachement ; il est vray que ce nom suppose les sentiments d'un coeur tendre et respectueux, mais observés en même tems que la nature m'oblige de les partager, qu'ils sont par conséquent au dessous de ceux qu'inspire aux âmes bien nées, un coeur sensible et généreux, une âme bien placée, et un phisonomie qui annonce le caractère de l'un et de l'autre ; soufrés donc je vous prie, que je joigne à la tendresse et au respect qu'un fils doit à sa mère, tout ce que l'amitié la plus constante a de plus solide.
Vous voulés que je vous entretienne de ce que je dis, de ce que je fais, et de ce que je pense, je vous dirai en peu de mots que je ne dis pas grand chose, que je ne fais presque rien et que je pense beaucoup : quoique je sois dans une campagne et que je vois fort peu de monde, je vais souvent à la chasse, pour être absolument livré à moi même, et vous pouvés bien croire que la passion de la chasse n'occupe pas long-tems mon imagination. Je visite de tems en tems plusieurs messieurs qui sont dans le voisinage, qui me comblent de politesses, et je passe mon tems dans l'attente de recevoir de vos nouvelles. Quoique cette vie me soit fort douce, je serois déjà à ma garnison, si Mr de Belval n'avoit écrit aux Commissaires et commandant le régiment pour m'avoir auprès de lui ; il l'a obtenu, et malgré que mon oncle lui ait écrit de ne pas se mêler de ce qui pouroit me regarder, lui a écrit une lettre à décider en ma faveur tout autre que lui, enfin ma chère Dame j'attend tout de l'évènement et de la bonté de mes amis.
Vous ne devés pas être en peine de la lettre que vous m'avés envoiée pour la chère mère, selon mon clacul vous devés en avoir reçue la réonse ; écrivés moi tout de suite, et dites moi tout uniment de quoi il est question, je vous donne une autre fois ma parole d'honneur de garder le silence, et tout ce qu'il vous plaira. A mon tour je vous découvrirai mon âme et je vous instruirai de tout ce que je saurai.
J'ai une grâce à vous demander, c'est de me croire digne des sentiments d'être votre ami ; vous avés l'âme trop compatissante pour ne pas avoir essuié des revers dans votre vie, vous ne m'en avés jamais rien dit cependant, et vous m'avés refusé la douce satisfaction de partager vos peines ; la crainte en même tems d'être soupçoné de curiosité plutôt que de ce vif intérêt que je prens à tout ce qui vous regarde, m'a toujours empêché de vous questioner la dessus ; je ne vous demande cependant qu'autant de confience qu'il vous plaira, et je n'insiste pas dans mes prières.
Acceptés, ma chère et tendre mère, les veux que je fais incessement, pour que tous les moments de votre vie soient remplis par tout ce qui peut la rendre heureuse. Vous ne devés avoir d'autre témoignage que votre coeur pour être assurée de la sincérité dumien, de même que des sentiments d'un fils respectueux, et de l'ami le plus tendre et le plus sensible ; je serai toute ma vie, votre très affectionné serviteur et ami
de Lascaris
Je dois vous prévenir de cacheter mieux vos lettres, j'ai reçu la dernière presque décachetée.
*
A Belval par St Paul en Artois ce 20 Janvier 1764
Plusieurs courses que j'ai été obligé de faire par bienséance dans les environs de Belval m'ont empêché de demander plutôt des nouvelles de votre santé, je ne crois pas que vous doutiès qu'elle m'est devenüe pour le moins aussi chère que la mienne, et que vous vouliés me dérober plus lontems la seule satisfaction que je puis goûter dans le tems ; ne refusés donc pas à mon empressement ces marques d'amitié et de confience qui peuvent rendre ma retraite la plus agréable de toutes les demeures. Je comptois de partir pour Dunkerque au commencement du mois prochain, mais j'ai été si vivement préssé de passer le reste de mon hyver ici, qu'il ne m'a pas été possible de m'en défendre, d'autant plus qu'on m'a persuadé que cette absence pouroit entrer dans mes arrangements. J'aurai soin de vous mander mon départ, qui sera selon les aparences au commencement d'avril.
Je suis en peine d'aprendre si vous avés reçu de ma chère mère, la réponse à votre lettre, je n'en ai plus reçu des nouvelles depuis ce tems-là, ce qui me donna quelque inquiétude, je me flate cependant que vous l'aurés reçüe ; si cependant elle vous a confié toute son autorité, et qu'il m'arrive que je mérite quelque châtiment, ne me punissés pas par votre silence - cette punition seroit au dessous de tout ce que je puis faire pour me l'attirer, quant à mon obéissence il y a long-tems que je vous l'ai voüée entièrement, vous pouvés être assurée que je ne démentirai jamais mes sentiments, excepté que vous ne vouliés metre des bornes à mon amité et mon estime. Je dois vous apprendre que le Comte du Luc a enfin répondu à une de mes lettres que je lui ai écrit pour la bonne année. Il me marque qu'il me remercie de mon souvenir et que si Mr de Toulon avoit fait ce qu'il devoit et pouvoit pour moi, il n'auroit fait que rendre ce que sa branche a fait pour lui, qu'il auroit fait cependant son devoir à mon égard, s'il n'étoit lui-même dérangé à tout égard, le marquis de Botta lui aiant rendu compte plusieurs fois de ma conduite, et qu'il avoit prié le même, à titre de service, qu'il lui rendroit s'il emploïoit tout pour faire une honte méritée et salutaire à Mr de Toulon, et que peut-être elle opéreroit en lui ce que le nom, le sang et le Cristianisme n'ont pu faire. Après enfin m'avoir exorté à avoir toujours la même conduite, et à me roidir conre les malheurs, il finit sa lettre par m'assurer qu'il désire fort, et qu'il ne désespère pas de me prouver ses sentiments par des choses encore plus esentieles que des conseils.
Je vous avouerai, ma trés-chére amie, que cette lettre m'a fait beaucoup de plaisir, quoique pour le présent elle ne me soit d'aucun avantage ; je dois espérer qu'il se présentera des occasions où il pourra me rendre quelque service ; en attendant donnés-moi tout de suite de vos nouvelles, et mandés moi si vous avés reçu la lettre de ma chère mère, vous me dirés peut être que je suis un peu trop pressent, mais je puis répondre à celà par les sentiments les plus inviolable de la plus sincère et de la plus tendre amitié, joints au respect avec lequel j'ai l'honneur d'être votre fils, ami, et serviteur très affectueux
Lascaris
*
Le marivaudage continue
A Belval ce 12 Mars 1764
Madame
Je comptois, ma très chère amie, de passer dans ce pais une partie du mois d'Avril ; il est nécessaire cependant que je joigne le régiment le 16 du courant pour passer les revues des commissaires ; ainsi je vous prie d'adresser vos lettres à Dunkerque, en cas que vous vouliés bien m'accorder des nouvelles de votre santé, que je désire depuis assés long-tems ; j'espére que vous ne m'en refuserés pas, quand ce ne seroit que deux lignes pour renouveller ces tendres assurences que j'ai vivement souhaitées depuis le premier moment de notre connoissence, j'espére en même tems que vous pardonnerés des importunités qui prennent sa source dans un coeur respectueux, tendre et reconnaissant. J'ai reçu des nouvelles de ma chère mère, elle me marque qu'elle vous a écrit la lettre que vous lui demandés, et me fait une morale, où elle m'indique les moïens qui doivent me rendre digne de vos bontés. Croiés-vous que j'ai besoin de contrainte, ou des conseils, pour suivre vos volontés ? Non soyés-en assurée, quoique j'en sache bon gré à qui veut bien m'en donner, j'ai un coeur qui est trop plein de vous, pour ne pas se faire gloire de vous obéir et m'inspirer les sentiments tendres et respectueux avec lesquels j'ai l'honneur d'êre, ma très chère mère, votre très affectionné fils et serviteur
Lascaris
*
Dunkerque ce 23 Mars 1764
Madame
Je suis arrivé dans cette ville le 20 du courent, et j'espérois à mon arrive de recevoir de vos nouvelles, je n'en ai pas trouvé cependant, et le régiment a reçu ordre de partir demain pour Mesiére. Je me suis instruit si la route que nous faisions approchoit de Paris, mais on m'a assuré que je fairois le double de chemin si je faisois ce voïage, je suis par conséquent obligé de suivre le régiment malgré l'envie que j'aurois de vous voir si le régiment passoit à portée de la capitale ; à vous dire vray je ne sai que penser, quand je rapele toutes les assurences d'amitié dont vous m'honnorés et que vous me refusés en même tems la satisfaction de recevoir un peu plus souvent de vos nouvelles ; ne vous en fâchés pas, je crois que vous ne m'aimés pas assés pour m'épargner des inquiétudes qui vous paraissent légères parce que vous ne les éprouvés pas. Je vous demande mile pardon si je vous importune si souvent sur le même sujet, je n'y reviendrai plus, et je soufrirai patiemment, d'hors en avant, le chagrin de l'incertitude, ou si vous voulés me punir de mon importunité, jugés-moi comme un fils respectueux et comme un ami tendre et sincère tel que j'ai l'honneur d'être, ma très chère mère et amie
Votre très affectionné fils et serviteur
Lascaris Vintimille
Si vous me faite l'honneur de m'écrire, adréssés vos lettres à M.... au Régiment Royal Italien en garnison à Mesière.
Emilie se dévoile d'une drôle de façon. Elle veut un mari mais présente la chose de manière curieuse. Voilà : ce serait pour un mariage blanc. Elle n'est donc pas mariée? Où est passé M. de Saurin ? On ne le voit jamais. Existe-t-il seulement ?
Le jeune comte de Lascaris pense, lui, que s'il se marie ce sera très sérieusement, pour perpétuer son nom. Toute cette histoire lui semble cocasse.
Emilie n'est pas très franche. Ce qu'elle ne dit pas, on peut le dire à sa place : elle voudrait bien s'appeler Comtesse de Lascaris de Vintimille, c'est quand même plus décoratif que Mme de Saurin. Moyennant quoi elle ferait une petite pension à son mari postiche. Cela se faisait beaucoup à l'époque : Mme du Barry, par exemple, ne vit son comte de mari que le temps du contrat de mariage, ensuite il regagna sa province et elle, le lit de Louis XV. Mais Lascaris ne comprend rien à demi-mot : il est trop jeune.
Du coup Emilie mitonne un voyage à Londres.
A Mesière ce 7 Avril 1764
Madame
J'ai reçu vos deux chères lettres à mon arrivée dans cette vile, qui a été le 5 du courent, je ne puis pas vous exprimer combien je suis sensible à toutes les marques d'amitié et de bonté que vous me témoignés, chaque trait me découvre une âme sensible et généreuse si vous me connoissé comme vous dites, vous pouvés juger de ma reconnoissence, elle changeroit de nom pour peu qu’elle augmentât.
Vous ne me rendés pas justice quand vous croiés que je doute de vos sentiments à mon égard, parce que je voudrois de tems en tems recevoir de vos nouvelles. Ils me sont trop connus, pour en douter un seul instant, et si un pareil malheur m'arivoit, je l'atribueroit plutôt à mon peu de mérite et à mon étoile, qu'à votre coeur, toutes les fois donc que je vous écris, je ne demande pas que vous répondiés à mes lettres, mais je ne voudrois pas passer les deux mois sans en recevoir.
Je vous demande mile pardon, mais je n'ai pas pu m'empêcher de rire à l'article de votre lettre où vous me dites si j'accepterois une femme avec une fortune, à condition de garder le célibat, je vous assure que la plus grande partie des maris voudraient bien avoir mis cette clause dans leur contrat, mais comme je suis garçon, et en état de remplir mes devoirs, je crois que la chose mérite une explication, savoir si c'est une femme qui me metroit dans l'impossibilité de m'en acquitter par son âge, par ses infirmités, ou si c'est quelqu'autre qui veut un mari pour la forme seulement. Voilà ma très chère amie ce que je vous prie de m'expliquer, et puisque vous m'invités à penser tout haut, je vous dirai premièrement que je serois très flaté de pouvoir relever ma branche, c'est un désir naturel et que je me dois, que je n'éxécuterai pas cependant, si les conditions qu'on me propose pour y parvenir ne sont pas convenable, et analogue à ma façon de penser, et si elles n'obtiennent pas l'aprobation des personnes qui pensent bien, et je suis trés-assuré de l'obtenir, si je suis vos conseils. Je vous prie par conséquent de penser tout haut à mon exemple et me parler avec la même liberté que vous parleriés à votre fils, à votre ami, et à quelqu'un qui vous soit tout, et qui vous aime, par inclination et par reconnoissence.
Vous me dites, dans votre seconde lettre, que vous serés forcée de faire un voiage à Londre pour vos affaires, et que ce sera un voïage de trois semaines ; vous me marqués en même tems que vous êtes charmée que je sois içi, parce que je suis plus prés de vous, vous n'avés pas réfléchi que pour aler à Londre, il faut que vous vous embarquiés à Dunkerque ou à Calais, que je n'aurois eu par conséquent que quatre lieues à faire pour aler à Calais, et vous dire adieu, j'étois enchanté de sortir de Dunkerque, mais je regrette vivement le plaisir que j'aurois eu de vous voir sans faute si j'y étois resté, mais que faire, je ne suis pas heureux. C'est à vous, ma chère et tendre amie, d'adouçir mes regrets en m'écrivant avant votre départ, j'espére que vous attendrés le mois de Mai à cause de la saison, et vous fairiés une folie de partir avant ; je vous demande en grâce de m'écrire votre arrivée dans ce pais-là, je crains fort que vous n'y fassiés un plus long séjour, écrivés moi toujours votre départ et votre arrivée, si vous aimés votre fils. Quant à mes affaires oeconomiques, quoiqu'elles aient été un peu dérangée par cette route de 13 jours, j'espére qu'elles seront bientôt remises, parce que la garnison n'est pas dispandieuse. Pour mes occupations, dés que je serai arrangé je suivrai vos conseils, je foirai vos compliments en écrivant à ma chère mère, et croiés que je serai toute ma vie votre fils respectueux, votre tendre et fidel ami
de Lascaris
Je vois que ma lettre est trop longue, je vous souhaite un peu de patience pour la lire.
*
Cela se précise ! Emilie, qui a du goût pour les affaires ecclésiastiques, propose au jeune Lascaris un marché incongru : le faire abbé et néanmoins vivre avec lui. Elle lui chante, avec cent ans d’avance, le fameux air de la Grande Duchesse de Gérolstein:
Dites lui, qu'on l'a distingué, remarqué...
Dites lui... (Je parle pour elle)...”
Car la femme inconnue dont elle fait un portrait si avantageux, c'est elle, naturellement ! Lascaris, qui n'est pas sot, comprend à demi-mot, mais reproche à Emilie de ne pas dévoiler entièrement sa pensée.
A Mezière ce 13 Avril 1764
Madame
Je n'hésite pas, ma trés-chére amie, à répondre à votre lettre je vous demande mille pardons si je n'ai pas bien saisi le sens de votre première, vous conviendrés, j'espère, que la chose n'était pas bien claire, puisque vous ne me parlés ni d'ordre, ni d'abbaïe ; d'ailleurs je m'attendais si peu à une proposition pareille, que quand même vous auriés parlé plus clair je n'y aurois rien compris ; je puis à présent m'expliquer mieux et vous parler comme à une personne qui a pour moi le coeur d'une tendre amie, et d'une mère encore plus tendre.
Je vous dirai premièrement que j'ai une répugnance invincible pour l'état écclésiastique, et qu'il n'y a point d'avantage, pour grand qu'il puisse être, capable de me la faire surmonter. Celà n'empêche point cependant que je ne respecte infiniment les personnes qui, dans cet état, remplissent leurs charges avec dignité ; pour ce qui regarde la femme dont vous me faites un portrait si avantageux, je me tiendrois fort heureux de la posséder, et la médiocrité de sa fortune seroit le dernier objet de mes attentions, si la mienne étoit suffisante pour la rendre heureuse, et la mettre dans le rang qui lui convient ; au reste j'aimerois mieux vivre tout le tems de ma vie dans les emplois subalternes militaires, et garder le célibat, que jouir de grands revenus à la tête du clergé, voila ma chère amie ma façon de penser là-dessus ; je suis persuadé que vous m'accuserés de caprice, et même de folie, mais si ç'en est une il n'y a rien au monde qui puisse me faire changer ; et tout ce que je craindrois le plus en pareille circonstance ce seroit la perte que je pourrois faire de votre estime et de votre amitié, qui est le plus grand bien que je connoisse.
Vous me dites que si j'ai le coeur libre, l'embition seule faira mon occupation. Je vous dirai que dans la suposition que je sois embitieux, mon embition ne seroit pas satisfaite par les seules richesses, je suis passionné par tout ce qui peut m'attirer la considération et l'estime des personnes sensées ; je souhaiterois être riche pour moi et pour les miens, je ne le serai jamais cependant au dépend des sentiments de mon cœur; n'alés par croire pour ça que j'ai quelque inclination, mon coeur ne connoit jusqu'à présent que l'amitié, il est vray que c'est une amitié qui l'occupe entièrement, mais enfin je crois qu'elle ne m'inspire pas cette grande répugnance pour l'état que vous proposés.
Vous me rendés justice quand vous croies que je ne fairai rien sans le consentement de ma chère mère et de mes amis ; je l'aime trop pour lui causer le moindre chagrin, pour mes amis, ils ne sont pas en grand nombre, il n'y a que vous en qui je puisse avoir une confience sans réserve. Je voudrois que vous puissiés lire dans le fond de mon âme, comme vous paroissés le souhaiter, vous vérriès qu'elle vous est entièrement dévouée pour la vie ; et que je ne vous cache rien de ce que vous voulés savoir ; je doute que vous en fassiés autant, vous craignés de manquer à la prudence. Je ne vous en sai pas mauvais gré, mais il me paroit que vous auriès pu me dire qui vous a suggéré la proposition que vous m'avés fait dans votre dernière lettre pour l'état écclésiastique, je doute qu’elle vienne de vous.
Je suis enchanté que le voïage de Londre soit rompu, quoique il me paroit que vous ne l'assurés pas, je n'ai pas osé vous témoigner mes inquiétudes là-dessus, mais j'espére d'en être quitte pour la peur.
Vous vous proposés de faire un autre voïage à la campagne, et vous voulés savoir comme je suis en linge, cette demande m'embarrasse, et je crois en deviner la raison ; je puis vous satisfaire là dessus à condition que vous n'oublierés pas que je suis votre fils par adoption seulement, ma lettre est à présent trop longue, je réserve ce pauvre détail à un autre occasion.
Les dernières lignes de votre lettre m'ont causé l'émotion la plus tendre que j'ai jamais éprouvé. Oui ma chère amie, aïes toujours pour moi le coeur d'une tendre mère, prenés sa place j'y consens, mais je ne consentirai jamais que vous en aïés les charges, aimés moi, je fairai de mon mieux pour mériter une affection si chère, et soies assurée de ma plus vive reconnoissence et du profond dévouement avec lequel j'ai l'honneur d'être, Madame
Votre très humble et très obéissant serviteur et fils très affectionné
Lascaris
Continuation de la lettre précédente, mais avec des attendus inattendus. Emilie commence par reprocher au jeune Lascaris de faire évoluer l'amitié qu'il éprouve pour sa tendre mère (elle) vers des sentiments moins maternels, puis elle cherche à connaître les espérances du jeune homme. Désire-t-elle l'épouser ? Il y parait bien. Car en future bonne ménagère elle s'inquiète même de l'état de ses chemises...
N'oublions pas que pendant ce temps Emilie, à Paris, dans la meilleure société, continue à fréquenter des gens comme Gentil-Bernard, à sortir, aller au spectacle... Mais certainement elle se sent très seule et voudrait faire une fin : elle a vingt-huit ans.

A Mézière ce 22 Avril 1764
Madame
En réponse à votre chère lettre, je vous dirai en premier lieu que je ne vous ai jamais soupçonée de vouloir forcer mon inclination. Je sai, ma trés-chére amie, qu'un pareil projet n'est pas dans votre caractère ; je ne vous cache pas cependant que la demande en question, venant de vous directement ou indirectement, m'a fait un peu de peine ; je vous suis nonobstant redevable de votre intention, quoi que vous ne devès pas avoir besoin d'un secours étranger pour lire dans le fond de mon âme, soiès assurée qu'elle est toute à vous, et qu'elle n'aspire qu'au bonheur de vous en convincre.
Vous me dites que l'Amour succédera chés moi à l'amitié, et que le premier sentiment détruira le second, permétés que je vous fasse observer que l'amitié que j'ai pour vous, est pour le moins aussi tendre, et plus solide que l'amour même ; qu'elle est à l'épreuve d'une longue absence, que ce n'est pas enfin l'ouvrage d'un jour, ni un effet du caprice, mais elle est fondée sur les qualités du coeur et de l'esprit. Ainsi ma chére-amie, quand même vous diriés vray, vous serés toujours l'objet de mes plus tendres veux, vous ne sauriés par conséquent faire mon bonheur au dépend du votre.
Je vous remercie de l'intention que vous avés de faire quelque chose pour mon avancement, la perspective que j'ai devant moi n'est pas heureuse : Mr de Botta est arrivé de Paris, il a trouvé que tout le monde est brouillé avec l'Evêque de Toulon ; il m'a exorté à prendre patience, à me distinguer, et qu'il fairoit de son mieux pour me faire valoir.
Vous voulés savoir quels sont mes biens, et de quele nature. Je vous dirai que je n'ai que du bien segneurial. Il consiste en deux fiefs, La Brigue, et Gorbis, ils sont considérables tous les deux s'ils étoient liquidés. Le premier a été démembré pour des dot, et le Roy de Sardaigne en a acheté la troisième partie de mes ancêtres, en sorte que je n'en ai que la troisième partie, sauf le droit de pouvoir le racheter en païant les dots. Le second est la même chose, je n'ai par conséquent que la troisième partie de deux ; ce sont deux fiefs impériaux dans la Comtée de Nice. Le premier contient environ quatre mile abitants et le second cinq ou six cents. Les abitants ne doivent au Roy que l'omage de fidélité, ils ne paient par conséquent ni tailles ni impôts ; excepté en tems de guerre ; chaque abitant est obligé de païer au seg.r à la place. Les dot qu'il y a à palier pour ravoir ces biens peuvent monter à 80 mile francs, et les deux terres en rendroient au moins une trentene de rente ; il est vray qu'il faudroit emploïer un peu de tems, et il y auroit quelque dificultépour l'augmentation qu'on y a fait depuis ; ainsi mon bien consiste dans quelque fond de terre, dans les dimes, dans les feux que chaque abitent est obligé de païer ; mais je serois fort embarrasser de vous dire ce que ça rend, puisque depuis la mort de mon père qu'à peine j'ai connu, mon oncle s'est enparé de tout en qualité de tuteur ; et a négligé non seulement les chataux, mais les biens aussi. Il y a en outre un fidéi-comis dans la famille qui concerne une terre qui est en Provence. Elle est de 7 ou 8 mile livres de rente, mais il faudroit procéder au Parlement d'Aix, avec beaucoup de particuliers, qui aïant épousé des Lascaris, ont partagé tout uniment entr'eux. Voilà ma chère amie tout le compte que je puis vous rendre de mes affaires domestiques ; il seroit trop long si j'entrois dans toutes les raisons qu'il y a dans la famille.
Vous me demandés un mémoire de ce que j'ai, je veux vous obéir à condition que vous vous rapelerés de ce que je vous ai dit à ce propos dans ma dernière. Premièrement j'ai 18 Chemises bonne pour la garnison, mais je n'en ai pas six de propre. Un âbit d'hiver, que j'aurois déjà quitté, si cette route ne m'avoit pas mis dans l'impossibilité d'en faire un neuf, un âbit d'été assés passable, quatre ou cinq paires de bas de soye, voilà tout mon équipage, vous voiés ma chère amie que je ne puis pas être brillant ; je fais de mon mieux cependant pour être toujours d'une honnete propreté.
Je vous remercie des soins que vous vous êtes donnée pour me faire entrer dans une maison qui est prés de Mézière, faites attention cependant que je ne suis pas trop dans le cas d'être faufilé dans les maisons où il faut dépenser, je vous assure ma chère amie, que je ne m'aperçois que je suis à l'étroit qu'autant que je ne puis pas fréquenter les personnes que je voudrois.
Aurés vous la patience ma chère amie de lire une aussi longue lettre et si enuyeuse ? Je doute que vous la tirés sans vous impatienter. Réfléchissés cependant que c'est pour répondre à tous les articles de la votre ; pour ne pas l'alonger davantage je suis et serai toute ma vie, ma très chère amie,
Votre très humble et obéissant serviteur et fils très affectionné
Lascaris
Emilie (qui est une personne industrieuse) s'adresse maintenant à la maman pour savoir de quoi retourne la succession de la brillante famille de Lascaris.
Madame Lascaris de Vintimille à Madame de Saurin
Nice ce 25 Mai 1764.
Je suis enchantée, ma très chère et aimable Dame, des nouvelles marques d'amitié que vous me donnez dans votre trés-obligeante lettre du 10 de ce mois, aussi bien que de la générosité avec laquelle vous cherchez tous les moïens pour secourir mon pauvre fils. Je remercie tous les jours le Seigneur de la grâce qu'il lui a fait en lui faisant trouver une mère si tendre, si affectionnée, et si généreuse, à la place d'une pauvre et misérable, qui bien loin de lui pouvoir donner du secours, lui seroit à charge. En vérité j'ai de la répugnance à faire ce que vous me demandez, car il me paroit beaucoup que vous soiez la protectrice de mon fils pour ce qui regarde son avancement, sans que vous vouliez encore vous donner les soins de liquider ses prétentions.
Cependant, le pressant besoin où il se trouve, et la grâce et bonté avec laquelle vous vous offrez, ont surmonté ma délicatesse. Je vous envoie un abrégé des biens et prétentions de mon fils, et je ne doute pas que l'appui d'une personne de votre mérite et de votre qualité ne fasse bientôt finir avantageusement ses affaires.
Les biens de mon fils consistent présentement aux deux fiefs et juridictions de La Brigue et de Gorbio, avec les biens féodaux annexés aux dits fiefs. Ces biens sont entre les mains d'un oncle et d'une tante, frère et soeur à son père, et peuvent à peine suffire à leur entretien, ne rendant que quatre ou cinq cens livres, quoique s'ils fussent travaillez et cultivez comme il faut, fussent susceptibles du triple de rente. Après la mort de mon mari, le 4 Mai 1747, ces oncle et tante se sont emparés de ces biens, et ne me seroit pas difficile de les en chasser, si je ne fesois réflexion qu'ils sont à la veille de les quitter eux-mêmes à cause de leur grand age, l'oncle étant âgé de 75 ans et la tante de 70 ; par conséquent tout le monde me blameroit si j'entreprenois de les chasser de ces biens, outre que je serois obligée de leur en laisser la plus grande partie pour leur entretien. Ils ne sont mariés ni l'un ni l'autre ; et ces biens sont au Comté de Nice sous la domination du Roi de Sardaigne, et par conséquent hors du ressort du Parlement d'Aix.
Mon fils a d'autres raisons et prétentions dans les états du Roi de Sardaigne, comme par exemple sur la Comté de Tende et plusieurs autres fiefs que la branche aînée de la Maison de Lascaris Vintimille a toujours possédé en toute souveraineté, jusqu'à ce que cette branche ayant fini en une fille qui fut mariée à un prince de la Maison de Savoie, et les enfans de cette fille s'étant établis en France, leurs descendons ont vendu cette Comté et les autres fiefs au Duc de Savoie vers la fin du seizième siècle. Les filles n'avoient aucun droit de succéder à cette Comté ni aux autres fiefs, et par la mort du dernier Comte de Tende de la maison Lascaris sans mâles dévoient être dévolus à la branche de mon fils qui devint l'aînée ; mais comme j'ai eu l'honneur de vous dire, tous ces fiefs sont entre les mains du Roi de Sardaigne, qui les acquit partie par échange avec d'autres terres qu'il possédoit en France, et partie par achat des successeurs d'Anne Lascaris, fille unique de Jean Antoine, dernier comte de Tende de la Maison de Lascaris ; et il ne faudroit pas moins qu 'une armée de soixante mille hommes pour se les faire restituer.
La République de Gênes possède aussi, depuis le commencement du treiziéme siècle la Comté de Vintimille, ancienne souveraineté de nos ancêtres, qui furent chassés de Vintimille et d'une grande partie du Comté en suite d'une longue et sanglante guerre qu'ils furent obligés de soutenir contre toutes les forces de la République de Gênes, qui en ce tems là etoit trés-puissante, ce qui les obligea de transférer la résidence dans la ville de Tende ; mon fils en qualité d'aîné de la maison des Comtes de Vintimille a aussi droit sur cette Comté.
Je trouve qu'il est inutile de vous informer de ces faits, mais comme vous me demandez un détail exact, je me suis crue obligée de vous les mander, et pour que vous puissiez mieux les comprendre je vous envoie ci-inclus un arbre généalogique de notre maison, par lequel vous sera plus aisé de vous éclaircir de l'origine et des prétentions de notre maison.
Mon fils a aussi d'autres prétentions en France, sur le fief et biens de Deuxfréres, diocèse de Vence, qui autrefois étoit uni à la Comté de Nice, et a été cédé à la France et uni à la Provence, par le traité d'échange conclu à Turin en 1760 entre les Rois de France et de Sardaigne ; et comme ces ces raisons peuvent être facilement liquidées, je vous les détaillerai suivant votre ordre dans un papier séparé que vous trouverez ci-inclus ; ces raisons sont audelà de cinquante mille livres, et les aurois demandées depuis longtems si j'avois eu des forces pour suppléer aux dépenses qu'il faut faire, tant pour chercher une quantité de papiers nécessaires, que pour commencer et soutenir le procès ; mais mon impuissance est cause que les usurpateurs jouissent tranquillement de ces biens ; ce sont les Mrs Martini, partagez présentement en trois branches qui ont eu ces biens par Jeanne Lascaris, soeur de César, dernier mâle de cette famille, laquelle épousa Amédée Martini, comme vous verrez mieux dans la généalogie insérée à la ci-incluse note (1).
Veuille le Ciel seconder votre zéle, et inspirer les moïens les plus courts et les plus efficaces pour venir à bout de vos justes et généreux desseins. Je ne voudrois pas cependant que les prétentions de mon fils vous fissent perdre de vue son avancement qui pour le présent est son unique ressource. Je prie le Seigneur qu'il vous donne la force de soutenir l'un et l'autre, avec une longue vie remplie de toute sorte de bonheur et de prospérité ; et à moi les moïens de vous convaincre de la tendre amitié et de la plus vive reconnaissance avec laquelle je serai toute ma vie
Ma Chère Dame,
Votre trés-obligée et trés-affectionnée amie,
La Comtesse Lascaris de La Brigue.
__________
(1) : Cette généalogie a disparu des papiers d'Emilie.
J'avois dessein de vous envoïer l'arbre généalogique de toutes les branches de notre maison, mais comme içi on ne peut affranchi les lettres que jusqu'au delà du Var, je n'ai pas osé vous faire faire cinq ou six livres de fraix de poste. Je vous envoie seulement une généalogie qui commence par [?] pour prouver les droits sur le fief et biens de Deux fréres.
Le Comte de Lascaris fait une déclaration à Emilie
C'est un amour tout à fait romantique ! On y échange des malheurs. Emilie veut se marier, elle veut aussi aller à Londres retrouver trace de ses parents. Du coup le jeune comte de Lascaris découvre sa passion à Emilie : elle n’est pas naissante, elle date de bien plus longtemps. Par contre, en homme d'honneur, il refuse carrément qu'elle l'entretienne.
A Mézière ce 26 May 1764
Je n'ai pas besoin, ma très chère amie, de mettre à l'épreuve votre amitié et votre coeur pour être convincu de la sincérité de l'un et de la bonté de l'autre ; vous ne me rendriés pas justice, si vous doutiés un seul moment du retour, et si vous êtes occupée de ce qui me regarde, soies assurée que je le suis incessemment de tout ce qui a du raport à vous même. Quoique j'ignore vos affaires et vos malheurs, le désir que j'ai de les partager fournit à mon imagination des idées capables de m'affliger pour le moins autant que si j'étois au fait de tout ce qui vous regarde ; vous vous trompés par conséquent quand vous dites que je suis plus heureux que vous ; vous me forcés à vous découvrir mon âme par le triste sujet que vous traités dans votre lettre, vous vérrés ma chère amie, que ni je suis heureux, ni il y a aparence que je le sois de la vie.
Vous ne pouvés juger de l'état de mon âme qu'en vous faisant l'aveu de ce qu'elle renferme, je sai que je risque de perdre votre amitié, mais les nouveaux engagements que vous projetés, et la volonté de vouloir me servir de mère en tout, m'oblige à vous découvrir qu'il y a long-tems que vous êtes le seul objet de mes plus tendres désirs. Oui ma trés-chére amie, il y a long-tems que mon coeur a renoncé, à votre égard, à la simple amitié ; n'alés pas dire que j'ai abusé de votre confience, ma situation présente et le peu de connoissence que j'ai de ce qui vous regarde, m'empêché de vous ouvrir mon cœur ; vous le voiés à présent tel qu'il est ; pour ce qui regarde vos engagements, je ne puis que plaindre mon sort et ma position ; qui n'est pas assés heureuse pour pouvoir vous offrir, avec un coeur tendre et respectueux, une fortune brillante ; par l'aveu sincère de mes sentiments, vous pouvés juger de l'état de mon âme, et sentir combien je suis à plaindre à tous égards, je me croirai cependant assés heureux si vous conservés pour moi cette tendre amitié que vous m'avés tant de fois témoignée.
Pour les engagements qu 'on vous propose de contracter, permétés que je vous observe qu'il n'y a aucune affaire pour importante qu'elle puisse être, qui doive vous obligee à sacrifier votre repos, en faisant quelque chose qui répugne à votre coeur. Vous êtes née pour faire le bonheur de celui qui sera assés heureux pour vous plaire, votre félicité par conséquent ne dépend que de vous ; en mon particulier, ma chère amie, je partageai toujours vos plaisirs et vos peines, je formerai des veux pour que le bonheur vous suive constemment, et pour n’avoir d'autres liens que ceux qui m'attachent à vous, je vivrai toute ma vie pour l'amitié. Je vous remercie des soins que vous avés pris pour ce qui regarde mes intérêts, quoique je crois qu'il sera assé dificile dé faire nomer un étranger pour mon tuteur ; d'ailleur il faudroit procéder avec mon oncle paternel ; j'en écrirai au premier jour à ma chère mère ; et pour quelques affaires particulières je suis persuadé que ce conseiller au Parlement pourroit me rendre service, aiant du bien à liquider en France dans le département du Parlement de Provence.
Après l'aveu que je vien de vous faire, ma chère amie, je ne puis vous envoïer ce que vous demandés, pour ce qui regarde l'éxécution de ce que vous vouliés faire pour moi ; metés-vous à ma place, ma chère amie ; vous vérrés que je ne puis ni dois vous être à charge jusqu'au point que vous le désirés ; vous êtes mon juge et ma plus tendre amie ; vous ne devés rien exiger de moi qui puisse vous donner la moindre occasion de douter de mes véritables sentiments ; vous avés été chargée par ma chère mère de tenir sa place, mais elle ignore certainement la place que vous tenés dans mon cœur ; ainsi votre amitié, si j'en suis digne, est tout ce que je vous demande, et tout ce que vous pouvés m'offrir. N'aiés nule inquiétude de ma situation, ne cherchés qu'a vous faire un sort heureux, je sentirai moins, et la perte de tout ce que j'ai de plus cher, et le poid de tous les désagréments de la vie ; soiés asurée que je vous aimerai toujours, quelqu'évènement qui puisse ariver et que je serai toute ma vie
Votre très humble et très obéissant serviteur et ami très affectionné
Lascaris
*
Le voyage à Londres
Emilie a fait le saut : la voilà partie pour Londres. Elle va rechercher ses parents, éclaircir le mystère de sa naissance. Après avoir proposé le mariage au comte de Lascaris, j'ai l'impression qu'elle ne sait pas très bien ce qu'elle veut. De Paris, Gentil-Bernard, qui l’aime tendrement, la suit des yeux dans ses déplacements : elle est descendue à Rouen chez M. Horrutence, un banquier dont je ne sais rien de plus que ce qui s'en dit dans les lettres.
A Paris le 26 (mai 1764)
Je nay qu'un moment ma belle amie pour accuser la réception de votre lettre de Roüen qui mapprend votre arrivée en cette ville, vous faites bien de donner à lamitié les soins quelle mérite de vous. Je prends part à la santé de M. Horrutence et je suis sur que votre présence sera le meilleur beaume et le plus propre à son rétablissement que je désire ainsi que vous. Je vous remerçie du détail que vous me faites de vos dispositions avant votre marche, il me paroit que vous avés obvié à tout avec votre intelligence ordinaire. On ma apporté vos clef qui sont en dépôt ainsi que vos cassettes; on ne m'a point encore remis de lettres pour vous, je seray fidèle à l'instruction que vous me donnés et jattendray vos ordres, mes voyages de Choisy pourront apporter peut être quelque retard à mes envois, mais ils ne peuvent être que d'un ou de deux jours ; prenés soin de votre santé, surtout point d'exercices violent, modérés vous surtout à la chasse. Je vous conseille de suivre plutôt la marche modérée de votre hôte que celle de vos toutous que j'embrasse. Mille bonjours à belle dame que j'assure de mon respectueux et éternel attachement.
Paris le 31 may. (1764)
M. Nerel vient de me remettre la lettre cy jointe que je vous adresse à Calais, je souhaite, Madame, que vous y arriviés à bon port. Jay été fâché d'apprendre que vous étiés partie si tard de Paris, je crains que vous n'ayés pu arriver le même jour à Roüen. Votre fatigue en aura été plus grande. Je ne suis point en peine de votre séjour en cette ville, votre hôte, auquel je vous prie de vouloir faire mes compliments, vous l'aura rendu agréable, et ses conseils ne peuvent que vous être fort utiles pour la route quil vous reste à faire. Vous m'avés flatté de me donner un mot de vos nouvelles en partant de Calais. Je vous rapelle cette promesse et je vous en demande l'éxécution par l'interest sensible que je prends aux évènements de votre course. Je viens d'apprendre des nouvelles de votre domicile, tout s'y porte bien, oiseaux, bêtes et gens. Les toutous sont fort gais malgré l'absence de ce quils aiment. Me d'Aimés vous fait ses amitiés. M. Nerel vous présente ses respects. Recevés l'assurance des miens. Je me hâte de clore ce billet pour que le courrier l'enlève et le porte au bord de lamer que vous allés traverser. Je fais ma prière au dieu Neptune pour quil vous soit favorable, et je vous réitère, Madame, l'assurance de tous mes voeux et la protestation de mes hommages.
Toutou fils à sa belle maîtresse
Malgré tous les soins qu'on à de moy, je trouve le temps bien long ; jay toujours la tête à la fenêtre pour voir venir maîtresse, j'aboyé quand on sonne, croyant la voir entrer, cependant je mange et dors bien ; il a fait si chaud que ma robe m'incommodoit fort, j'ay dit à maman Dalmés de me faire tondre, comme sa petite, et je suis fils fils tondu, beau à ravir. Maîtresse ne me grondera pas sil luy plaît. On dit qu'il y a les plus beaux toutous du monde dans le pays où vous estes ; ah! Maitresse, si vous en aimés quelqu'un plus que moy, toutou fils vous reverra, pleurera et mourra dans vos bras. Papa vous dit bien des choses, mais que j'en sens bien plus que luy !
*
On le voit, Toutou fils (par le truchement de Gentil-Bernard) prend bien le départ de sa maîtresse ; il n'en est pas de même du comte de Lascaris, qui au fond de sa garnison de Mézières, se désespère.
Le Comte de Lascaris à Emilie
A Mézière ce (?) May 1764
Madame
Je n'ai pu ma chère amie répondre tout de suite à votre lettre ; mes réflexions auroient été trop triste le moment après en avoir fait la lecture, et j'ai eu beaucoup de peine à me résoudre pour répondre à tous les articles. Votre estime, votre amitié et tous les sentiments qui prennent sa source dans votre coeur fairoient le bonheur de ma vie si je n'étois dans l'impuissance de pouvoir vous témoigner ma sensibilité par des endroits flateurs pour un coeur qui vous est entièrement dévoué ; la confiance que vous m'avés fait d'une partie de vos malheurs m'a pénétré jusqu'au fond de l'âme, ne me privés pas autant qu'il est possible d'une confiance qui m'est si chère, ne craignés pas de m'atrister, quoi que mon coeur en seigne, et que je sois attendri jusqu 'au larmes, je préfère cette situation à la joye la plus parfaite.
Ne dites pas, ma chère amie, que l'opposition à mes désirs se trouve dans votre âme, et que vous devés combattre un désir qui fairoit peut être le malheur de ma vie, à ces sentiments on reconnoit l'amitié toute simple, mais si j'étois assés heureux pour être aimé de vous un jour, autant que je vous aime, je suis persuadé que vous ne trouveriés point d'obstacle à notre bonnheur mutuel, on peut aimer sans être ni riche ni heureux, en mon particulier qui ne suis ni l'un ni l'autre, je sai que je vous aimerai toute ma vie quoique ma situation et beaucoup d'autres obstacles, qui paraissent presqu'invincibles, s'oposent directement à l'objet de tous mes voeux. Ainsi ma chère amie, quoique selon vous je sois fait pour le bonnheur et les plaisirs, je rennonce absolument à tous ceux que je ne puis pas partager avec vous.
J'ai eu beaucoup de peine à me résoudre pour vous envoyer le détail que vous exigés de moi, je vous l'envoie cependant de crainte d'être taxé de ridicule ou d'entêté ; mais ma chère amie faites attention que je me croirois indigne de vivre si vous faisiés quelque chose pour moi qui pû nuire la moindre chose à vos propres affaires, mes regrets seroient sans fin, et j'aimerois mieux vous perdre de vue pour quelque tems que de vous causer la moindre petite peine, ainsi si vous paie de retour un coeur qui vous aime tendrement, ne consultés ni ma situation ni le peu de ressource que j'ai, ce seroit me mettre dans le cas de vous perdre pour toujour, consultés le tems et les circonstances. Pardon, ma chère et tendre amie, si je prend la liberté de faire des remontrances, je n'en fairois point si la tranquilité de mon coeur n'en dépendoit.
Je vous préviens qu'il n'y a pas du tout d'aparence que le régiment reste içi plus de quatre ou cinq mois, quel chagrin si j'étois forcé de m'éloigner de vous plus que jamais. Métés vous à ma place, il est moralement impossible que je sois tranquile un moment ; plaignés-moi ma chère amie, et cherchés un moyen, s'il y en a un, qui soit capable de me rendre plus suportable une aussi longue et cruelle absence, je m'en raporte à votre amitié, qui m'est aussi chère que ma vie, ne restés pas long-tems sans m'écrire, et dites-moi si ma chère mère a fait réponse à votre lettre. Soyés assurée de ma plus vive reconnoissence, et des sentiments les plus tendres et les plus sincères avec lesquels je serai toute ma vie, ma très chère amie,
Votre très humble et très obéissant serviteur
Lascaris Vintimille
A Meziére ce 6 Juin 1764
Madame
Quoique je n'ai pas répondu exactement à votre lettre ; avés vous pu, ma chère amie, atribuer ce retardement à ma paroisse, ou à un manque d'amitié de ma part ? Je ne saurois vous oublier à moins que je ne m'oublie moi-même, vous jugeré, par la réponse que vous devés avoir reçue, conforme à toutes vos volontés, qu'une raison qui prend sa source dans la tendresse du coeur a été la cause que ma lettre ne vous a pas trouvée à Paris ; je vous envoyé dans la même le détail que vous me demandés, j'avoüe que j'ai eu beaucoup de peine à m'y résoudre, parce qu'il est naturel de ne pas vouloir être à charge de ce qu'on aime.
Vous êtes partie pour Londres, ma chère amie, sans me mander la moindre chose, j'étois content parce que je croÿois que ce voyage étoit rompu pour toujours, mais je commence à être un peu inquiet quoique vous disiés que vous n'y r esterés que huit jours, écrivés moi je vous en prie, je crains fort que l'air natal ne vous retienne plus longtems, dites moi si votre voïage a été heureux, et faites en sorte dans votre première lettre, de me mander votre départ de Londres. Quoique je ne vous voie pas, je suis plus content quand je sais que vous êtes prés de moi. Aimés moi toujours, c'est l'unique bien que mon coeur désire. Ne vous fâchés pas de mes malheurs, plus ils sont grands de part et d'autre, plus les liens de nos coeurs doivent se resserrer. Soies persuadée de mon côté que je serai toute ma vie
Votre très humble et très obéissant serviteur et très affectionné
Lascaris Vintimille
*
Gentil-Bernard à Emilie
Dimanche 3 Juin (1764).
J'ay receu hier la lettre d'Emilie dattée de Rouen du 31 du mois passé ; j'apprends qu'elle se porte bien du voyage, qu'elle se trouve bien du séjour et que son départ est retardé. Je ne suis point étonné de la bonne réception ; je souhaite aux anglois les mêmes yeux qu'à nous. Comme jay compté que vous sériés à Calais le samedy selon votre projet, jay adréssés dans cette ville une lettre que vous y trouverés de Mr de Lascaris. J'en joins icy une que je crois venir de Mad. sa mère. Elles vous mettront à portée de juger des interests de famille (1), jespére que ce paquet cy vous trouvera encore à Rouen. Si vous aviés suivi votre premier plan vous auriés pu passer la mer avec M. Macartney (2) il doit être à Calais aujourdhuy pour passer en Angleterre. Il va prendre les ordres de sa Cour pour se rendre à celle de Russie où il est nommé envoyé extraordinaire. En tout cas vous pouvés le voir à Londres si vous avés affaire de luy, peutêtre estes vous informée déjà de l’employ qu'on luy donne. Dés que jay reçu hier votre lettre jay passé chés vous pour m'informer de tout ce quy vous intéresse ; celuy qui est votre folie se porte aussi bien qu'en votre présence, aussy gay qu’à son ordinaire, avec l'indifférence et l'oubly des absents que vous pouvés luy désirer, les bêtes sont bien plus sages que nous. J'ay lu celà dans Esope. Moretto pense comme son fils. J'ay trouvé M. Nerel qui faisoit l'amour à Mad. dalmés en présence de votre chambrière. Tout se passe bien dans cet intérieur, soyés tranquille. Mad. Le Vasseur n'a rien fait remettre chés moy ny chés vous, le collier et la pomade formeront un petit paquet qu'on vous enverra par le 1er carosse, n'étant pas susceptible d'aller par lettre. Donnés moy des tracas, des affaires, des soins vous ferés mon bonheur, ne désirant que de vous marquer ce que je pense et l'attachement sincère et respectueux que je vous ay voué. Jay été fort enrhumé depuis votre départ, ce qui m'a fait retarder mon voyage de Dampierre. Je compte m'y rendre demain pour y passer quatre ou cinq jours. Je n'y seray que ce temps là, pour revenir et être plus à portée à Paris d'éxécuter vos ordres si vous m'en donnés. Vous m'écrirés un mot de Calais avant votre départ comme vous me l'avés promis, pour que je sache quel Royaume vous habités. Le votre jusquicy n'est pas de ce monde, ce qui ne fait point honneur à la justice de celuy qui les distribue.
___________________
(1) : Ce sont les lettres du 22 avril et du 25 mai 1764 du Comte de Lascaris.
(2): Lord Macartney, diplomate anglais. On a de lui un "Voyage à la Chine". Gouverneur, en juillet 1779, de Grenade, il y sera fait prisonnier par les Français de l'amiral du Petit-Thouars.
*
Gentil-Bernard à Emilie
A Paris, juin 1764.
Vous voilà donc, belle Emilie, dans le lieu de votre naissance, dans cette patrie inconnue où le ciel vous a jetté, où il vous ramène par la fatalité d'une étoile qui devrait bien en éprouver quelque autre que vous. Je souhaite que vous soyez aussi contente des habitants de Londres que de ceux de Calais ; je n'ose songer au principal objet de votre voyage. Vous êtes au fait de tout présentement et je vous désire plus de satisfactions que je n'en ose attendre.
Vous m'avez adréssé une lettre pour M. le Marquis (1) de Carracioli, croyant qu'il était içi. Vous ignoriez que sa résidence est à Londres même, où il est envoyé par la Cour de Naples. Vous l'apprendrez sans doute en arrivant et vous pourrez prendre l'éclaircissement de cette aventure singulière qui peut n'être que l'effet d'une méprise. Votre lettre me restera donc. Je ne vous envoie point une autre qui est arrivée chez vous venant de Londres d'une personne qui vous aura déjà vue. Je crois que le baron, qui se porte très bien à présent, vous a fait passer quelques lettres en vous écrivant. Je suivrais d'ailleurs ce que vous me prescrivez et j'attendrai vos ordres pour la suite.
J'aurais du commencer, sensible Emilie, par l'objet qui vous intéresse le plus ; par mes félicitations sur la plénitude de la joie que vous a causé cette lettre du Nord. Vous m'aviez mis à portée de connaître tout le prix de cet évènement ; je le partage bien sincèrement. Le Ciel vous devait au moins ce dédommagement pour adoucir le moment critique qu'il vous fait essuyer. L'enthousiasme de votre lettre ne m'a point étonné, et m'a peint votre situation de manière à me faire passer votre ravissement, savourez cette goutte céleste qui se trouve au fond de votre calice d'amertume. L'amour et l'amitié vous seront fidèles ; passez le reste à la nature marâtre.
Votre rêve de Calais n'avait pas le sens commun. Tout ce qui vous intéresse à Paris se porte bien. J'ai vu ce matin votre meute, très vive et très alerte. La gardienne ne les quitte pas. Portez ailleurs vos inquiétudes, et s'il se peut n'en ayez point. Surtout ne vous livrez point à la populaire erreur de ces rêves de chien.
Je m'acquitte de vos commissions pour la rue des Saints Pères. Je vais attendre avec autant d'impatience que de curiosité l'histoire de la reconnaissance et le dénouement de cette pièce compliquée. Je crains que l'intérêt ne roule que sur vous. C'est ce qui m'y attache, dites nous en vite des nouvelles, le plus véritable intérêt m'anime et j'en fais des protestations pour la vie à ma chère Emilie.
________________
(1): Domenico Caraccioli (1715-1789). Né à Naples. Ambassadeur à Turin, Londres, Paris, puis Vice-Roi de Sicile. C'est un lettré.
*
Le Comte de Lascaris à Emilie
A Mezière ce 26 Juin 1764
Madame
Je répond, très chère amie, à votre dernière lettre, moins pour vous témoigner les sentiments que j'ai pour vous depuis long-temps, que pour vous presser de quitter un pais qui est pour vous la source de tant de chagrins ; je les ignore, mais vous m'en parlés d'une façon à me faire trembler, et à ce que je vois, votre départ de Paris m'a affligé à juste raison, rapelés-vous que vous m'avés promis de n'y rester que huit jours, si vous tenés parole ma lettre ne doit plus vous trouver à Londres.
Cessés, chère et tendre amie, de vous affliger de mes malheurs, je ne les sent plus depuis que j'ai connoissence d'une partie des vôtres, et le coeur que vous m'offres pour me consoler est un bien qui comble mes désirs. Si j'ai quelque chagrin c'est de penser que je ne serai peutêtre jamais assés heureux pour jouïr entièrement de mon propre bonheur, je travaillerai cependant toute ma vie pour y parvenir.
Je vous remercie des peines et des soins que vous vous êtes donnés à l'égard de mes affaires domestiques, je souhaite que vos projets réussissent, et être à même de pouvoir me passer, et être indépendant des personnes qui m'accordent leur protection, pour me laisser vieillir dans l'obscurité, ce seroit un obstacle de moins à mon bonheur.
Vous me faites espérer de vous voir à Meziére, ou dans ses environs, à votre retour de Londres. Je ne saurois exprimer la satisfaction que j'aurois à vous voir, ce seroit le moment le plus heureux de ma vie. Pourriés vous pas sans conséquence négliger quelque petite affaire pour soulager un coeur qui est à vous, et qui soupire après vous ? Je m'en flate jusqu'à ce que je ne reçois de vos lettres de Paris ; en attendant si vous m'aimés tant soit peu, n'entreprenés rien qui puise troubler le repos d'une âme si belle et si chère ; en mon particulier soiés persuadée que je n'aurai point de chagrin quand vous n'en aurés point, et tant que vous m'aimerés ; mon âme est confondue avec la votre, et je serai toute ma vie
Vôtres trés-humble et très obéissant-serviteur et ami très affectionné
Lascaris
*
Gentil-Bernard à Emilie
Paris le jeudi 28 Juin (1764).
Ah! Que vous me soulagez! J'étais dans la plus vive inquiétude, je vous savais depuis quinze jours à Londres, et n'avais point encore de vos nouvelles. Votre lettre a été huit jours en chemin, et c'est ce qui m'a désolé. Enfin vous avez trouvé ce que vous cherchiez depuis si longtemps ; et si la fortune a été pour vous une marâtre, la Nature est une mère qui vous en fait trouver une digne de vous. L'enthousiasme de votre tendresse m'a fait verser des larmes, vous voyez que mon coeur me fait partager les vôtres en toute occasion. Je crains seulement que de si fortes révolutions jointes à la fatigue de vos voyages, n'altèrent votre santé. Prenez du calme et du repos ; donnez à la tendresse et à vos affaires le temps qu'elles vous demanderont, vous trouverez chez vous tout en ordre. J'y vais très souvent. Madame Dalmés est une amie digne de vous ; j'ai eu le temps de connaître ses sentiments et l'intérêt vif qu'elle prend à ce qui vous touche ; elle me le disputerait si vous n'aviez encor fortifié mon attachement et mon enchantement par des grâces qu'elle ne peut partager. Vos toutous se portent à merveille. Le Baron est à Compiégne pour le voyage ; à tout hasard je lui ai fait passer de vos nouvelles. Je crois que cette lettre ci vous trouvera encore à Londres, dut-elle être perdue, je jouis du plaisir de vous écrire, de vous féliciter, de m'attendrir avec vous. Ce n'est pas un temps perdu que celui qu'on donne au sentiment. Vous jouirez de celui de l'amitié à votre retour, il vous dédommagera des nouvelles acquisitions que vous venez de faire (1). Je vous ferais par intérêt mille et mille questions : il faut les remettre à votre retour. Faites le nous savoir, quand il sera déterminé, pour nous en donner le plaisir d'avance. J'arrangerais aussi mes petits voyages pour ne pas perdre un des moments où je pourrais goûter le plaisir de vous voir. Je fais de la lettre de M. Carracioli l'usage que vous désirez. Adieu, belle et tendre infortunée, le Ciel, j'en suis sur, vous fera perdre ce dernier épithéte. Vous savez tous les bonheurs que je vous souhaite. Les nouvelles du Nord, les découvertes de Londres, les amis de Paris doivent adoucir votre sort. Il ne manque à la félicité du mien que de vous voir de tout point aussi heureuse que vous méritez de l'être. Bonjour encore, ma charmante Emilie.
________________
(1): Emilie a retrouvé sa mère à Londres. Nous n'en saurons pas le nom.
*
Le Comte de Lascaris à Emilie
(Sans date) juillet 1764.
Madame
Votre dernière lettre m'a trop effrayé pour que je reste plus long-temps sans demander de vos chère nouvelles ; n'auriés vous fait le voyage de Londre que pour augmenter vos peines et les miennes ? Je ne puis me tranquiliser là-dessus que je n'ai reçu de vos lettres, et pour peu que vous m'aimiès vous ne me laisserés pas long-tems dans l'attente, je n'oublie point que vous m'avés promis de ne rester que huit jours dans ce païs-là et ma lettre vous y trouvera peut-être encore. Quele raison assés puissante peut vous obliger à rester dans un païs où vous ne rencontrés que des sujets de chagrin? Quittés le pour toujour, ma chère amie, et rendés vous à la recherche des personnes qui vous aiment ; il n'y a pas d'affaire, pour importante qu'elle puisse être, capable de vous retenir malgré vous, et pour me servir de vos leçon même, la vie est trop courte pour la rendre pénible.
Je n'ai plus reçu de nouvelles de ma chère mère, depuis votre dernière lettre ; je suis par conséquent en peine aussi de ce côté là, j'espère cependant que vous m'accorderés cette satisfaction en votre particulier, excepté que quelque malheur ne vous en empêche et je le craindrai jusqu'à ce que je n'en ai reçu. Aimés moi toujour ma chère amie et s'il est possible accordés moi la satisfaction de vous voir à votre retour, et vous assurer des sentiments les plus vifs et les plus sincères avec lesquels je serai toutte la vie Votre très humb. et très obi. Ser.
Lascaris
*
Madame Lascaris de Vintimille à Madame de Saurin
Nice ce 2 Août 1764
Je viens de recevoir, ma chère et aimable dame, votre obligeante lettre de Londres du 6 Juillet ; je suis charmée d'apprendre par la même votre heureux voiage et votre prochain retour à Paris.
Je vous remercie infiniment des sentimens généreux que vous avez toujour pour mon fils, et j'espère qu'il se rendra digne de vos bontés par une conduite irréprochable. Je crois vous avoir assés détaillé dans ma précédente ses raisons et prétentions sur les biens de Deuxfréres qui sont dans la dépendance du Parlement d'Aix, si vous aurez besoin de quelqu'autre explication vous n'avez qu'à me le mander. Je souhaiterois qu'on peut porter ce procès au Grand Conseil, il y a un prétexte plausible pour celà, c'est que ces terres nouvellement échangées et passées sous la domination de la France ne sont pas encore pourvues de leurs juges, en cas que ce prétexte ne suffit pas, je pense que votre appui pourra bien en faire trouver quelqu'autre. A Paris l'affaire seroit plutôt finie, et la partie contraire n'uroit pas tant de facilité de chicaner. Enfin, Madame, puisque vous voulez avoir tant de bontés, jespére que vous chercherez les moiens les plus prompts et les plus efficaces pour venir à bout de cette affaire. Je n'ai pas manqué de faire parvenir vos complimens aux Comtesses Zoya et Ramela. Je vous embrasse de tout mon coeur, et suis avec autant d'amitié que de reconnaissance
Ma Chère Dame
Votre trés-obéissante servante et amie trés-affectionnée
La Comtesse Lascaris de la Brigue
*
Le Comte de Lascaris à Emilie
Meziére le 4 Aoust 1764
Madame
Si vos amis vous ont écrit tout le courier, je vous aurois écrit tous les jours, ma chère amie, si j'avois pu penser que mon silence qui n'a pas été bien long cependant, eut pu vous causer la moindre inquiétude. Par ma lettre que vous devés avoir reçue, vous aurés vu que je n'étois pas moins inquiet, après la réception de votre dernière ou vous me faisiés craindre des grands malheurs ; il y a aparence qu'ils se sont éclipsé puisque vous ne m'en parlés pas et que vous êtes caréssée d'une tendre mère, et de toutte une famille ; il me ser oit assés difficile de vous exprimer la part que je prend à cette heureuse révolution, il n'y a que votre coeur qui doit connoitre le mien, capable d'en juger, au reste je n'ai jamais été malade, et je n'ai d'autres désirs pour le présent, que celui de vous voir.
J'espère, ma chère amie, que vous n'atribuerés pas mon silence à un manque de tendresse de ma part, mais à vous même, qui m'avés tenu jusqu'à présent dans l'attente de recevoir des nouvelles de votre départ de Londres ; je l'esperre d'autant plus que vous avés l'âme trop belle pour vouloir me déchirer le coeur par un doute si cruel ; soiés assurée que je suis entièrement à vous, et croiés moi pour la vie
Madame,
Votre très humble et très obéissant serviteur et très affectionné
Lascaris Vintimille
Meziere ce 22 Aoust 1764
Madame
Au moment que je prenois la plume pour vous écrire, fort empréssé d'aprendre votre départ de Londre, je reçois votre chère lettre, qui mettroit le comble à ma satisfaction si je ne m'étois proposé un plaisir plus grand, qui étoit celui de vous voir dans les environ de Meziere ; je suis trés-faché de l'accident qui vous a empêché de vous détourner, soit pour l'incomodité qu'il peut vous avoir causée, que pour le plaisir dont il m'a privé ; je suis cependant beaucoup plus content depuis que je me sens plus prés de vous, et à vous dire vray, malgré tout ce que vous m'aviés écrit, les caresses d'une mère et de toutte une famille me faisoient craindre de vous perdre à jamais.
Pour ce qui regarde le voyage que vous me proposé de faire à Paris, je vous dirai qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un congé et il y auroit long-tems que je l'aurois fait si des raisons plus fortes ne m'avoient retenu ; premièrement, vous connoissés ma situation présente, et vous savés que je ne puis faire un pas sans me dérenger (1), d'ailleurs faites attention que je porte un uniforme et qu'il est nécessaire d'être mis plus décemment quand on va dans une autre vile que dans sa garnison même, parce qu'on y fait plus d'attention ; pour le congé il n'y a rien de si aisé, et il n'est pas même nécessaire d'écrire à la cour, suffit que j'obtienne une permission de mes chefs, et il n'est pas difficile de l'obtenir pour un mois. Si j'avois quelque ressource au régiment, ou si de parents cruels ne m'avoient pas abandonné, je demanderais une permission pour un mois au colonel, et je pourrois dire que c'est pour l'aler passer avec un de mes amis à la campagne, et je l'obtiendrois sûrement, puisque l'hyver passé j'ai été cinqu mois dehors, toujours par permission des chefs et sans aucun congé ; mais malheureusement tout manque à mes projets, et il est décidé que je ne dois jouir d'aucune satisfaction au monde, je n'ai que celle d'avoir une amie aussi tendre que vous, qui partage mes malheurs, mais aussi, j'ai le regret de vivre loin de vous ; du moins ne me refusés pas le plaisir de recevoir souvent de vos chères nouvelles, de mon côté je vous écrirai tous les jours si vous le souhaités, soyés assurée ma trés-chére amie, d'une éternele reconnaissance et du respect avec lequel je serai toutte ma vie
Madame,
Vôtres trés-humble et trés-obéissant serviteur et fils trés-affectionné
Lascaris Vintimille
___________________
(1) : Sans me déranger financièrement : le jeune officier est dans la gêne.
*
(Sans date) septembre 1764
Madame
Vous ne vous plairdrés plus de mon silence, ma chère amie, je vous écrirai d'hors en avant tous les quinze jours, mais aussi je souhaiterois recevoir un peu plus souvent de vos chères nouvelles. Vous savés que je n'ai d'autre satisfaction que celle d'être lié avec vous de l'amitié la plus tendre, il n'y a rien par conséquent qui puisse me faire plus de plaisir que d'en avoir des assurences.
Il avoit couru un bruit dans la vile que le régiment partoit pour aler fort loin, et on avoit si bien débité cette nouvelle que tous les officiers se préparoient au départ ; je ne puis vous exprimer le chagrin que cette nouvelle m'a donné pendant deux jours qu'on la croïoit vray, je suis persuadé que ceux qui m'ont observé ont fait des jugements téméraires sur mon compte ; on n'en parle plus à présent, et j'en suis bien aise.
Il y a quelque tems que je n'ai point reçu des nouvelles de ma chère mère, je lui ai écrit il y a environ dix jours, et je n'ai pas oublié les circonstances que vous me inarqués dans votre lettre ; on dit içi que si le régiment est encore dans ces canton au praintems prochain, il sera choisi pour le camp de Compiégne, ce que je ne souhaite pas pour le tems eu égard à ma situation présente.
Ecrivés moi ma chère amie, et parlés moi de vos affaires si vous le pouvés. Je trouve une douceur infinie à y prendre part de quelque façon qu'elles puissent aler, aimés moi toujours et soyés assurée d'un retour infini de ma plus vive reconnaissance, et du respect avec lequel je serai toutte ma vie
Madame
Votre trés-humble et très obi. serviteur et fils trés-affec.
Lascaris Vintimille
*
A Meziere ce 13 7bre 1764
Madame
Pour le coup je n'attend pas la quinzaine pour vous écrire et si je me trouvois dans une situation tant soit peu plus commode, vous me vérriés arriver à Paris à l'imprévu pour répondre personnelement à votre lettre, et vous prouver le contraire de ce que vous paroissés penser sur mon compte ; mais malheureusement je n'ai que ma bonne volonté et ma bonne conscience pour faire face à des reproches qui m'offenseroint mortelement, si je pouvois penser que vous etes capable de les croire avec autant d'assurence que vous les écrivés ; je vous ai parlé du voyage de Compiegne comme d'une chose fort éloignée, et incertaine, et quand je vous dis que j'en serois fâché à cause de ma situation présente, c'est qu'on est obligé de faire de plus grandes dépenses que dans sa garnison, puisqu'il faut se pourvoir de tout ce qui est nécessaire, comme si l'on entroit en campagne ; celà n'empêche pas que je ne voulu y paroitre dans un état plus convenable si je le pouvois, c'est un sentiment assés naturel, et qu'on ne doit pas même apeler exibition, dés qu'on ne désire que ce qui est naturelement accordé à vos pareils. Ainsi, ma chère amie, il faut que je me sois bien mal expliqué, pour que vous aïés donné une pareille tournure à ma lettre, soïés assurée que si l'embition étouffe les sentiments du coeur, je n'en ai jamais eu et n'en aurai de ma vie.
Nous avons passé il y a environ huit jours la revue de l'inspecteur, il est par conséquent encore plus aisé d'obtenir une permission, ainsi ma chère amie je la demanderai quand vous le jugerés à propos.
Dans ce même moment que j'achevois de répondre à votre lettre du 8 7bre, je reçois votre dernière ; comment pouviés-vous, ma chère amie, me croire réelement changé à votre égard, il ne manquerait plus à mes malheurs que celui de perdre votre estime et votre amitié ; c'est peut-être l'unique revers qui pourroit faire trouver en défaut toutte ma philosophie, ainsi si vous m'aimés, si la tranquilité de mon âme vous est chère, cessés de la troubler par des soupçon qui offensent l'amitié la plus tendre et la plus sincère, qui durera autant que ma vie.
Pour ce qui regarde le congé en forme, non seulement il n'est pas nécessaire, mais il embarrasseroit même notre projet, puisque je serois forcé de rester sept mois absent du régiment. D'ailleur on n'obtient des congé extraordinaire qu'en perdant ses apointements, et on les obtient quelquefois six mois après les avoir demandés, et les congé de semestre qu'on donne tous les ans en nombre fixe ont déjà été distribué par l'inspecteur, ainsi il est impossible d'en avoir, mais soïés tranquile sur ce qui pourroit m'arriver, je ne puis jamais rien risquer quand j'ai une permission du commandant du régiment et de celui de la place. Je demanderai d'aler à Sedan passer un mois avec un de mes amis et qu'il se pourroit que je fus passer ce tems dans une terre qui est dans les environs de cette vile, je chargerai un ami de confience que j'ai heureusement, de m'envoyer touttes mes lettres à Paris, et si je suis obligé d'écrire au régiment je daterai mes lettres comme si elle venoient de Sedant et je les fairai remettre à qui je voudrois par mon ami. Par ce moyen il est impossible qu 'on puisse découvrir où je suis, et quand même on le découvrirait il ne peut jamais rien m'arriver de disgracieux ; tout ce qui manque ma chère amie, c'est la somme de deux ou trois louis pour faire ma route ; je pourrois les demander au major du régiment, mais outre qu'il pourroit me les refuser parce que je dois encore quelque minutie, il croiroit que je veux m'absenter du régiment pour m'aler amuser quelqu'autre part et je n'aurois pour lors ni la permission ni l'argent, ainsi le plus court, puisqu'il est décidé que je dois tout vous devoir, est de m'envoyer une lettre de change pour Sedan, pour qu'içi elle ne tombe entre les mains de quelqu'un de ma connoissence. Pour lors je partirai d'içi à cheval et je vous écrirai de Sedan le jour de mon arrivée à Paris.
Voilà ma chère amie quel est mon projet, c'est à vous à juger du sentiment qui le dicte, si vous m'aimés il doit vous être cher ; pour ce qui regarde la lettre de ma chère mère il est fort aisé de la suposer, et avant mon départ je lui écrirai ce que vous me marqués dans votre lettre, en sorte qu'elle aprendra mon départ en même tems que ce qu'elle doit faire. Répondés à ma lettre ma chère amie, et aimés moi autant que je vous aime, et je me croirai parfaitement heureux.
Je suis très sensible aux bontés de la dame votre amie mais il me paroit que c'est aimer un peu au hazard que de vouloir aimer un quelqu'un qu'elle ne peut connoitre que très-peu et même du tout, je souhaite que sa volonté soit constente et je fairai de mon mieux pour mériter l'amitié d'une personne qui a la votre, je vous prie de lui faire mes compliments, mais n'oubliés pas de lui dire qu'il ne faut jamais aimer théoriquement.
Pour vous ma chère amie soïés assurée de l'amitié la plus constente et la plus sincère avec laquele je serai toutte ma vie
Votre très humble et très obéissant serviteur et fils très affectionné
Lascaris Vintimille
Votre voyage d'Espagne me donne de l'inquiétude. Je n'ai pas de tems à perdre pour le courier.
*
Meziere ce 1er 8bre 1764
Madame
Je comptois ma chère amie que vous auriés répondu à ma dernière lettre. J'ai été par conséquent à Sedan à peu-prés dans le tems que votre réponse pouvoit être arrivée ; n'y ayant rien trouvé j'ai cru de m'être mal expliqué, ce qui m'a décidé à vous récrire pour vous prévenir que tous les semestriers sont partis (1) et que je n'atrend plus que votre réponse pour me mettre en route. Je vous avois mandé qu'il vaudroit mieux d'envoyer votre lettre à Sedan, mais réflexion faite, vous pourés également l'adresser à la poste restante à Meziere, puisque je partirai par le carosse de Charleville qui est à deux cent pas d'içi ; en cas cependant que votre lettre soit déjà partie pour Sedan, j'ai laissé quelqu'un qui m'en donnera avis ; ainsi si vous répondés exactement à celle-ci je partirai le 9 du courent et j'arriverai le 14 à Paris par la porte Saint Martin ; cette voiture arrive à quatr'heures après midi à la Barrière et s'arrête dans la même rüe Saint Martin.
J'ai déjà pris touttes les précaution necessaire et vous ne devés craindre aucun évènement fâcheux ; j'ai fait une réflexion à l'égard du nom que vous me dites de prendre, et j'ai imaginé de prendre plutôt celui du Chevalier Vagar qui est un officier du régiment qui est parti par congé de semestre pour Avignon, en sorte que quand même le ministre sauroit que je suis à Paris, ce qui n'est pas croyable, je pourrois y rester sous ce nom, d'autant plus que cet officier n'a jamais été à Paris, et n'a aucune liaison dans ce païs là.
Ainsi, ma chère amie, vous vous doutés bien que j'attend votre réponse avec la dernière impatience, si vous m'aimés vous ne me fairés pas languir; en mon particulier soïés assurée d'une amitié qui durera autant que ma vie, et du respect avec lequel j'ai l'honneur d'être,
Madame
Votre très hum. et très oB. serviteur et fils très ajf.
Lascaris
______________
(1) : Officiers en congé de semestre.
*
Madame Lascaris de Vintimille à Madame de Saurin
Madame et trés-chére amie,
La bonté avec la quelle vous ne cessez de vous intéresser à ce qui me regarde, m'inspire la liberté de vous avertir que mon fils devant au plutôt se rendre à Paris, et prévoiant que ce voiage pourra lui causer quelques fraix, j'ai pensée de lui envoier douze louis par la voie de Mr de Fremenville. Vous m'obligerez infiniment Madame, si vous voulez bien vous donner la peine de retirer cet argent et vous en servir pour ce qui pourroit lui être nécessaire pendant son séjour. J'ose me flatter que vous voudrez bien le recevoir et faire pour lui ce que je pourrois faire si j'étois dans cette ville ; dans cette espérance je vous donne toute mon autorité et je suis assurée qu'il sera charmé d'être sous une mère si aimable et si obligeante, et qu'il ne négligera rien pour se rendre digne des bontés que vous aurez pour lui. J'embrasse bien volontiers cette occasion, puisqu 'elle me procure l'honneur de vous réitérer les assurances du tendre attachement avec le quel j'ai celui de me dire
Madame
Votre trés-humble et trés-obligée servante et amie trés-affectionnée
La Comtesse Lascaris de La Brigue
Nice ce 10 8bre 1764
Madame,
Le renouvellement d'année me rappelle le devoir de vous écrire ces deux lignes pour vous souhaiter dans le cours d'icelle et de plusieurs autres toutes les prospérités et bénédictions célestes qui sont dues à votre mérite et peuvent mettre le comble à vos désirs. J'ai l'honneur de vous assurer, Ma Chère Dame, que si mes voeux sont exaucés vous jouirez d'une santé parfaite et d'une vie longue et heureuse. Je suis au désespoir que l'éloignement soit cause que je ne puis faire pour vous que des souhaits quoique très ardens et sincères, et qui m'empêche de vous marquer par mes soins et mes services le zéle que j'ai pour votre conservation. Soiez persuadée ma chère Dame que mon inclination est autant forte que ma reconnaissance, et que s'il ne dépendoit que de moi je voudrois me dévouer entièrement à votre service jusqu 'à la fin de mes jours, trop heureuse si je pouvois avoir encore une fois le bonheur de vous embrasser et de vous témoigner à vive voix la tendre affection et toute la reconnaissance avec la quelle j'ai l'honneur de me dire, Ma Chère et Aimable Dame, Votre trés-humble et trés-obligée servante
La Comtesse Lascaris de La Brigue
Nice ce 27 Décembre 1764.
*
Retour à Paris
Et voilà, plus de lettres du comte de Lascaris... On le retrouvera, marié, vingt-quatre ans plus tard, en 1788, à une jeunesse de 18, Mademoiselle de Reyhac, il a 48 ans... Il démissionnera du régiment Royal-Italien en pleine Révolution, mais il en était entre-temps devenu colonel, ce qui n'est pas mal pour un cadet sans fortune qui a commencé au bas de l'échelle. Pourquoi l'inconstante Emilie ne l'a-t-elle pas épousé ? Ce jeune homme paraissait pourtant bien honnête. Mais elle a le génie de gâcher sa vie pour courir après des chimères.
En 1765, la voici de nouveau à Paris. Le voyage à Londres n'a pas eu l'air bien probant. Elle habite rue de la Sourdière, près de M. de Saint-Germain, un banquier qui restera son ami toute sa vie. Elle y reçoit des déclarations de Gentil-Bernard : "Je voudrais vous plaire, celà est bien sûr, parce que je voudrais mériter la continuation des sentimens dont vous m'honorez, en me défendant toujours pour mon repos de la séduction qui les accompagne."
Il lui parle de "l'affection tendre et sincère" qu'il lui proteste de tout son coeur. Gageons qu'il n'a pas dû écrire à d'autres beaucoup de lettres aussi sentimentales.
***
De Compiégne
A Madame
Madame de Saurin Rüe des St Pères à côté de la Charité vis à vis le Cimetière
(Renvoyée : "Chez Mr de Boullongnes Rue de la Sourdière au coint du cul sacq." Une troisième main, celle de quelque suisse ou concierge, a rajouté : "Mr de Boulogne ne demeure point Rue de la Sourdière. ») (1).
A Compiégne le 26
J'ay reçeu en partant de Soissons la lettre que je dois aux attentions de ma chère Emilie, je n'ay pu luy répondre qu'à mon retour icy. Je ne say encor si elle luy parviendra, elle me mande La Rue de sa nouvelle demeure, mais je n'ose luy adresser là ma réponse ignorant où elle loge précisément, ainsi cette lettre ira la chercher encor Rüe des St Pères. Je reste dans l'inquiétude de ce logement et des suites qu'aura le déportement de cette folle hôtesse. J'ay d'autant plus de regret dêtre absent de Paris, sil est vray que j'eusse pu vous être de quelque utilité. L'aveu que vous me faites de la situation de votre âme me fait plaisir et peine, cest à vous de m'entendre, votre âme a autant dintelligence que de sentiment, il vous faut aussi du courage et de la prudence, vous ne possédés pas moins ces qualités ; ainsi je juge que vous aurés pris un parti et que vous aurés bien fait. La faute en est au ciel qui fait tous vos malheurs. Si je puis les adouçir par le dévouemment que je vous ay voué, cette certitude fera mon principal bonheur. Je passe icy mon temps dans le mouvement le plus vif. Ces dissipations forcées ne me vont pas plus qu'à vous, et j'aspire au repos qui m'attend à Paris dans huit jours ; je n'y arriveray qu'au milieu de la semaine prochaine mon premier soin sera de minstruire du sort et de la demeure de ma chère Emilie que j'assure de l'amitié la plus tendre et la plus durable.
______________
(1): Jean de Boullongne, Contrôleur des Finances depuis le 25 août 1757. Fils de Louis de Boullongne "le jeune" (1654-1733), premier peintre du Roi. Il habitait en 1765 rue Saint-Honoré, "vis-à-vis des Jacobins". Guillotiné sous la Terreur dans la tournée des 28 Fermiers Généraux, dont Lavoisier, la République "n'ayantpas besoin de savants", selon le mot immortel de Coffinhal.
*
La bête du Gévaudan
Paris le 3 Octobre 1765.
Je commençais, Madame, à être inquiet de votre santé et du succès de votre voyage ; votre lettre du 29 me rassure. Je suis fort aise de vous savoir arrivée en bon et beau lieu. Je ne perds pas un moment à vous envoyer les lettres qui m'ont été remises. S'il m'en vient d'autres, je vous les ferais passer avec la même exactitude. Je retourne à Choisy, où le Roi passe deux jours, pour aller à Fontainebleau. M. le Dauphin l'accompagne avec bien de la peine et malgré l'avis des médecins qui sont encore fort alarmés sur sa santé, mais ce prince veut absolument sortir de Versailles ; et l'on craint encore plus son inquiétude que son mal. Je reviens dimanche à Paris et je m'acquiterrais de vos ordres auprès de votre hôtesse, je la verrais même si je puis, malgré la crainte que vous m'avez inspirée pour elle. A propos de bête féroce, vous savez que celle du Gévaudan a été tuée par M. Antoine (1) et un garde de M. le Prince de Condé ; l'animal empaillé doit arriver aujourd'hui à Versailles. C'est un loup, et ce n'est que ce là. Je vous fais mes compliments, je sais l'aversion que vous aviez pour elle, elle ne mangera pas vos toutous, dont je baise la patte.
Je ne sais pas quand j'irais à Fontainebleau. J'irais avant passer huit ou dix jours à Dampierre (2). Occupez vous du plaisir de la campagne, et renvoyez le soin des affaires à un autre temps. Il reviendra assez vite. Je n'ai point de nouvelles à vous mander : les disputes des prêtres et des magistrats sont suspendues jusqu'à la Saint Martin, et vous ne vous en embarrassez pas plus que moi. Je suis préssé de vous quitter, et j'y ai du regret ; je n'ai que le temps de vous assurer de l'inviolable attachement que je vous ai voué, et de l'empressement que j'aurais toujours d'exécuter vos ordres.
___________
(1) : Il s'agit du porte-arquebuse de Louis XV: François Antoine de Beauteme, lieutenant des chasses royales, qui tua, avec l'élite des gardes-chasses, le 21 septembre 1765, un énorme loup qui passa pour la Bête du Gévaudan : ce fut la version officielle de la fin du monstre, qui continua pourtant ses ravages.
(2) : Dampierre: résidence du duc et de la duchesse de Luynes, née Elisabeth de Montmorency-Laval.
*
Le 6 (Octobre 1765?)
On me dit ma belle amie qu'une de ces deux lettres est préssée et je me hâte de vous l'adresser par la poste. Je les accompagnerai des voeux que je fais pour votre santé et pour votre bonheur.
J'arrive de Choisy, j'irai demain porter à votre hôtesse le dépost dont vous m'avez chargé et l'assurance de votre demeure.
M. le Dauphin est parti hier avec le Roi pour se rendre à Fontainebleau. Il n'est pas bien, il a cependant soutenu le voyage. Il est arrivé un accident à Essone : quarante chevaux du Roi ont été brûlés dans une écurie où le feu a pris pendant le grand orage qu'il a fait. Vous aimez les dadas et vous serez fâchée de cette nouvelle. Que Dieu maintienne les toutous en joie et santé, ainsi que leur maîtresse que j'honore et que j'embrasse avec l'affection et l'attachement qu'elle me connaît pour elle.
Faites tous mes compliments à votre hôte s'il veut bien les recevoir. Serviteur à Melle Antonia, bien des choses à M. de Nerel.
*
A Paris le 8
Je vous ay fait passer il y a trois jours, ma belle amie, les lettres que j'avois pour vous. Depuis jay reçeu celle cy que je vous envoyé parce que vous pourriés etre inquiette de votre affaire du clergé ; je suis bien aise de voir qu'on s'en occuppe et jespère quelle se terminera heureusement. Jay été voir hier Mr de Benne dans votre logement, il vous priera de le faire avertir quelques jours avant votre arrivée pour que tout soit en ordre. Jay voulu voir votre hôtesse qui m'a fait renvoyer à son mary. Je lay trouvé chés Mr de Boulogne, il est fort honnête. Il recevra aujourdhuy votre loyer dont il n'est point préssé. Jétais fort préssé moy dé faire accomoder vos portes et fenêtres. Je pars aujourdhuy pour Dampierre où je compte passer huit jours. On m'enverra mes lettres comme si jétois à paris et jexécuteray vos ordres. Rien de nouveau d'ailleurs. M. le Dauphin a été fort fatigué de son voyage et on parle toujours mal de sa santé, on dit que le voyage de Fontainebleau sera abrégé. Je pourrois bien ne pas y aller du tout. Bonjour à belle dame, les poules de Caux vont encor l'engraisser et la rendre plus belle. Je say bien pour moy quelle ne peut pas devenir plus aimable. Je lassure aussi de mon tendre et respectueux attachement.
A Dampierre le samedi 12 Octobre (1765)
Je viens de recevoir icy les quatre lettres cy jointes, qu'on a porté chés moy à Paris ; je cherche le moyen de vous les faire passer par la voye la plus prompte. Je suis bien fâché s'il y a quelque retard que mon absence occasionne ; lundy je retourne à Paris où je seray quelques jours. Je feray une course légère à Fontainebleau. Donnés moy toujours de vos nouvelles à mon adresse ordinaire ; vous savés linterest que j'y prends. Si vous m'instruisés de votre retour, je le feray dire chés vous pour que lon prépare votre appartement et qu'on le rende clos et couvert sil est possible. Je compte que vous passerés tout le mois à la Pailleterie, à moins que des affaires préssées ne vous rappellent ; vous avés pris vos mesures pour que vos correspondants vous marquent les démarches que vous devés faire. Je fais toujours les mêmes voeux pour votre santé et pour votre bonheur ; je mène icy une vie douce et tranquille. La chasse, la table et le sommeil en forment les occupations ordinaires. J'y serois plus longtemps, si mes travaux de Choisy et l'économie quils exigent ne m'y rappeloient. Je n'y jouiray pas encor cette année de la béatitude et du repos que je m'y prépare ; c'est à quoy se bornent tous mes voeux. Je voudrois voir Emilie aussi voisine de sa retraitte, ou du moins luy voir parcourir une carrière plus heureuse que celle où le Destin l'a promenée jusqu'à ce jour. L'Éspagne n'est pas plus digne de la posséder que l'Angleterre. Je souhaite donc que l'amitié ou l'amour, s'il le faut, la fixent dans le pays où l'on connoit mieux qu'ailleurs le prix des femmes aimables ; si j'avois vingt ans de mois, vingt mille livres de rente de plus, je say bien par quelles chaînes je l’attacherois, ou plustot je m'enchainerois moy même. Je ne puis mériter quelque part dans sa confience que par les soins et les sentimens d'une amitié vive autant qu'elle est infructueuse ; j'en seray trop payé si elle me continue les marques de bonté dont elle m'honore et si elle me donne lieu de luy marquer mon zéle et mon éternel attachement.
*
A Paris le 17 Octobre (1765)
J'ay reçu en même temps les deux lettres dont Emilie a bien voulu m'honorer du 8 et du 9 de ce mois, et j'ay réglé mes démarches relativement à elle suivant les ordres qu'elle m'a donnés. Le payement du loyer a été fait et la quittance retirée : l'hôte a paru fort honnête et l'hôtesse toujours impraticable ; cependant le terme est passé et l'on n'a fait aucune déditte, ainsi la rue de la Sourdière (1) et les moines vous posséderont cet hiver. J'ay vu encor Mr de Benne qui préparera d'avance tout ce qui sera nécessaire à la sûreté, propreté et salubrité de votre appartement. Vous ne l'habitterés pas de ce mois cy et vous faites bien d'aller voir le Havre. Ne vous exposez point aux tempêtes qui pourraient bien par malice vous emporter en Angleterre. Ce pays qui n'a pas su vous garder à cinq ans n'est pas digne de vous à trente : vous nous appartenés à touttes sortes de titres. Je suis fâché de voir retarder le lien dont on veut encor vous attacher à nous en vous rendant pensionnaire de notre Religion, sans doute que M. de St. J. n'en a pas été le maître. Il faut encor que la guerre des prêtres influe sur votre bonheur ; que ne vivent ils en paix pour y laisser les autres. Vous me demandés de vous instruire du retour de Fontainebleau : la nouvelle du moment est que Mr le Dauphin reviendra le 28 de ce mois à Versailles ; et le Roy avec sa Cour le 5 du mois suivant, d'autres disent le 8, il peut y avoir du changement à tout celà et je vous en instruirai.
La santé de M. le Dauphin devient meilleure sensiblement, le lait d'ânesse qu'il prend passe bien, il dort mieux et il a plus deforce, ce qui fait concevoir des espérances qu'on n'avoit pas à son départ (2). On a donné l'ancien opéra de Thétis avec une musique nouvelle de M. de La Borde, elle a assez bien réussi. Le même succès n'a pas accompagné un opéra comique de Trial (3) et Le Vachon, intitulé Renaud d'Ast tiré des Contes de La Fontaine. On donne d'autres nouveautés cette semaine ; je ne suis pas encore tenté de les aller voir. Choisy m'occupe, et je rôde obscurément dans les maisons circonvoisines. J'ay été presque témoin d'une scène de jalousie qui intéresse une jeune femme de ma connoissance ; en remontant chés elle le soir elle a trouvé sur la cheminée deux pistolets croisés sur un grand papier rempli d'écriture. Elle y a vu tout ce qu'elle a fait depuis trois ans de mariage. Son mari s'est présenté ensuite et l'a menacée de la mort si elle ne luy remettoit sur l'heure les lettres et les portraits du prince... et du ch.r Vous jugés qu'il a fallu obéir et elle est partie le lendemain pour ses terres avec son époux. Deux femmes de chambre, jalouses l'une de l'autre, dont l'une couchoit avec le maître d'hôtel, ont été cause de ce malheur. Huit jours auparavant c'étoient le mary et la femme la plus heureuse.
Une avanture plus gaye est ce qui vient d'arriver à Me. de Jérinte nommée à l'abbaye de Montbuisson où elle remplaçait une sainte, elle y est arrivée en guimpe et en pet-en-l'air, suivie d'un cordelier, d'un chanoine et d'un jeune médecin, accompagnée de chiens, de singes et de perroquets ; elle a fait ouvrir touttes les grilles et portes de son appartement, a tenu table ouverte et a tellement scandalisé les saintes ouailles qu'elles étoient sur le point de déserter. L'abesse voyant celà est partie un beau matin avec son équipage (4).
Mr de Kerguesec président du parlement de Bretagne vient d'être exilé. Les affaires de cette province s'embrouillent de plus en plus. On dit qu'on a trouvé à remplacer onze des 22 magistrats de Pau, dont on avoit accepté la démission. Je ne suis pas profond dans ces matières, ainsi n'en craignés ni le détail ni l'ennuy. Je vous diray encor un mot de la bête. On la fait voir pour douze sols dans la rue St Honoré, elle est tombée ainsi que les pièces trop annoncées et il y va fort peu de monde. La comédie nouvelle du Tuteur Trompé, aux François ne réussit pas mieux ; l'opéra d'Hipermnestre n'a pas plus de fortune ; ainsi vous voyés que les plaisirs de la ville sont médiocres et ne valent pas que je vous en entretienne. Ce qui m'a plus amusé que celà, c'est la peinture que vous me faites de vos divers correspondants. Je suis payé pour me plaire au récit que vous m'en faites ; et je vous trouve aussi honnête que vous avés la complaisance de me trouver aimable. Je voudrais vous plaire, cœur est bien sûr, parce que je voudrais mériter la continuation des sentimens dont vous m’honorés, en me déffendant toujours pour mon repos de la séduction qui les accompagne.
Adieu Madame, si je puis vous être encor de quelque utilité avant votre retour donnés moy vos ordres. Voilà la seule lettre qui me soit remise pour vous, la mienne en vaut quatre pour l’étendue. Elle en vaut mille pour l’affection tendre et sincère que je vous y proteste de tout mon cœur.
Je vous prie de remercier M. de la Pailleterie de l'honneur de son souvenir, et de l'assurer de mes devoirs très humbles.
_______________
(1) : Rue de la Sourdière : appartement de M. de Saint-Germain.
(2) : Le Dauphin mourra pourtant deux mois après, le 20 décembre.
(3) : Trial: "un chanteur d'ariettes, qui devint l'ami de Robespierre, son compagnon de tous les jours, son garde du corps" (Monselet: Le Petit Paris, 1879).
(4) : C'est la soeur de Louis-Sextius de Jarente de La Bruyère (Marseille 1706, évêque de Digne en 1747, d'Orléans en 1758). Une demoiselle de Jarente, devenue marquise de La Croix et femme d'un général espagnol, fut à Madrid en 1764 la maîtresse de Beaumarchais et du roi Charles III d'Espagne. On retrouve la marquise de La Croix "âgée, grande et majestueuse, veuve d'un Grand seigneur espagnol": elle fait partie de la famille du romancier Cazotte, à Pierry en Champagne, quelques années avant la Révolution. Après la galanterie, elle a tourné au mysticisme, comme Emilie Portocarrero tournera, vers la fin de sa vie, à la dame charitable. "L'Illuminisme l'unissait à Cazotte de ces liens tout intellectuels que la doctrine regardait comme une sorte d'anticipation de la vie future", écrit de la marquise de La Croix Gérard de Nerval dans sa préface aux Oeuvres de Cazotte.
*
Vendredy matin
Je vais partir pour la campagne, belle Emilie, malgré le mauvais temps qu'il fait. Je reviendray demain, si vous étiés libre le soir et que vous voulussiés manger un poulet chés votre ami il seroit fort aise de causer quelques heures avec vous sur vos affaires. Vous savés quel interest il y prend. Faites moy savoir demain matin vos volontés, j'irois vous prendre sur le soir et vous ramenerois chés vous après souper.
Vous avés oublié votre porte carte à Londres, je l'ay envoyé chercher et le voilà. paris vote cheminée, Mademoiselle paris votre chapelle (1).
______________
(1) : Que signifient ces termes proprement surréalistes? Voila qui eut ravi Breton mais qui reste inexpliqué. Gentil-Bernard serait-il quelquefois Benjamin Péret, par hasard?
PORTRAIT DU PÈRE D'EMILIE
par le Duc de Luynes (24 avril 1743).
"Tous les ambassadeurs et ministres étrangers suivent l'Empereur en Bavière. De ce nombre est M. de Montijo, ambassadeur d'Espagne... On dit que personne n'a plus de capacité, d'esprit et d'habileté dans les affaires, et qu'il est impossible de trouver un ministre qui serve mieux son maître ; il est universellement considéré dans l'Empire. Quoiqu'il ait de la hauteur, elle est accompagnée de tant de politesse et de magnificence, que l'on n'en est pas moins empressé d'aller chez lui. Cette magnificence est au-delà de tout ce qu'on pourroit croire ; il donne des fêtes continuellement à la ville et à la campagne ; ses meubles sont magnifiques ; il a répandu de l'argent avec profusion dans toutes les occasions nécessaires, et en dernier lieu au retour des troupes françoises. M. de Belle Isle n'ayant plus de maison, il a reçu tous les officiers chez lui. Pour donner une idée de cette magnificence par un détail peu important, M. de Belle Isle, au retour de Prague, comptoit aller loger chez M. Blondel, ministre de France ; M. de Montijo lui demanda avec instance qu'il vint loger chez lui ; pour celà il avoit fait bâtir, comme je l'ai déjà marqué, un appartement tout exprès, que l'on a détruit après le départ de M. de Belle Isle. Cet appartement étoit construit avec toute la magnificence et la commodité imaginables et meublé superbement. Le jour de l'arrivée de M. de Belle Isle, il eut grand soin que cet appartement fut bien éclairé ; et pour cet effet il y avoit fait mettre huit cents bougies. Quand toute la compagnie fut retirée, M. de Belle Isle, trouvant toute cette illumination inutile, ordonna qu'on les éteignit. M. de Montijo, étant revenu le soir faire la conversation avec M. de Belle Isle, trouva fort mauvais qu'elles fussent éteintes, et les fit toutes rallumer. Il a fait bâtir une galerie dans sa maison, qui est d'une longueur immense, meublée et ornée parfaitement, car il a beaucoup de goût, éclairée et échauffée également, quand même il n'y est pas; c'est pour la promenade et le lieu d'assemblée des ministres étrangers et de tout ce qui veut venir chez lui. M.de Belle Isle dit qu’il faut que M. de Montijo ait bien dépensé un million pour son établissement à Francfort. Il est persuadé que sa dépense depuis ce temps-là va au moins à 60 000 livres par mois. M. de Montijo est Grand d'Espagne et Président du Conseil des Indes. On dit que son désintéressement égale son habileté. Il jouit de 4 ou 500 000 livres de rente, et l'Espagne ne le laisse pas manquer d'argent ".
***

En Décembre de cette même année 1765, Emilie fait le grand saut au-delà des Pyrénées : elle se rend en Espagne en compagnie de son dévoué domestique La Jeunesse, qui est marié, et dont la famille reste à Paris. Emilie ne connait pas l’espagnol, ni personne en Ibérie, mais qu’importe ! Son seul véritable moteur a toujours été l’ambition, le désir de se faire reconnaître de sa famille paternelle. Gentil-Bernard lui donne une lettre de recommandation du Comte d’Egmont, Grand d’Espagne et mari d’une de ses bonnes amies, qui se trouve être la fille chérie et mélancolique du maréchal de Richelieu. Donc notre Emilie ne s’embarque pas sans biscuit. « Il vous reste à combattre l’interêt et les préjugés » lui dit le poète. L’intérêt, parce que sa famille paternelle ne voudra sûrement rien verser à cette bâtarde, et les préjugés pour cette naissance un peu trop naturelle.
D’abord une remarque : il existe alors en France, dans les sphères gouvernementales, un courant de sympathie très fort pour les Espagnols. Courant que la guerre de 1808, l’Impératrice Eugénie (qui causa le désastre de 1870) et le Caudillo n’ont pas contribué, aux XIX et XXe siècles, à rétablir. Au XVIIIe siècle, au contraire, tout est fait par les rois français et espagnols pour rapprocher les deux nations. Le 15 août 1761 a été signé le Pacte de Famille entre la France, l’Espagne et l’Autriche. Depuis le début du siècle où le duc d’Anjou, petit-fils de Louis XIV, est devenu Philippe V, ce sont des Bourbons, cousins des rois de France, qui règnent en Espagne. L’idiote anglomanie n’avait pas encore envahi nos mœurs, et les Espagnols ne paraissaient pas des Européens de second rang. Tout au contraire nous sommes à l’époque en guerre avec l’Angleterre, et les Espagnols sont nos alliés. L’Europe du XVIIIe siècle est un continent aimable, gouverné par des princes modérés pour le plus grand bonheur de leurs peuples. Ce ne sont ni Louis XV, ni Charles III, ni Marie-Thérèse ni même les trois George d’Angleterre qui se rendront coupables des boucheries de la Révolution, puis de l’Empire : ils sont bien trop civilisés pour ça. Même Frédéric II qui passe à son époque pour un voyou (et qui en est un), s’occupe à peupler Berlin, fait venir des immigrants, rend libre l’exercice de la religion. On ne peut en aucune façon comparer cette époque aimable avec l’atroce XXe siècle, où des tyrans sortis du peuple massacrent des ethnies entières. Hitler, Staline, Mussolini, Mao Tsétoung, Tito, Ceaucescu, exterminateurs athées de la malheureuse humanité, sont inconcevables au XVIIIe siècle. Qu’on en juge : une bataille comme Fontenoy, qui passe pour épouvantable en 1745, fait 8 853 morts sur 100 000 belligérants : le prix d’un accrochage de second ordre de la 2e Guerre Mondiale. Rien de comparable avec les horreurs de Verdun, Stalingrad ou Hiroshima : les rois de droit divin se considèrent comme les pères de leurs sujets ; ils ont envers eux des devoirs religieux ; il y va de leur conscience. Louis XV aime ses sujets – enfin ses sujettes -. Quand elles sont enceintes de son fait, il les dote et les marie proprement. Quelle horreur ! Cette douzaine d’enfants naturels, faits avec des maîtresses consentantes, a donné à Louis XV une réputation de dégoûtant dont sa mémoire ne s’est jamais relevée. C’est aussi un paresseux, un ennuyé, il a raté presque toutes ses guerres (qu’il a d’ailleurs faites à contrecoeur). Il a laissé gouverner ses maîtresses, toutes occupées d’intrigues, de chiffons. Le peuple, rouge de honte, devant une pareille ignominie, gronde sourdement, et on le comprend.
Enfin voici la Révolution ! Le règne de la Liberté et de la Vertu ! Vite les vertueux Girondins déclarent à l'Europe une guerre à mort qui durera 23 ans (1792-1815) et laissera la France envahie, amoindrie. Le vertueux Robespierre et le vertueux Marat font guillotiner des charretées de cinquante à cent personnes par jour ! En Vendée, les vertueux héros de Mayence et les hussards de Westermann jettent dans des fours des enfants et des femmes pour leur apprendre à être républicains, et les cuisent à petit feu. Le vertueux Carrier noie dans la Loire des hommes et des femmes ligotés nus deux par deux : ce sont les mariages républicains. Le peuple français est carrément heureux. Enfin c'est le règne de la Vertu. Les charniers empestent l'Europe : trois millions de morts au bas mot. Les vertueux démocrates brillent de tout leur éclat au zénith de l'Histoire, et on donne leur nom à des avenues.
La Fontaine, cent ans auparavant, l'avait bien vu. Tant qu'à être le roi que demandent les grenouilles, il vaut mieux être la grue
Qui les croque, qui les tue,
Qui les gobe à son plaisir,
plutôt que le soliveau sur lequel elles grimpent sans crainte.
*
L'auberge espagnole
Nous n'avons pas, hélas ! les lettres d'Emilie à Gentil-Bernard. Si cela se trouve, les bigotes de soeurs de ce dernier, en 1775, après sa mort, ont tout jeté au feu. C'est dommage, car un voyage en Espagne, à l’époque, c'est vraiment la découverte de la face inconnue de la lune. De Beaumarchais à Marbot, les Français n'en reviennent pas de tomber dans un pays aussi arriéré. Habituée à son boudoir de la rue des Saints-Pères, Emilie a du être fort étonnée en débarquant tra los montes. Un officier de 1808 dans ses souvenirs, nous donne un aperçu du climat de tourisme sauvage qui régnait toujours dans l'Espagne de Charles IV: nul doute que quarante ans auparavant les choses n'aient guère été différentes. Aussi Emilie dut-elle avoir sérieusement recours à son industrieux factotum, M. La Jeunesse, - pour se tirer de tous les mauvais pas des ventas, des galeras, et des botas, sans compter les plats de tortillas et de garbanzos qui en faisaient l'ordinaire. Dame ! On ne devient pas aussi facilement une Andalouse (au sein bruni) même si on a déjà montré des dispositions.
"J'eus l'occasion de faire connaissance avec ce qu'on appelle une venta ou posada, c'est à dire une auberge espagnole... On entre en général dans la venta par une espèce de hangar qui sert d'écurie ; on la traverse au risque d'attraper quelque ruade en passant, et l'on arrive à la cuisine. On donne ce nom à un réduit obscur, de dix à douze pieds carrés, qui ne reçoit le jour que par une large ouverture faite au plafond. Le foyer est au milieu ; la fumée du feu et des viandes qu'on fait frire ou griller n'a pas d'autre issue pour s'échapper que l'ouverture d'en haut : ce qui l'oblige à séjourner assez longtemps dans l'officine, au grand désagrément de la vue et de l'odorat. L'hôte, l'hôtesse et leur famille sont assis sur des bancs de pierre placés le long des murs de la cuisine, n'ayant d'autre occupation que de se chauffer, se peigner mutuellement et fumer le cigarito. On ne trouve jamais rien à manger dans ces auberges ; mais on s'empresse de vous indiquer les maisons où l'on vend du pain, des légumes, de la viande, du gibier, des fruits, du poivre, de l'huile et tous les autres comestibles nécessaires pour le repas. Il faut aller soi-même faire emplette de ces diverses provisions ; et les accommoder aussi soi-même dans la poêle à frire de l'hôtellerie, à moins qu'on ne charge l'hôtelier de cette besogne, ce dont nous nous gardions bien, surtout au commencement de notre arrivée en Espagne, à cause de la saleté dégoûtante de ces personnages.
La première fois qu'il me prit fantaisie d'entrer dans une venta (...) quelques muletiers y déjeunaient et mangeaient dans la poêle à frire le guisado, espèce de ragoût espagnol que je ne saurais mieux comparer qu'à ce que nos soldats et les gens du peuple en France appellent ratatouille. Nous demandâmes aussi à déjeuner ; l'aubergiste répondit qu'il était prêt à nous préparer notre repas, mais qu'il fallait absolument attendre que ces messieurs eussent fini, notre guisado devant être cuit, servi et mangé dans la même poêle que les muletiers tenaient par la queue. Nous préférâmes un morceau de fromage au brouet de l'hôtelier espagnol, nous excusant toutefois auprès de lui de ne pouvoir goûter à sa cuisine, parce que l'exigence du service ne nous permettait pas de nous arrêter assez longtemps pour cela.
Pendant que nous faisions ce modeste repas, une famille entière débarqua devant l'auberge ; elle allait de Valladolid à Burgos... Les femmes étaient dans une galera, espèce de chariot à quatre roues, traîné par deux mules ; les hommes suivaient, montés sur des mules. Trois dames et une femme de chambre sortirent de la galera ; cette voiture était conduite par un paysan, qui, assis sur le devant, dirigeait ses mules sans rênes et seulement avec la voix et un bâton. Les voyageurs prirent dans la galera les provisions nécessaires pour leur déjeuner, du pain, du riz et du lard. Le vin était dans une bota, outre de peau de bouc. Ils préparèrent eux-mêmes leur repas dans la poêle des muletiers, se mirent à table, maîtres et valets ; et tout le monde mangea de bon appétit, chacun puisant à son tour dans la poêle, et buvant à la même bota, mais à la catalane, c'est à dire en prenant la bota d'une main, et en l'élevant de manière à faire tomber le liquide dans leur bouche sans que les lèvres touchent à l'embouchure. L'usage des verres est inconnu dans les campagnes et dans les auberges de ce pays. Il est très curieux de voir une table d'Espagnols boire ainsi, l'un après l'autre, à la régalade. Ils sont tellement adroits à cet exercice, que de la plus grande hauteur où leurs bras puissent atteindre, ils ne laissent pas tomber une goutte sur leur visage ou sur leurs vêtements.
En rôdant autour de la galera, je vis des malles et deux énormes paquets enveloppés de cuir en forme de valises : c'étaient les matelas, draps de lit, couvertures, oreillers de toute la famille ; il faut nécessairement prendre ses précautions dans un pays où tout manque dans les auberges. Celui qui les néglige ou qui ne peut, pour une cause quelconque, se procurer ces objets couche par terre ou sur le banc qui règne autour de la table. Ajoutons, pour terminer ce que nous avons à dire des ventas espagnoles, que l'hospitalité qu'on y reçoit, quoique réduite à sa plus simple expression, est loin d'être gratuite." (J.J.E. Roy : Les Français en Espagne, souvenirs des guerres de la Péninsule (1808-1814) Tours, Marne 1856).
Mort du père d'Emilie
Que s'est-il passé pour qu'Emilie se décide brusquement à 31 ans, à se rendre en Espagne ? Probablement a-t-elle appris par les gazettes la mort de son père. Ce père volage vivait encore peu d'années auparavant. Il était marié. Il n'a laissé qu'un fils légitime. Dans le Calendrier de la Noblesse de 1762, don Christophe est décrit tout au long : Emilie ne pouvait l'ignorer. Il s'appelle en toute simplicité Don Christophe Portocarrero Guzman Luna Enriquez d'Almanza Pacheco Funez Villapandi Arragon et Monroy, Comte de Montijo, Marquis de Barcarota, Grand d'Espagne, Chevalier des Ordres du Roi et de celui de la Toison d'Or, Majordome de la Reine Douairière d'Espagne, Président du Conseil des Indes, etc, etc. Veuf depuis 1747 (douze ans après la naissance d'Emilie) d'une soeur du Comte de Tremal, l'une des Dames du Palais de la feue Reine d'Espagne, il n'en a eu qu'un fils : Don Philippe, appelé marquis de Valde-Ravano, Gentilhomme de la Chambre du Roi avec exercice, marié à Dona Marie-Josèphe de Zuniga, fille du Comte de Miranda, Grand d'Espagne, lui aussi gentilhomme du Roi (avec exercice)...
Ouf ! C'est don Philippe et dona Marie-Josèphe qui ont du en faire, une tête, en voyant tomber de la lune cette soeur née en Angleterre et ne parlant que français. De plus on ne peut nier que le père, don Christophe, ne l'ait eue du temps de son mariage : les dates sont là pour le prouver. Emilie est bel et bien une fille adultérine. Ils ont du tordre le nez.
Une autre qui a du tordre le nez, c'est Elisabeth Farnèse, la reine douairière de qui don Christophe, tout justement, était le majordome. Elisabeth Farnèse est à la fin de sa vie. Elle s'est retirée depuis vingt ans à Aranjuez, à la mort de son mari Philippe V, celui qui se croyait mort et demandait pourquoi on ne l'enterrait pas, vu la puanteur. La reine, qui a vécu dans la plus stricte observance conjugale, y compris pendant la folie du roi, est incapable de comprendre les incartades de ses proches. Découvrir les frasques de son majordome sous les traits d'une jeune femme de trente ans n'a sûrement pas du lui plaire.
En janvier 1766, mademoiselle Antonia, restée seule à Paris dans l'appartement de sa maîtresse et s'y ennuyant, probable, décide de se marier. "Je l'ai bien prêchée sur la sottise qu'elle veut faire et qu'elle fera" écrit Gentil-Bernard, ennemi de toute procréation. Quant à Emilie, elle veut demander une pension de 2700 livres, ce qui n'est pas mal du tout - mais il y a loin, comme on sait, de la coupe aux lèvres, et les Espagnols ne sont pas pressés... De plus, M. Horrutence, son ami rouennais, est mort. "J'aurais voulu qu'il ait fait pour vous quelque chose en mourant mais vous savez comme on meurt." Du coup, notre poète prend feu. Désire-t-il l'épouser ? "Il est malaisé de délier les chaînes des autres, quand on en porte soi-même ; vous m'avez mis sur la voie de ces réflexions, qui me seraient bien venues sans vous." Elle est mariée à M. de Saurin ! (1)"J'en ferais bien d'autres si je voulais, mais vous me diriez que ce sont des châteaux en Espagne" ajoute-t-il. "Ne croyez pas que j'imagine rien qui vous soit contraire, et capable d'affaiblir l'attachement fidèle que je vous ai voué." Il termine par "le serment que je fais de vous aimer toujours bien tendrement. "
_____________
(1) : Ou bien mariée secrètement à l’abbé Béliardi ou Bigliardi ? (voir note (1) page 22).
Les tractations avec la famille Montijo s'annoncent difficiles. "L'intérêt et la justice doivent parler en votre faveur, votre conduite et votre esprit ajouteront à ces moyens." La lettre du comte d'Egmont a fait le meilleur effet. Mais "votre conduite ne peut être trop réservée. On vous observera beaucoup, et le bien qu'on dira de vous là-bas fera un très bon effet içi" : c'est à dire sur les éventuels distributeurs de pensions. Emilie demande d'autres appuis, par lettres.
Il est à nouveau question de Monsieur Horrutence. Ce bienfaiteur rouennais d'Emilie est-il banquier ? "J'espère qu'il aura laissé tout en règle par rapport à vous. Il aurait pu mieux faire et vous laisser une marque secourable de son amitié. "
En février 1766, Gentil-Bernard croit que sa tendre Emilie va revenir incessamment d'Espagne : il est loin du compte ! Antonia se marie : "elle fait demain une folie, c'est-à-dire un serment conjugal. Je souhaite que cet hymen lui attire beaucoup de bénédictions et peu de progéniture." Mauvaise nouvelle : l'argent commence à manquer.
Le comte de Creutz, retour d'Espagne, à quelque dîner chez Mme Geoffrin, rapporte de bonnes nouvelles de notre héroïne : "le parti modéré et honnête que vous prenez (vis-à-vis de votre famille) est sans doute le meilleur. " Hélas ! Un ecclésiastique de haut rang se dresse contre Emilie - se faisant le défenseur de "l'honorabilité" familiale - et surtout, bien évidemment, du fric. "Il est singulier que vous ayez contre vous un homme de Dieu fait pour professer la justice et la charité. " Cela ne nous étonne, nous, nullement. A évêques débauchés en France correspondent prélats pingres en Espagne. Tout ce qu'on sait de celui-là, jusqu'à la prochaine identification, c'est qu'il est archevêque, et la réédition de l'archevêque de Toulon pour le jeune Lascaris.
Ce même mois de mars 1766, qui est l'année la plus fournie épistolairement, Mme Geoffrin part pour son voyage, son triomphe en Pologne : Gentil-Bernard irait bien aussi, mais c'est un égoïste, un sage, un épicurien modéré : il est bien à Choisy ; pourquoi irait-il se geler en Sarmatie ? La proposition de différents princes de le recevoir chez eux le flatte, évidemment, mais comme tout le reste, fort modérément : il restera chez lui. C'est un homme de 56 ans qui ne se trouve plus d'âge à courir les routes. Passe encore pour la belle Emilie, qui n’a que 31 ans... La reine de France, Marie Leszczynska, est malade : elle ne mourra pourtant que deux ans plus tard, en 1768.
Le roman picaresque d'Emilie continue : elle a retrouvé un ancien domestique de son père, qui atteste qu'elle est bien la fille de Christophe Portocarrero, grand d'Espagne. Elle a ses lettres de naturalisation : elle est française. Bernard l'en félicite. Il lui conseille judicieusement de placer son argent. Son amie, Mme de Nerel, est morte. Emilie doit changer de nom et en prendre un dans sa famille. L'archevêque inconnu quoiqu'espagnol fait toujours des siennes : "je souhaite que ce saint temps (celui de Pâques) lui inspire l'esprit d'humanité, de justice et de bienfaisance qui devrait distinguer les prélats de son ordre": serait-ce un franciscain, par hasard ? Emilie doit présenter un placet à Charles III. Il doit y avoir jugement.
Elle se désespère en Espagne, aussi peu accueillante que possible à l'étrangère qu'elle est : elle passe sa vie dans la solitude et l'ennui. "Puisse l'anglaise, la française et l'espagnole faire avec moi une partie carrée" lui écrit drôlement Gentil-Bernard.
Il parait que M. Horrutence est toujours vivant ! Il n'est donc pas encore parti pour le royaume des ombres... "Mon expérience, mon âge et l'attachement très particulier que je vous ai voué" écrit Bernard à Emilie : il s'agit en effet, on le voit, d'une amitié amoureuse dont on n'aurait pas cru capable, on ne sait pourquoi, ce charmant poète érotique. Emilie est sa fleur bleue. Elle pourrait être sa fille, elle est loin de lui, il lui rend tous les services possibles : quel amour plus désintéressé ? On s'aperçoit qu'elle a à Paris un autre domestique nommé La Jeunesse comme celui qui l'accompagne en Espagne : Gentil-Bernard l’emploie pour qu'il ne soit pas au chômage. D'ailleurs lui et M. de Saint-Germain, qui est aussi un ami très sûr, sont toujours persuadés qu'elle va revenir sous peu. Gentil-Bernard est bien vu, reçu des princes allemands qu'il a connus pendant la guerre de Succession de Pologne, en Italie, il y a vingt ans, en 1733-34.
18 juin 1766 : Emilie s'est cassé une dent, et apparemment il n'y a pas de bon dentiste en Espagne, il faut faire faire un appareil dentaire à Paris, par un nommé Fayol. La chute d'une dent, chez tous les bons spécialistes de l'onéïromantie, est mauvais signe pour les affections : en effet, elle signifie pour Emilie sa rupture avec le Suédois dont elle était amoureuse ; on ne sait qui c'est, en tout cas pas comme on aurait pu croire le baron de Friezendorff, que du reste elle verra, car il doit être nommé ambassadeur près de la Cour de Charles III.
Il n'est pas question qu'elle rentre : "Je vois que vous passerez encore en Espagne le temps des chaleurs ; mais enfin l'automne nous rendra notre Emilie, notre nouvelle patriote", écrit le gentil Bernard.
Mais il est temps de toucher un mot de la famille Portocarrero, si remarquable à plus d'un titre.
Un ancêtre reluisant : le Cardinal de Portocarrero
L'histoire des Portocarrero commence comme un conte de Boccace : une certain Egidius Bocanegra, patricien génois et frère du Doge de Venise, est envoyé, en 1340, par la République Sérénissime, au secours d'Alphonse IX, roi de Castille, qui lutte contre les Maures. Ses services lui valent le titre de comte de Palma. Nommé amiral, il se fixe en Espagne. "Son petit-fils épousa l'héritière de l'illustre maison de Porto-Carrero, dont il prit les armes et qu'il continua." Voilà donc nos descendants de Génois, devenus bons Espagnols au service de la Castille. Ils relèvent le nom d'une famille célèbre tombée en quenouille. Mieux, même : "Aux environs de Montijo, écrit Pierre-Athanase Larousse avec ce sens littéraire qui fait défaut à nos dictionnaires de l'ère industrielle, se voit encore un domaine qui fut érigé en comté en 1697 par Charles II d'Espagne au profit de Jean de Porto-Carrero."
Il faut dire que les Portocarrero n'avaient pas attendu la fin du XVIIe siècle pour se distinguer. Un siècle auparavant, dans notre département actuel de l'Aude, on trouve un N. de Portocarrero cardinal espagnol (1556-1614) qui fut d'abord abbé de l'abbaye de Montolieu, puis 32e abbé de Sainte Marie de Villelongue, aux environs de Carcassonne (1) pas très loin de la paroisse de Viterbe dans le Tarn où, nous le verrons, Emilie terminera sa vie. Mais ce cardinal contemporain d’Henri IV, sans doute installé avec l'appui de la Ligue, est éclipsé un siècle plus tard par la célébrité de la maison Portocarrero : un autre cardinal. Celui-ci a 68 ans au moment où Charles II en 1697, érige son nom en comté. Le cardinal est chef du Conseil d'Espagne. C'est un de ces grands ecclésiastiques hommes d'Etat comme en secrète l'Europe de l'Âge Classique : Richelieu, Mazarin, Alberoni, Fleury, Bernis.
______________
(1) : F. Vincent Ferras : Le rayonnement médiéval de l'Ordre de Citeaux en pays d'Aude (Albi 1971).
"Il se laissa convaincre continue l'incroyable Pierre Athanase Larousse, par les instances de Villafranca, Medina-Sidonia, Villagarcias, Villena et San Estevan, que l'intérêt de l'Espagne exigeait un testament du Roi en faveur d'un prince français ».
Le Cardinal de Portocarrero est le chef du parti francophile en Espagne, ce qui le fait très mal voir de M. Larousse, anti-français comme tous les intellectuels de cette nation. Qu'on en juge : "Il employa, pour agir sur l'esprit de Charles II, tous les moyens que lui donnaient son double caractère d'homme d'Etat et surtout de prêtre. Il fit aux yeux du faible monarque l'exposition des droits de la famille de Bourbon et acheva de porter l'épouvante dans son esprit par la menace des peines étemelles dans le cas où il négligerait de se choisir un successeur, ou ferait du tort par cette nomination à l'héritier légitime." Ôn se régale de voir l'Histoire ainsi écrite avec les procédés captivants d'Eugène Sue et de Ponson du Terrail. Il n'y manquait qu'un pape félon à la Borgia, vite, M. Larousse distingue dans les agissements du cardinal Portocarrero la main froide du serpent : "Il obtint du roi que le pape Innocent X serait consulté.
Le résultat ne pouvait être douteux, à raison de la vieille inimitié que le Souverain Pontife nourrissait contre la Maison d'Autriche... " Arrêtons là le feuilleton. Pour vous le faire court, ce pape fourbe et louche conseille au crétin agonisant de léguer sa monarchie espagnole à l’atroce duc d’Anjou, dont le principal crime pour Larousse est d’être le petit-fils de Louis XIV.
"Le roi consulta néanmoins toutes les autorités du royaume avant de se décider. Portocarrero avait placé des créatures à lui dans les conseils, qui inclinèrent tous en faveur de la France. Enfin, le 2 Octobre 1700, Charles II dicta sa dernière disposition, en présence de Portocarrero et d'Arias. Deux jours après, se sentant dans l'impossibilité absolue de diriger les affaires, il remit les rênes du gouvernement à Portocarrero. Le cardinal, dans toutes les négociations relatives au testament de Charles II, semble avoir été surtout un instrument entre les mains du marquis d'Harcourt, ambassadeur de France. Lorsque le nouveau roi d'Espagne, Philippe V, fit son entrée solennelle à Madrid le 19 Janvier 1701, ("il n'y a plus de Pyrénées"), Portocarrero se jeta à ses pieds et voulut lui baiser la main ; le roi l'en empêcha et l'embrassa en lui disant qu'il le regardait comme son frère, tant il savait combien il s'était montré zélé pour sa cause. Il continua à jouer un très grand rôle dans les conseils, mais ses intrigues sans nombre finirent par le dépopulariser. Il quitta la Junte Royale et s'attira un grand ridicule en acceptant la charge de Capitaine des Gardes. Il finit par se retirer entièrement du Conseil des Affaires, mais il resta fidèle à Philippe V et se signala par son attachement à la personne de ce roi. Lorsqu'il mourut en 1709, il voulut être enterré dans un bas-côté de l'église de Tolède, devant l'entrée de la chapelle appelée des Nouveaux Rois. Il défendit que sa sépulture fut ornée en aucune sorte, et voulut qu'on put passer et marcher dessus. Il ordonna qu'on y gravât cette épitaphe: "Hic jacet cinis, pulvis et nihil" ("Ici repose de la cendre, de la poussière et rien. ") Il fut exactement obéi."
Ce remarquable ecclésiastique homme d'Etat, sorte de Mazarin mâtiné de Richelieu, ne plaît pas, il s'en faut, à tout le monde, et d'abord à Pierre-Athanase, dont il choque violemment l'anticléricalisme pudibond. Le passage de l'Espagne aux Bourbons ne se fit pas sans cris ni heurts, puisqu'il déclencha la Guerre de Succession d'Espagne. Il faut croire que l'arrivée au trône espagnol du petit-fils de Louis XIV fut un véritable crève-coeur pour les Anglais (habitués, eux, à avoir des souverains teutons) car des années après l'écrivain Macaulay en gardait assez de rancoeur pour écrire des pages achevées de bouffonerie sur le cardinal Portocarrero : il est probable que l'honnête Macaulay se serait montré plus indulgent envers le même abominable cardinal s'il avait appelé un anglican quelconque à régner sur la Très-Catholique Espagne... Comme l'opinion de cet adversaire est révélatrice, par ses outrances, de l'envie que l'Angleterre portait au cardinal, on donnera le charmant croquis qu'il en a tiré. "Portocarrero appartenait à une race d'hommes qui, heureusement pour nous, ne figurent qu'en très petit nombre dans notre histoire, mais dont l'influence a été le fléau des pays catholiques. C'était, comme Sixte IV et Alexandre VI, un politique formé d'un prêtre impie : ces politiques sont généralement pires que les simples laïques, plus impitoyables qu'aucun bandit qu'on puisse trouver dans les camps, plus malhonnêtes qu'aucun suppôt de chicane qui hante les tribunaux... Portocarrero était un de ces prêtres, et il semble avoir été un maître consommé dans son art. Il n'avait pas de prétention au titre d'homme d'Etat ; le noble rôle de son prédécesseur Ximenés n'était pas plus à la portée de ses capacités intellectuelles qu'à celle de ses capacités morales. Ranimer une monarchie engourdie et paralysée, introduire l'ordre et l'économie dans un trésor ruiné, rétablir la discipline dans une armée qui n'était plus qu'une cohue de soldats, remettre à flots une marine qui pourrissait dans les ports, était une tâche au dessus de l'ambition de cette ignoble nature... Mais il en était une à laquelle le nouveau ministre était admirablement propre : la tâche d'établir, au moyen d'une terreur superstitieuse, une domination absolue sur un esprit faible, et le plus faible des esprits était celui de son infortuné souverain..."
Comme vous y allez, Mister Macaulay ! "Prêtre impie, plus impitoyable qu'un bandit... incapable... et même carrément malhonnête ! Ignoble nature !" Sont-ce là des façons de s'exprimer, pour un honnête pasteur anglican fusilleur de Zoulous ? Autant d'injures qui ne signifient pas grand chose, si ce n'est le vif désappointement qu'un Anglais ne soit pas devenu roi d'Espagne. Les Anglais du XVIIIe siècle considèrent l'Espagne et le Portugal comme leurs premières colonies, peuplées de natives : ils y installent Gibraltar, où ils sont encore. De plus c'est une tradition, chez les intellectuels d'Albion, de critiquer, plus ou moins intelligemment, l'action des Européens, chaque fois qu'elle leur est contraire. En ce cas, ils choisissent, pour que leur démonstration soit plus douce aux oreilles protestantes, des ecclésiastiques catholiques : tel Aldous Huxley démolissant le Père Joseph dans "l'Eminence Grise." Ils trouveraient pourtant sans peine, parmi leurs propres ecclésiastiques hommes d'Etat, des massacreurs d'Irlandais, d'Hindous, ou l'immortel fondateur des Camps de Concentration : Sir Cecil Rhodes. Mais ceux-là, ils ne les voient pas. Comme c'est curieux.
... Et une petite-nièce encore plus reluisante : Eugénie de Montijo
Toujours est-il que malgré les larmes rétrospectives de M. Macaulay, les Bourbons s'installèrent en Espagne au vif plaisir de la population : ils y sont toujours. Et grâce aux bons offices du cardinal, les Portocarrero continuent leur ascension : "Christophe de Portocarrero épousa la soeur du comte de Teba, de l'ancienne maison de Gusman, et fit ainsi entrer le titre de comte dans sa famille." Ce Christophe réédite donc l'exploit du Portocarrero son ancêtre : le voilà allié aux Gusman. Du reste Gusman, Teba, Montijo... On retrouvera tous ces noms et titres dans la correspondance d'Emilie. On a même l'impression que son état de fille naturelle l'a poussée, par réaction et désir d'inclusion, à piocher les généalogies, nobiliaires et autres armoriaux... Elle devait être drôlement au courant des méandres familiaux, alliances et même mésalliances ! Qu'aurait-elle dit si elle avait connu la suite de l'Histoire ! Car Emilie est la grand-tante, par la main gauche, de l'Impératrice Eugénie. Naturellement, ni Eugénie ni personne ne soupçonna jamais cette histoire. Elle est simple :
Le fils de Don Christophe, Don Philippe, eût un fils : Don Cipriano Guzman de Palafox y Portocarrero, comte de Teba, bien connu des mériméens et autres stendhaliens. Ce joséphin, cet afrancesado, suivant les principes de sa famille, fut pro-français et colonel d’artillerie française dans la guerre de 1808-1814 contre les Anglais. C'est sous le nom de colonel Portocarrero qu'en 1814 don Cipriano commanda le bataillon des Elèves de l’Ecole Polytechnique qui défendit contre les Cosaques la Barrière de Clichy. Or, on le sait de reste, don Cipriano eût de Maria Manuela Kirpatrik of Closeburn, d'ascendance wallonne et britannique, deux filles : Maria Francesca et Eugénia Maria - dites Paca et Eoukénia par Stendhal, qui écrivit pour elles le célèbre récit de la bataille de Waterloo -. On connait la suite, et comment Napoléon III épousa Eoukénia. Quand elle faisait ses études au Couvent des Dames du Sacré-Coeur, 77 rue de Varenne, sous le nom d'Eugénie Guzman de Palafox et Portocarrero, la future impératrice des Français ne se doutait pas qu'une de ses grand-tantes avait vécu, cent ans auparavant, dans le même quartier... Peut-être, dans la tapisserie divine et souvent inconnue qu'est le destin des humains, la destinée d'Emilie n'était-elle que le canevas de la prodigieuse existence de sa petite-nièce. De plus, il était écrit que ces deux femmes Portocarrero seraient aimées par des écrivains grenoblois : Gentil-Bernard et Stendhal.
*
Gentil-Bernard à Emilie
Paris le 15 Décembre (1765)
Il y a dix jours que vous êtes partie, belle Emilie, vous voilà bien loin de nous, si vos forces vous ont permis de continuer votre route. J'ai eu de vos nouvelles trois fois ; votre exactitude m'a fait d'autant plus de plaisir que j'étais dans une inquiétude extrême. Le temps s'est radouci. Votre chaise ouverte m'a moins fait de peur et vous allez aux pays chauds, mais vous aurez ces vilaines montagnes à franchir ; enfin, je vous crois, Dieu aidant, par delà les Appennins et dans la capitale d'Espagne. C'est où je vous adresse cette lettre, avec celles que je vous ai promises pour M. le marquis d'Ossun et M. de Fuentés. Je souhaite que l'usage que vous en ferez puisse vous être de quelque utilité ; c'est à M. le comte d'Egmont (1) que je les dois et il ne prodigue pas ses recommandations. Je vous conseille de ne vous servir de ces secours que lorsque vous aurez tenté les voies de la conciliation auprès de la famille. Si vous pouviez tout lui devoir, il n'en serait que mieux. Vous aurez des conseils que vous consulterez, et votre bonne tête y joindra les siens. Tout va bien chez vous, j'ai été voir Antonia et Moretto qui se console de son fils et non pas de vous. J'ai lu à Antonia l'article de votre lettre au sujet de l'argent que vous lui avez laissé, elle exécutera vos ordres ponctuellement. Je lui ai remis ce qu'il faut pour votre loyer et j'en ai retiré la quittance, que je vous garderais.
Je vous envoie le paquet par M. Giamboni qui vous le fera passer, et j'en userai de même par la suite. Vos nouvelles seront plus intéressantes que les nôtres: nous ne courons aucun danger. On n'est içi attentifs qu'au moment où l'on perdra M. le Dauphin; il est depuis deux jours à toute extrémité et vous en saurez la nouvelle plus tôt que vous ne recevrez ma lettre. Je prie le Ciel qu'il vous conserve, mettez-y toute votre attention. Je suis rassuré surtout par ce que vous me dites de votre serviteur. J'espère qu'il continuera son zélé et ses secours, c'est tout ce qui pouvait dans vos tribulations vous arriver de plus heureux.
Bonjour à la belle espagnole, qui à ce que j'espére redeviendra française, et, de cette nation ainsi que des autres, je serai certainement celui qui l'aimera le plus.
____________
(1) : Emilie se fait recommander par des personnages en vue. Casimir Pignatelli, comte d’Egmont, né à Braisne en 1727 est un « excellent officier, exact, méticuleux, aimant son métier » mais c’est en tant que Grand d’Espagne que Gentil-Bernard s’est adressé à lui. Le comte d’Egmont avait pris part à la prise de Mahon à Minorque, et en avait apporté la nouvelle à la Cour le 16 juillet 1756. Il fit la Guerre de Sept ans mais c’est surtout sa femme, fille du Maréchal de Richelieu, qui a retenu l’attention des contemporains, par sa grâce et son esprit. Le marquis d’Ossun, qu’on reverra souvent dans ces lettres, d’abord ambassadeur extraordinaire de France à Naples, est notre ambassadeur en Espagne. Le comte de Fuentès, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de Charles III d’Espagne, habite en 1765 l’Hôtel de Broglie, rue de Varennes.
*
A Paris le 6 Janvier 1766.
Je vous écris, belle Emilie, dans un moment où je suis plus tranquille sur votre santé. Votre lettre de Pampelune m'a bien rassurée, vous aviez passé les monts et vous n'étiez pas morte ; votre courage vous a soutenue contre les attaques du climat et de la saison, j'espére qu'il vous fera surmonter d'autres obstacles, et que les hommes ne seront pas plus cruels que les éléments. Il vous reste à combattre l'intêret et les préjugés ; il faut pour celà cette même fermeté, votre conduite et votre espoir. Prenez d'abord tout le repos qui vous est nécessaire pour que votre tête soit en état de soutenir d'autres fatigues ; j'espére que vous aurez trouvé de mes nouvelles en arrivant à Madrid. Je vous envoie par la voie de M. Baden le peu de lettres qu'on a reçu pour vous. Vos amis ont envoyé savoir de vos nouvelles, et la fidèle Antonia, instruite par moi, a répondu ce qu’elle savait. Elle a grand soin des dépôts que vous lui avez confiés, surtout du père bien aimé qui se trouve fort bien de son repos. J'espére que le fils jouit par vos soins du même bonheur.
Il arrive ce que vous avez craint au sujet du loyer de votre maison ; votre hôtesse insociable veut vous donner congé et à votre voisine, sous prétexte qu'elle va louer toute la maison à la même personne ; vous aurez le temps de nous instruire de vos volontés avant le terme de Pâques. En tout cas je ne vois rien de bien fâcheux à celà, nous trouverons où placer vos meubles, et votre situation à venir décidera de vos projets. Quelque part que vous soyez, vous serez plus sûrement, moins chèrement que vous n'êtes chez la sorcière de la rue de la Sourdiére. Je remercie votre camarade de l'honneur de son souvenir et de la bonne et utile compagnie qu'il vous a tenue dans votre périlleuse route ; je prie Dieu qu'il vous ménage la compagnie de quelque bon ange pour votre retour.
Vous trouverez içi une lettre d'Antonia. Je l'ai bien prêchée sur la sottise qu'elle veut faire et qu'elle fera. J'en serai fâché pour vous comme pour elle. Je n'ai d'ailleurs aucune nouvelle à vous mander. La Cour est dans la plus profonde tristesse, la ville (1) est sans spectacles. Ils recommenceront le 15. Notre rivière est glacée. Je crois que par le froid qu'il fait vous n'auriez pu tenir dans votre logement. Il y a toujours un peu de bien au milieu de tous les maux de ce monde. Adieu, ma belle Emilie, je vous écrirai quand j'aurai reçu la bonne nouvelle de votre arrivée, je vous embrasse mille et mille fois.
________________
(1): On observe le deuil : le Grand Dauphin, père de Louis XVI, Louis XVIII et Charles X, est mort le vendredi 20 décembre 1765. Il n'avait que 36 ans.
*
A Paris le 12 Janvier 1766.
... Mes anciens sentiments pour vous, l'intérêt nouveau que votre situation inspire, tout doit être aussi un sûr garant de la continuité de mon zéle et de ma tendre affection. Votre lettre du 25 décembre me fait voir l'état de vos finances ; il s'agira de bien statuer la pension des 2 700 livres et la perception exacte de ces deniers. Voilà l'essieu de votre fortune, vous prolongez là-bas votre séjour pour y ajouter des roues s'il est possible ; vous faites bien, il en faut pour rouler en ce pays. Les 10 000 Livres vous deviennent fort nécessaires pour le courant, tant en Espagne qu'en France, c'est pourquoi il faut commencer à économiser. Je ferai l'emploi que vous me dites des cent pistoles que vous devez me faire passer. Je ferai délivrer 60 livres à La Jeunesse. Il n'est dû que deux quartiers à votre hôte, de 380 livres à peu prés, il ne faut compter que celà et le courant. Le restant sera remis à M. de Saint Germain. C'est une nouvelle importante pour vous, pour nous intéressante par conséquent, que le voyage inopiné du consul de France que vous nous jetez en deçà des Pyrénées au moment qu'on y pense le moins. Je crois bien qu'il va vous faire faute durant son absence et retarder la conclusion de vos affaires ; d'un autre côté on pourra peut-être lui souffler un degré d'intérêt de plus. Vous faites bien d'écrire à son ami le gouverneur, et de le prévenir sur vos intérêts ; je lui fais passer votre lettre et je lui écris en même temps, parce qu'il fait un temps glacé, et que je n'ai point de chevaux. La rivière est prise depuis plusieurs jours, et depuis six mois il n’est pas tombé une goutte d'eau sur nos terres désséchées. Je chercherai à rencontrer si je puis ce consul secourable, ou je lui ferai parler s'il voit gens de ma connaissance. MM. de Creuts, Yvel, Giamboni feront de leur mieux. Peut-être gagnons nous à ce voyage, qui retardera pourtant le votre. Je ne vous ai pas dit qu’un des personnages que je viens de vous nommer, M. Giamboni est depuis 6 semaines dans son lit avec de très grandes souffrances dans un lieu où s'est formé un dépôt de douleurs, et qui ne devrait être pour nous que la source des plaisirs, il a couru risque même d'être séparé de sa femme par l'amputation du lien conjugal. Il est mieux, on lui sauvera la vie et le désagrément. J'en suis charmé, il vous aime et il est aimable, j'ai passé hier chez lui pour le voir et lui parler de vous ; je n'ai pu le voir ni lui parler.
Votre amitié va être affligée par un évènement plus triste. Ce n'est que d'hier que j'ai appris la perte que vous avez faite de M. Horrutence, il y a quelques jours qu'il est mort sans faire, à ce qu'on dit, aucune disposition. Vous serez plus instruite par d'autres que par moi qui n'ai rien appris que par Antonia ; je partage les sentiments d'affliction que vous aurez. Cet homme là vous aimait pour vous, et je n'ai rien vu que d'estimable dans toute sa conduite à votre égard. J'aurais voulu qu'il eût fait pour vous quelque chose en mourant, mais vous savez comme on meurt. La machine affaiblie voit-elle autre chose que l'objet présent et le néant ?
Laissons aller le cours de nos lettres comme il va. Le bureau de correspondance s'y prête assez bien, je suis sûr de mon ami d'Harboulin, celà vaut mieux que des cascades et des renvois.
Antonia se charge de la commission de M. l'abbé de Montboile, et selon sa réponse et l'arrivée des oiseaux, on s'acquittera le mieux qu'on pourra des ordres que vous donnez. On ne peut répondre aux nouvelles de Fils Fils que par des tendresses réciproques d'un père assez indifférent, mais qui se porte aussi comme l'indifférence. Je ferai de mon mieux pour avoir des nouvelles de vote abbé consul (1) par le comte de Creuts qui sûrement le verra et lui parlera de vous ; je crois voir par la conduite du premier qu'il aurait été bien aise de vous mener avec lui, qu'il serait peut-être encore plus charmé, s'il s'en retourne si tôt, de vous garder en Espagne. Il est malaisé de délier les chaînes des autres quand on en porte soi-même ; vous m'avez mis sur la voie de ces réflexions, qui me seraient bien venues sans vous; j'en ferais bien d'autres si je voulais, mais vous me diriez que ce sont des châteaux en Espagne... Vous direz, belle Emilie, tout ce qui vous plaira, pourvu que vous ne croyez pas que j'imagine rien qui vous soit contraire, et capable d'affaiblir l'attachement fidèle que je vous ai voué. Recevez en les nouvelles assurances et le serment que je fais de vous aimer toujours bien tendrement.
On a appellé hier Tronchin (2) à Versailles, parce que l'état de Madame la Dauphine devient plus critique de jour en jour. Le Roi devait aller à Marly, mais l'état de cette princesse et le froid extrême qu'il fait le retiennent à Versailles. Tenez vous bien chaudement, je vous recommande toujours à La Jeunesse, il est bien juste que vous pensiez à lui par tous les services qu'il vous rend et l'attachement qu'il vous marque ; vos amis s'en souviendront aussi.
____________________
(1) : L’abbé consul est l’abbé Béliardi, intime du ministre Choiseul. [Et si l’on en croit Casanova, le concubin secret d’Emilie (voir note (1) page 22). Est-ce que Gentil-Bernard était au courant ? On peut le penser car un peu plus loin il note : « Il est malaisé de délier les chaînes des autres quand on en porte soi-même »]. Note d’Angélique Escande-Dubuisson, décembre 20019.
(2) : Tronchin: médecin génevois, un des propagateurs de l'hygiène, bien dans la ligne du "retour à la terre", se fixe à Paris en 1766 et, comme son compatriote Rousseau, y jouit d'un immense succès.
*
A Paris le 19 Janvier (1766)
... J'attendais l'adresse que vous deviez me donner ; la lettre qui m'annonce votre arrivée ne me parle de rien, ainsi je me sers de la voie de M. Giamboni et de M. Baden. Vous voilà, belle amie, rendue au lieu de votre destination. Deux craintes me restent : votre santé et vos affaires. La première n'était pas bonne, et Dieu veuille que ce ne soit que de la fatigue. Vous n'augurez point mal du succès de votre entreprise par le premier coup d'oeil. Que d'embarras il vous reste encore à essuyer, que d'obstacles à vaincre! Contre celà je ne vois que Dieu, justice et votre courage. Donnez vous tout le temps de vous reposer. Rien de nouveau dans votre domicile. Votre gouvernante s'y porte bien, et Moretto aussi. On vous instruit des nouveaux caprices de votre hôtesse et du congé qu'elle vous donne ; il faudra le prendre, si vous en croyez vos amis. Vous serez partout mieux que là.
Dans ce moment même, je reçois la lettre du 5 et celle du 6 que vous m'écrivez et qui me donnent beaucoup d'alarmes pour votre santé ; je crains les suites de cette colique. Je vais faire consulter Cassan et Pean, mais je ne sais quand vous pourrez avoir leur avis parce que l'ordinaire va partir. Souvenez vous autant que vous pourrez du régime qu'ils vous ont fait suivre l'année dernière. Tenez vous dans votre lit, puisque vous ne pouvez être ailleurs. Avez vous au moins une bonne garde qui vous soigne ?Antonia voudrait bien être avec vous dans ce moment et moi aussi. Je vous recommande à La Jeunesse. La lettre a été remise à sa femme, Antonia croit qu'elle n'est pas encore accouchée.
Votre lettre du 6 me rassure un peu. J'y vois que votre colique est diminuée, mais le froid continue toujours, et il ne peut que vous être contraire. Je vais m'informer de M.de la Pailleterie pour faire usage de votre lettre et l'exhorter à faire ce que vous désirez; je souhaite qu'il soit à Paris, et à portée de vous rendre le service que vous en attendez. La nécessité de ce nouveau secours mé fait entrevoir les obstacles que vous trouvez, dont l'idée me fait beaucoup de peine. Au milieu de tant de traverses, songez à votre vie. Et croyez que vos amis sont et seront fort occupés de vous.
Cette lettre et les autres iront sous l'enveloppe de M. Baden comme vous l'ordonnez, recevez tous mes voeux et l'assurance des sentiments les plus sincères. Si vous avez des lettres à m'envoyer faites les mettre sous l'enveloppe ci après :
A M. d'Harboulin fermier général des Postes à Paris.
*
1766.
"Les affaires prennent un meilleur train. L'intérêt et la justice doivent parler en votre faveur, votre conduite et votre esprit ajouteront à ces moyens... Ce qui me donne le plus d'espérance, c'est l'appui que veut bien vous prêter l'ambassadeur de notre cour... J'ai vu M. de la Pailletterie, quelque répugnance que j'eusse à cette visite. Il a été pour vous à Versailles... J'ai porté aussi vos remerciements à l'Hôtel des Invalides et j'ai vu M. Part hier qui savait déjà de vos nouvelles par M. l'abbé Belliardy dont il échauffera encor le zéle par sa réponse ; cette protection peut beaucoup. M. le comte d'Egmont me l'avait bien dit. Enfin j'espére que la France et l'Espagne plaideront en votre faveur... Antonia a vu il y a deux jours la femme de La Jeunesse : elle ne compte accoucher que dans huit, son mari peut être tranquille, M. Cassaig la verra. Moretto n'a point eu froid du tout parce qu'on a eu grand soin de lui, il baise son fils et sa tendre maîtresse... Tous vos amis partagent l'intérêt que vous inspirés mais personne ne le ressent aussi vivement que moi, je n'ose compter sur un aussi prochain retour quoique mon amitié le désire avec impatience..." (27 janvier).
*
1er Février. ...Vous me faites encore trembler au récit des malheurs qui sont arrivés dans la même route que vous avez parcourue. Quel bonheur d'en être échappée! Vous méritez bien d'obtenir le prix de votre courage... Je suis charmé que la lettre que j'avais obtenue pour vous ait produit l'effet que vous me dites, et qu'elle concoure au succès de vos desseins. Il redoublera mon attachement pour l'auteur de cette lettre et l'obligation que je lui ai.
Rien n'est mieux senti que ce que vous me dites sur la conduite que vous tenez ; elle ne peut être trop réservée. On vous observera beaucoup, et le bien qu'on dira de vous là bas fera un très bon effet içi ; il avancera aussi vos affaires, qui dans le cas où vous êtes ne doivent pas languir. M. de la Pailletterie m'a paru se porter avec plaisir au service que vous lui avez demandé ; il m'adresse le paquet où sans doute est incluse la lettre que vous souhaitez ; puisse-t-elle accélérer la décision de votre sort et mettre en état d'agir pour vous la puissance dont vous avez besoin.
Antonia m'est venue voir hier et m'a procuré la visite de Moretto, que j'ai vu dans ses plus grandes vivacités et dans toute la beauté de ses fourrures... Votre hôtesse opiniâtre persiste toujours, et je vous donne toute raison de vous séparer d'elle. Votre bon esprit y avisera.
Le Roi recommence ses chasses et ses petits voyages. Il a été retourné à Marly avec des dames. La Cour est un peu moins triste. Le Carnaval se passe à Paris sans fêtes et sans bals particuliers. Il y a quantité de beaux mariages. L'affaire du Parlement de Rennes parait terminée et tous les autres parlements se taisent, voilà la paix intérieure. On parle de guerre d'un autre côté mais sans fondement. On fait un emprunt en rentes viagères à 9% à tout âge. Si le Ciel fait tomber dans vos mains quelques pistoles d'Espagne, je vous conseillerais de les placer là. Vous aurez du temps, je vous souhaite les moyens. Adieu belle amie, achevez votre caravane et revenez plus heureuse pour revoir des amis que vous rendrez plus contents.
*
2 Février. Ma chère Emilie doit croire que je suis plus occupé que jamais de l'intérêt de ses affaires, puisqu'elles continuent à la tourmenter ; je désire plus ardemment de les voir finir. Je crains que toutes ces contrariétés ne prennent sur sa santé. L'événement de la mort de ce pauvre Horutence ajoute à cette inquiétude. Je sais tout ce que vous lui deviez de sentiments et de reconnaissance, et votre coeur doit être profondément affligé ; vous le perdez encore dans une circonstance où il était nécessaire à vos arrangements. Votre projet pourra-t-il subsister encore ? J'ai ouï dire que M. Horutence n'avait point fait de testament, ce qui pourrait bien être ; M. de Saint Germain sera plus à portée de le savoir précisément, et, s'il en existait un, d'en avoir connaissance. J'espére d'ailleurs qu'il aura laissé tout en régle par rapport à vous. Il aurait pu mieux faire, et vous laisser une marque secourable de son amitié.
J'ai passé plusieurs fois chez le Comte de Creuts pour le voir et savoir des nouvelles du consul. Je n'ai pu trouver Son Excellence, je la chercherai encore pour lui parler de vous. M. Giamboni va mieux, quoiqu'il ne sorte point encore ; je le verrai pour ce que vous me dites, si M. de Saint Germain ne peut avoir les informations que vous lui demandez.
Vous perdez un ami, ma chère Emilie ; croyez qu'il vous en restera d'autres qui cherchent à partager et adoucir vos pertes et les contrariétés de la Fortune. Votre courage et vos sages résolutions suppléront au reste, que la santé ne vous abandonne pas, et vous aurez la gloire de surmonter l'infortune, on peut être heureux dans des degrés différents : la Sagesse est de se trouver bien dans celui où nous lie la nécessité. Vous vous passeriez bien de la morale, je la quitte aussi pour vous renouveller les assurances de tous les sentiments que je vous ai voués pour la vie.
*
A Paris le 10 Février 1766.
... Votre hôtesse prétend avoir loué la totalité et vous mettant dans le cas de prendre un parti décisif. N'y ayez pas regret, Antonia prétend que vous n'auriez pas pu y habiter cet hiver et qu'elle est froide et plus froide que l'habitation d'Agreda... Vous ne me dites rien encore de la tournure de vos affaires, je crains les lenteurs et le refroidissement de l'intérêt qu'on a d'abord pris à votre situation. Pourrait-elle cesser d'attendrir ceux qui vous connaîtront davantage ! Antonia m'a dit que vous lui donniez l'espérance de votre retour pour le mois d'Avril, je m'abonnerais pour celui de Juin. Enfin vous ne ferez que ce qui sera convenable. Les passages seront plus libres à votre retour. Quoiqu'il arrive, votre tête sera aussi plus calme. Puissiez vous ne trouver que des roses où vous avez trouvé des précipices ! Vous aurez la France et vos amis en perspective, et cet aspect vous sera plus doux.
Je suis bien flatté que vous m'ayez rappellé dans le souvenir de M. le Comte de Creuts, sa présence et son amitié doivent vous être d'un grand secours dans le lieu que vous habitez ; quelles ressources ne devez vous pas trouver dans les grâces de son esprit et dans les conseils de sa raison ! Assurez le de l'empressement qu'on a de le recevoir à Paris et de le dérober à l'Espagne. Par son goût et par le notre il doit naturellement nous appartenir. Il cultive les muses, il vous aime, il se souvient de moi, voilà bien des raisons qui m'engagent à lui renouveller l'assurance de mon attachement. Recevez belle Dame celle de mon hommage très humble et de mon amitié bien tendre.
Antonia fait demain une folie, c'est-à-dire un serment conjugal.
*
16 Février.
... Antonia se porte fort bien de sa cérémonie et du Mardi-Gras qu'elle a passé légitimement dans les bras de l'amour. Je souhaite que cet hymen lui attire beaucoup de bénédictions et peu de progéniture. Moretto en a été témoin, et il eût été bien aise de participer au même sacrement. Faites part de ses nouvelles à son très honoré fils qui peut être voudrait bien aussi rendre quelques espagnoles heureuses...
*
A Paris le 25 Février 1766
... J'apprends que votre santé se soutient malgré l'ennui de votre solitude et le tracas des choses qui doivent se passer dans votre tête. Vous avez peu de jours à attendre la décision de votre sort, j'imagine que vous en êtes instruite à présent et que vous ne tarderez pas à en informer vos amis. Je suis de tous le plus impatient, parce que je dispute à tous le sentiment de vous être attaché avec le plus vif intérêt ; j'aimerai bien les espagnols s'ils vous rendent la justice que vous méritez et s'ils ajoutent à votre bonheur ce qui lui manque. Votre utile consul raffermit mes espérances, parce que l'on m'a fait connaître son crédit, ses lumières et son humanité. Je vois qu'il est temps qu'on se décide par l'état de vos finances, et je conçois vos délicatesses sur l'emprunt. Je trouve vos raisons bonnes au sujet de votre logement de Paris ; cette affaire sera bien entre les mains de M. de Saint Germain. S'il y a moyen de conserver votre logement jusqu'à la Saint Jean, vous pensez bien qu'on le fera, malgré la mauvaise humeur de votre hôtesse. Je lui ferai passer le terme exactement au temps marqué comme je vous l'ai promis, n'en ayez point d'inquiétude. Je vous ai fait passer deux lettres de M. de la Pailletterie, celles de M. Yvel ont sans doute pris une autre route. Vous verrez ce qu'ils pensent tous deux. Le premier m'a paru aussi bien disposé pour vous que jamais, je lui dois cette justice. Je n'ai pu joindre encor le Baron, que j'ai été chercher plusieurs fois. Antonia m'est venue voir hier avec le fidèle et bruyant Moretto, elle m'a paru contente de son nouveau sort ; je souhaite que la fortune accompagne le sacrement. Je lui ai bien dit tout ce que vous m'aviez chargé de lui dire d'obligeant, elle en est très assurée et très reconnaissante. Vous pourrez continuer à m'écrire sous l'enveloppe de M. d'Harboulin, l'un des fermiers des Postes du Roi.
Je viens de voir à Choisy la Cour qui reprend sa forme ordinaire. Jeudi se fera la cérémonie du catafalque pour M. le Dauphin, c'est M. de Brienne, archevêque de Toulouse, qui prononcera l'oraison funèbre. On a encore de l'inquiétude pour le Roi de Pologne Stanislas (1), qui s'est brûlé prés de son feu ; quelques parties de son corps ont été entamées et l'on en craint les suites dans un âge aussi avancé. C'est un prince que la Lorraine et la France regretteront beaucoup. Je reviens à vous belle amie, et je vous exorte au [?] et à la patience, vous en aurez le prix à ce que j’espère. Je suis charmé de ce que vous me dites du fidèle La Jeunesse et des ressources que vous en tirez, jusqu'à en faire votre femme de chambre, Dieu lui donne la force d'accompagner votre retour, vos amis lui auront beaucoup d'obligation. L'autre La Jeunesse est dans une maison orageuse et chez des personnes dont le sort n'est pas trop assuré. J'ai du chagrin pour un de mes serviteurs, pour Du Sigur qui maladroitement a fait la contrebande en livres, s'est laissé prendre et mettre à la Bastille, ce qui me donne quelques embarras. J'espère cependant l'en retirer ; vous voyez que tout est mêlé de peine, c'est le sort des hommes et la combinaison mixte de toutes les choses de ce monde. Faisons le mieux possible et louons Dieu de tout après cette fin de lettre édifiante ; j'embrasse mon amie.
___________________
(1): Quand Gentil-Bernard écrit, le Roi Stanislas est mort effectivement à Nancy depuis deux jours, de la suite des brûlures de sa robe de chambre. En moins de deux ans, Louis XV perd son fils le Grand Dauphin, son beau-père et sa belle-fille Marie-Josèphe de Saxe, Grande Dauphine.
*
Une histoire de sombreros
Dans la lettre suivante, Gentil-Bernard parle d'une "étrange sédition" arrivée en Espagne. Elle a en effet, apparemment, une cause des plus ridicules. Charles III, roi très sage par ailleurs, éprouva en 1766 le singulier besoin de réglementer le costume de ses impétueux sujets. Sous prétexte de distinguer les honnêtes gens des coquins, il interdit le port des larges capes et du vaste chapeau appelé chambergo qui ont tant fait pour la réputation de l'Espagne. Il prétendait que ces accessoires à larges bords rabattus permettaient aux gredins de faire leurs mauvais coups. La populace s'enflamma pour la capa et le chambergo. "Le coup du chapeau" fut l'occasion d'une émeute le dimanche des Rameaux : pendant trois jours les Madrilènes s'attaquèrent aux Gardes Wallonnes, aussi détestées en Espagne que les Gardes Suisses en France en 1792 : ces défenseurs de la royauté espagnole étaient recrutés parmi des Belges et des Allemands. Il y eût beaucoup de morts. Le roi s'enfuit à Aranjuez. En fait cette histoire de cape et de chapeau fut la goutte qui fait déborder le vase : depuis six ans la sécheresse avait renchéri les prix et le peuple était au bord de la misère. Il rendait responsable de la disette un Italien détesté : le Ministre des Finances, Esquilache que Gentil-Bernard appelle Esquilazy. Aussi mal vu qu'au siècle précédent Mazarini en France, Esquilache s'enfuit, mais son palais fut pillé. Le retrait du roi mécontenta le peuple, qui se crut trahi. L'émeute fit tache d'huile, gagna Barcelone, Saragosse, des dizaines de villes, preuve que le mécontentement était profond. Le roi appela alors au pouvoir le comte d'Aranda, qu'il fit Président du Conseil de Castille, second personnage de l'Etat. Aranda décida que le bourreau seul aurait le droit de porter le chambergo, ce qui naturellement déconsidérait cette admirable coiffure, que personne ne voulut plus porter.
A plus longue échéance la révolte des chapeaux aussi swiftienne qu’elle nous paraisse (elle ressemble à l'histoire des gros-boutiens et des petits-boutiens, dont la guerre ravage Lilliput selon qu'ils ouvrent leurs oeufs mollets par le gros ou le petit bout) fut à l'origine, par la nomination d'Aranda et de Campomanés, ministres "éclairés", de l'expulsion des Jésuites d’Espagne.
*
A Paris le 6 Mars 1766.
J'ai été bien longtemps, ma chère amie, sans recevoir de vos nouvelles, vous vous plaignez peut-être aussi de mon silence, j'ai manqué le courrier de l'autre semaine, n'étant pas à Paris. Cependant j'avais mis les choses en régle pour vos lettres de naturalisation, que vous avez du recevoir. Sur les conseils qu'on m'avait donnés, les frais ont été beaucoup moindres, ils ne se montent qu'à 200 livres. J'en ai donné part à M. de la Pailletterie pour qu'il retirât lui-même ces lettres dont on vous a fait passer une copie bien collationnée. M. Giamboni et M. de Bernage vous ont été fort utiles dans cette expédition. J'attendais aussi avec impatience M. le comte de Creuts que je rencontrai avant hier chez Madame Geoffrin, jugez de mon empressement à lui demander de vos nouvelles ; le comte m'en est devenu encore plus cher en m'assurant que vous vous portiez mieux et qu 'il augurait bien de vos affaires. Je reçois presque en même temps votre lettre du 24 mars avec celles qui y étaient jointes pour le Père Yvel ; je les lui ai fait passer tout de suite après y avoir pris les éclaircissements que votre confiance me permet. Je vois le point où en est la négociation de votre fortune. Le parti modéré et honnête que vous prenez est sans doute le meilleur, il est singulier que vous ayez contre vous un homme de Dieu fait pour professer la justice et la charité ; vous êtes bien conseillée, et vous avez courage et patience. Le comte de Creuts m'a dit toute la considération que vous vous êtes acquise là bas, et l'intérêt que vous vous êtes concilié par l'honneteté de votre conduite ; vous la soutiendrez aisément, le grand point était de l'établir comme vous l'avez fait.
J'ai vu l'étrange sédition que vous me décrivez à merveille, et j'ai frémis des dangers que vous auriez pu courir : c'est un nouvel article à mettre dans le roman de votre vie. Mon Dieu que les hommes sont fous par tous pays ! On nous assure que tout est calme depuis, et qu'on vous laissera librement vacquer à vos affaires, au moyen du départ de M. Esquilazy. Cette relation m'est arrivée comme j'étais avec Madame Geoffrin qui m'en a demandé une copie. Le comte a été aussi à portée de lui dire beaucoup de bien de vous. Cette dame est aussi courageuse que vous l'êtes à un âge un peu différent ; elle part dans huit jours pour aller en Pologne voir un jeune roi qui l'aime à la folie ; elle irait plus loin, si elle osait, pour visiter une impératrice qui la désire bien autant.
J'ai été au moment dé faire un pareil voyage. Le comte de Coigny va à la Cour de Prusse et il a voulu m'enmener avec lui, j'ai résisté à ses persécutions, ne voulant plus que du repos et la société de mes amis. Je dois vous parler d'une autre grande affaire qui vous touche et qui ne regarde point l'Espagne, mais votre gîte de Paris. On a plaidé la cause de votre logement ; il a été prouvé que le propriétaire avait des engagements réels, et il faut déloger. On a cherché partout pour suivre vos intentions et vous ménager un asile, on a trouvé à quatre pas de chez vous en entrant dans la Rue Neuve des Petits Champs par la gauche, seconde porte cochére, un logement au premier, fort petit à la vérité mais propre et commode, du même nombre de pièces que celui que vous quittez. L'antichambre est très petite, le salon joli, la chambre commode et chaude, un cabinet de toilette où l'on peut mettre un lit, deux chambres en haut, petite cuisine en bas, voilà tout ; votre déménagement se fera sans beaucoup de frais. Vous serez toujours à même de changer, enfin vous vous trouverez comme vous étiez en partant sans augmenter votre dépense. M. de Saint Germain vous rendra compte de tout celà, je crois que vous serez contente. Le nouvel hôte faisait encore des difficultés, heureusement on m'a nommé à lui ; il s'est trouvé me connaître, et sur mes attestations il n'a fait aucune difficulté de s'engager. Finissez donc vos affaires le mieux que vous pourrez et ne doutez pas que vous ne trouviez des bras et des coeurs ouverts et un logement prêt à vous recevoir. Mes amitiés au tendre Fils Fils, j'ai vu son père, toujours emporté et furieux. Antonia prendra tous les soins que vous attendez d'elle, j'aurai l'oeil à ce qui se passera. Soyez aussi contente de l'Espagne que vous devez l'être de la France et tout ira bien. Je n'ai point de nouvelles à vous rendre pour celles que vous m'avez données ; nos Parlements sont soumis, nos milices sont tirées, tout est tranquille, mais tandis que nous sommes inondés d'éloges funèbres, de papiers et d'oraisons mortuaires, nous sommes encore menacés d'en voir augmenter le nombre. La Reine (1) est toujours fort mal, elle rend le pus par haut et par bas. Ses régles sont revenues, ce qui est un très mauvais symptôme ; enfin on désespère de son rétablisement. Le Roi ne la quitte pas, et il se montre aussi bon mari qu'on l'a vu bon père. Adieu, belle et chère dame, que Dieu vous donne la santé, que les hommes vous rendent justice et que Toutou vive.
____________
(1) : Marie Leszczynska.
*
A Paris le 7° mars 1766.
Je ne vous ay point écrit, Belle amie, au commencement de cette semaine comme j'ay toujours fait, ayant vos ordres à éxécuter et n'ayant pu les remplir à temps pour vous en rendre comte, quand vous recevrés cette lettre vous serés déjà instruitte que tout se dispose pour ce que vous désirés ; jay d'abord vu Mr. de la Pailletterie, que jay trouvé à votre égard dans les dispositions où vous croyés qu'il étoit, il a réitéré les mêmes offres pour vous. Sur celà jay été voir Mr. de Giamboni pour demander son avis et ses conseils en cette matière qui luy est connue il m'a adréssé à un procureur qui y est expert et que j'ay été consulter de sa part. Après bien des difficultés il a entrevu les arrangements qui rendent la chose possible, il a fait son calcul au plus juste et les frais se monteront quoyqu'on fasse à 400 L. J'en ay fait part au Marq. qui n'en est point effrayé ; tout va bien jusques là. Mais il faut une formalité absolument nécessaire dans votre absence c'est une procuration de vous sur laquelle on puisse opérer. Mr. Giamboni doit vous faire passer le modèle que le procureur a fait, il faut le temps qu'il arrive et que l'expédition passe au sçeau ; voilà ce qui m'afflige parce que si cette pièce vous est absolument nécessaire voilà bien du temps quelle vous fera perdre. Si Dieu veut que votre sort soit décidé avant ce temps là je vous trouveray bien heureuse ; je crains que vous ne soyés préssée de vos besoins ; vos juges doivent y avoir égard et leur relligion y doit être intéréssée. M. de St Germain est à la suite de l'affaire qui concerne votre loyer et votre incommode hôtesse, sil y a moyen par le droit et la justice vous jugés bien qu'on vous y laissera jusqu'à la St Jean et les raisons qui vous le font désirer sont évidente. Les nouvelles que nous attendons de vous nous instruiront à mesure, et je vois tous vos amis prêts à vous seconder. Ils implorent ceux que vous vous faites en Espagne de concourrir avec eux ; ils y seront disposé comme nous, s'ils peuvent vous connoître. Je remets fidèlement vos lettres à la fidèle Antonia. Jay fait porter par votre La Jeunesse la lettre que vous avés écritte à Issy et elle y est arrivée à bon port; Antonia vous dira par la lettre cy jointe de ses nouvelles et de celles de Moretto; mille caresses à son cher fils. Mille et mille amitiés à sa tendre maîtresse; tant que je pourray m'acquitter de ses ordres je le feray avec le zélé, lempressement et l'ardeur qu'elle me connoit pour tout ce qui est agréable à son coeur, utile à sa fortune et nécessaire à son repos. Je luy adresse et luy consacre tous les voeux de ma tendre amitié.
*
A Paris le 16 Mars 1766.
... Je suis rassuré par le beau temps dont vous devez, jouir encor plus que nous. Je voudrais être aussi rassuré par l'état de vos affaires. Combien ne doivent elles pas prendre sur vous ! Aussi je fais des voeux bien sincères pour qu'elles finissent. J'ai fait tout ce que vous m'avez ordonné. Vous aurez vos lettres de naturalisation à meilleur prix que je ne vous ai mandé, M. Giamboni vous en rendra compte. Il était nécessaire d'avoir un certificat de catholicité ; j'ai été voir M. le curé (1) de Saint Sulpice qui s'est bien ressouvenu de la bonne catholique qu'il vit avec tant de soin l'année dernière et qu'il eût mené au Ciel, si le Ciel n'avait pas juger à propos de la laisser encor sur la terre. Il m'a donné l'attestation que je demandais et je l'ai remise à M. Giamboni ; mais il faut attendre que l'on tienne le Sceau, ce qui vous fera attendre quelques jours de plus cet acte de naturalisation. Puissiez vous n'en avoir besoin qu'en France et voir avant votre sort décidé. C'est un coup du Ciel assez heureux que vous ayez trouvé là bas un ancien domestique de M. votre père qui atteste ce qu'il a vu. Dieu mêle toujours quelque adoucissement à ses rigueurs. Il est bien juste qu'il vous regarde enfin d'un oeil plus favorable. Je vois içi vos amis fort occupés de vous. M. Hivel m'écrivit avant hier pour me prier de passer chez lui. C'était pour l'aider à faire un mémoire à votre sujet pour que M. de Soubise (2) obtienne de M. de Choiseul une lettre de recommandation nouvelle pour M. le Marquis d'Ossun ; nous avons fait ensemble ce mémoire. Il espère obtenir ce qu'il fait demander.
... Notre Reine se rétablit tous les jours. Les Parlements se taisent devant l'acte d'autorité que le Roi a fait, et qu'il parait devoir soutenir... Je suis fâché que le Comte de Creuts quitte Madrid avant vous ; je lui sais bon gré de ses égards et de ses soins pour vous. Je lui crois des qualités qui manquaient peut-être à un autre Suédois que vous me rappeliez dans une de vos lettres ; j'épargne à votre sensibilité de vous en retracer la mémoire. Bonjour à l'aimable française, qui ne sera plus anglaise ni espagnole ; nous l'adoptons tous içi ; elle doit croire que je signerais volontiers l'acte qui l'attache au pays qui parait le plus l'aimer et qu'elle chérit davantage.
__________________
(1) : Le curé de Saint-Sulpice, depuis 1748, est Jean du Lau d'Allemans, qui travailla à l'organisation des Missions. "En 1753, il attaqua devant le Parlement un certain nombre de ses paroissiens qui refusaient de rendre le pain bénit." C'est lui qui en 1763 fit entreprendre les travaux de la chapelle qui devint l'église Saint-Pierre du Gros-Caillou (Biographie Française).
(2) : Le Prince de Soubise est un des personnages les plus vilipendés de l'époque, l'opinion publique étant gauchie par les pamphlétaires et les maîtres-chanteurs. Il eût surtout le tort d'être l'ami de la Pompadour. Soubise, militaire brave mais peu capable, fut malheureux à Rossbach, mais vainqueur à Sondershausen, Lûtzelberg, Johannisberg: l'opinion française, toute acquise aux Prussiens par Voltaire, ne voulut se souvenir que de la défaite et jamais des victoires (comme nous n'avons retenu, de la guerre de 40, que notre défaite et l'Occupation, fructueuse entreprise de films à bon marché tous plus bêtes les uns que les autres).
Le Prince de Soubise mérite mieux que sa réputation bâtie par les propagandistes prussiens comme Voltaire. C'était, de plus, un ami fidèle. Seul des courtisans, on le verra accompagner à Saint-Denis, en 1774, le corps de Louis XV. Vieux monsieur de 70 ans, il agira encore en 1784 pour Emilie de Portocarrero.
*
... Si l'arrangement qui sera fait pour vous pouvait vous procurer une somme dont vous pussiez disposer, vous en feriez usage en la plaçant dans les rentes nouvelles qui sont ouvertes et qui sont très favorables. Le pays de l'or, où vous êtes, devrait vous en fournir assez pour vous constituer le bonheur. Une autre réflexion que je fais dans le moment où se passe la révolution de votre état et le changement de votre vie ; je vous conseillerais de quitter un nom adopté qui ne vous fait tenir à rien, et de choisir dans ceux que vous pouvez porter et qui vous attachent à l'une de vos deux familles : j'arriverais à Paris sous ce nouveau nom. L'époque justifie le changement, et bien des raisons le rendront favorable. Méditez ce conseil de l'amitié.
On a du vous apprendre une nouvelle qui touchera votre sensibilité : c'est la mort de Madame Nerel. Le triste état où elle vivait diminue en quelque sorte la tristesse de sa mort ; en récompense on m'a dit que son fils était heureux et qu'il se trouvait très bien dans le pays qu'il habite.
*
A Paris le 24 Mars 1766.
Je n'ay point de vos nouvelles, ma chère amie, depuis le 2 de ce mois ; votre colique et vos affaires me donnent de linquiétude. Vous attendés le moment décisif et la fin de vos travaux. Jugés de mon attente, et combien jay besoin de votre première lettre. Je n'en ay pas de vos amis mais je les sais occupés de vos interests. M. Yvel court après la protection qui vous est nécessaire. Mr de St Germain est à l'affût pour votre maison et il fait sentinelle à la porte. Mr Giamboni est à la poursuite des lettres que vous savés. Je ne say pas ce que fait le marquis. Tout va bien dans votre maison on ne m'a envoyé que cette lettre à vous faire tenir. Je n'ay pas le temps défaire la mienne bien longue, je ne veux pas manquer le courrier et je vous réitére à la hâte les protestations de la plus tendre et la plus fidèle amitié.
*
Midi sonne. Toutes les cloches des églises et couvents de Madrid se mettent en branle, bougeant l'air chaud et pourtant vif. Emilie pense que leurs sons sont plus graves, plus lents, plus profonds aussi que ceux des argentines cloches parisiennes, ou celles de son couvent de Pontoise. Elle sort sous un parasol, comme les élégantes Madrilènes, le fidèle La Jeunesse lui tenant la queue. La foule, où dominent tous les tons de bruns, relevés de rouge, se hâte dans les rues, parmi les cris aigus des marchands d'herbes en plein vent. Des moines de toutes les couleurs gras comme des capérans ou maigres comme des sardines, flânent ça et là, certains sous de longs chapeaux à larges bords relevés (des Jésuites). Un prêtre passe, portant le Saint-Sacrement à un malade, précédé d'un homme qui agite une cloche : la foule, ondulant comme l'herbe sous le vent, s’agenouille, fait des signes de croix, se décoiffe. Des carrosses dorés sur toutes les tranches roulent pesamment, montés par des laquais aux livrées rouge et or, les rideaux soigneusement tirés. La poussière, les épluchures, les os font du sol une litière d'immondices, que se disputent des chiens maigres. Une odeur puissante de sueur et de litières vous prend à la gorge dans les ruelles où s'alignent, dans des caves obscures, des écuries pour ânes. On en voit partout, gris, beiges, blancs, montés par de graves hommes de police, tout en noir, une baguette, insigne de leur pouvoir, dans la main droite. Un oeil exercé reconnaît à leurs costumes les provinciaux : Catalans en bonnets rouges, Manchègues, Navarrais, une couverture sur l'épaule. Une compagnie de Gardes Wallonnes traverse la place, précédée de tambours de bois aux résonances bien particulières. Emilie remarque qu'ils portent exactement le même uniforme qu'à Paris les Gardes Françaises : bleu, à grandes boutonnières blanches et revers rouges - la livrée des Bourbons -. Seule la cocarde, blanche à Paris, rouge en Espagne, diffère.
Emilie a loué, Plazuela de Matute (Placette de la Contrebande, ce qui est plaisant pour une personne sans famille ni nation), un appartement coquet. Elle y est bien seule. Elle ne s'entend guère avec ses femmes de chambre, qui la trouvent orgueilleuse et distante. Elles disent entre elles qu'après tout ce n'est qu'une de ces innombrables bâtardes dont on ferait aussi bien de débarrasser le royaume. Elles, au moins, ont un père et une mère ; elles ne vont pas errer à l’étranger pour les rechercher; elles savent où ils sont. Emilie n'a pas de familiarité, et ce qui passerait en France pour de la simple politesse est vu ici comme de l'orgueil. Même les grands seigneurs ont avec le peuple des rapports vraiment aimables : ce sont des Méridionaux. Mais Emilie a été élevée en Angleterre et dans des couvents français, où une certaine distance douce et froide est de rigueur : elle ne comprend pas ces gens, dont elle est si proche par le sang, et si loin par l'éducation. Elle se sent déplacée. Même quand elle se rend à Aranjuez, où la cour est plus détendue, il lui semble que ces duchesses et ces marquises qu'elle aime tant la regardent avec hauteur. Ce n'est que de la curiosité. Que vient faire sous ces lambris royaux cette Madame de Saurin inconnue, qui est recommandée par tant d'ambassadeurs, de consuls, d'abbés de trois ou quatre nations ? Le Roi Charles III, qui lui a accordé une audience extraordinaire, juste avant de partir à la chasse, est un homme grand et maigre, au teint couleur de brique, au long nez, qui ressemble tout à fait à un de ces âniers qu'on rencontre dans les rues, la majesté en plus. Il a daigné lui sourire, a prononcé une phrase rapide sur son défunt père, le comte de Montijo, qu'a immédiatement traduite le truchement de l'Ambassade de France. Il est heureux qu'Emilie aime les chiens, car pendant que dans sa robe de soie brodée de grands ramages elle faisait sa révérence à Sa Majesté, des braques de la meute royale sont venus la flairer, du temps qu'elle restait immobile, la tête baissée. Sa Majesté a pris le placet que lui a tendu le majordome, a incliné la tête : le truchement pense que l'affaire de la reconnaissance est en bonne voie.
Emilie a fait des connaissances à Madrid, mais surtout dans la colonie française. Les moeurs sont trop différentes. Mme Carreau est une de ses amies : à Paris la verrait-elle ? C'est la femme d'un commerçant. M. Joseph Mourère s'occupe de ses affaires : un banquier depuis longtemps en Espagne (dont le nom veut dire: celui qui fait la moue, celui qui fait la tête. C'est du provençal : Muraire, le vrai patronyme de notre Raimu). Il fournit à toutes les dépenses d'Emilie, qui a un compte sur la banque Lecoulteux et Cie, de Paris. Il a fallu payer un traducteur pour les pièces originales de la filiation de Madame, rapportées d'Angleterre, estampillées du Consulat de Londres. En faire des copies pour M. Valladolid, l'avocat, pour les exposer aux juges. M. Mourère fournit Madame en piastres et en pistoles, dont il faut tout le temps surveiller le cours. Il a fallu trouver un notaire, qui s’est occupé d'envoyer une notification au Bureau de la Maison de Montijo.
On n'a affaire qu’à des hommes de loi, qui pullulent, avec leurs paperasses, leur encre, leurs doigts tachés. Don Bemardo a fait un exposé de la situation de Madame, pour délivrer à M. Hérédia. Heureusement qu'Emilie a ça pour s'occuper, car elle s'ennuierait profondément. C'est une mélancolique. Elle se rend à la messe tous les matins pour impressionner favorablement tous ces Espagnols, mais je ne sais si ça leur fait grand effet. De toute façon, pour eux, elle restera toujours une étrangère, pis que ça: une enfant illégitime. C'est elle qui porte le pêché énorme de son père. Elle n’aurait pas dû naître. Les préjugés du sang, dans le peuple, sont bien plus terribles, caricaturaux, que dans la noblesse. Au contraire, des dames comme la duchesse de Hijarès, la comtesse de Teba voient plutôt favorablement Emilie, qui leur apporte l'écho des modes parisiennes, si différentes des Madrilènes. Ce n'est pas que celles-ci soient laides, loin de là : c'est une autre grâce, où le rouge souligne crûment, somptueusement le blanc de la peau et le noir des cheveux bien tirés - rien des perruques blanches à la française et des robes à fleurettes et rubans bleu pastel -. La nourriture aussi est étrange. Emilie, qui a l'estomac délicat, se la fait confectionner par La Jeunesse. Elle a toujours la même santé fragile. Une année, en 1770, pratiquement tout l'argent que lui versent les Montijo part en médicaments, à l'apothicaire Jean de Cuellar, à un nommé Isidore del Castillo, marchand Calle de Las Portas. Ce qui ne veut pas dire qu'Emilie les paie : non, ils font des assignations à M. Joseph Mourère qui est bien obligé d'allonger les ducats de vellon. La pension qu'Emilie reçoit des Montijo est confortable : Mille ducats de vellon par an, en trois paiements. Pour une femme dans sa position, c'est joli. Mais elle pense que sa condition est toujours supérieure à sa position, et dame, de telles pensées, si on les met à exécution, coûtent cher...
A part acheter des chiens pour les offrir à des princes qui doivent agir sur des ministres qui doivent agir sur des ambassadeurs qui doivent persuader M. le comte de Montijo de payer sa pension à sa demi-soeur, que fait Emilie en Espagne ? Agite-t-elle des mouchoirs parfumés sous le nez des "petimetre " (petits-maîtres locaux) pour engager quelque intéressante conversation ? Il n'y paraît guère. Elle doit pourtant avoir beaucoup de moments libres, Plazuela de Matute. Gentil-Bernard est persuadé qu'elle les passe dans un dolce farniente avec des coureurs de guilledou dans son genre. Il se trompe. Emilie est une travailleuse. Dans un registre chimérique, certes, mais travailleuse quand même. C'est la providence des cas désespérés pour châteaux en Espagne et bulles de savon prêtes à s'évanouir dans les mirages. De nos jours elle serait Présidente du Club des Chercheurs de Trésors, ou elle dirigerait une agence de recouvrement de dettes, ou un cabinet de recherches de testaments en déshérence.
Casanova, l'aventurier vénitien, est en Espagne justement au moment où Emilie y est aussi, en 1767-68. "Misérable Espagne !" s'écrie-t-il (1). Il n'en voit que ce qui peut gêner ses entreprises maquereautesques : dans les chambres le verrou est non pas en dedans, mais en dehors de la porte pour que la Très Sainte Inquisition puisse venir vérifier à toute heure ce que font les gens dans les lits, s'ils sont effectivement mariés, et ainsi de suite. C'est évidemment ridicule. Mais plus de deux cent ans après, des amis perpignanais (1989) m'affirment qu'avant la libéralisation des moeurs, des cars entiers d'Espagnols faisaient la queue devant leurs cinémas cochons, traversant exprès la frontière pour voir des lubricités tournées sous Félix Faure et que leur grand âge avait d'ailleurs rendues presque vénérables. "Même que ces cinémas ont fait fortune !" précisaient-ils (les Perpignanais sont envieux). On voit que l'Espagne n'a guère changé. Sous Charles III, à peine un prêtre porte-t-il le Saint Viatique à quelque moribond que tout le monde se jette à genoux, soulevant des flaques de boue (uniquement quand il pleut). L'affaire des chapeaux qui a chassé le ministre Elquilazy se continue par une affaire de braguettes : celles qui ne sont pas "à pont-levis" ne sont pas estampillées du sceau des bonnes mœurs ; la Sainte Inquisition tiendra la main à ce qu'elles le soient. Comme au chambergo et à la capa, le bourreau seul aura droit à la braguette. (Cet homme devait être bizarrement accoutré). Dans les théâtres, toujours selon Casanova (mais on peut lui faire confiance, c'est de son rayon), le devant des loges est à claire-voie pour que los padres de la Très Sainte Inquisition puissent constater de visu que les spectateurs n'en profitent pas pour peloter les genoux des spectatrices. Au beau milieu d'une pièce, même au moment le plus palpitant, si la sentinelle à la porte crie : "Dieu !" cela veut dire qu'un autre prêtre passe avec le même Saint Viatique que tout à l'heure ; tous les spectateurs, les acteurs, los padres, la sentinelle se précipitent à genoux dans un fracas de tonnerre, soulevant des flots de poussière...
________________
(1) : Comme on l’a vu page 22, Casanova a eu l’occasion de croiser Emilie de Portocarrero en Espagne ; il n’en dit que trois lignes plutôt méprisantes. Mais mon père Jean Escande n’eut pas connaissance de cela, bien qu’il souligne le fait que l’aventurier est en Espagne en même temps qu’Emilie… Voir note (1) page 22. Note d’Angélique Escande-Dubuisson, décembre 2019.
Personnellement, je trouve dommage qu'on ait gommé des moeurs aussi inattendues, qui font beaucoup pour le dépaysement du touriste. Les vieilles Anglaises ne s'y trompent pas, qui savent qu'après les flagellations de la Semaine Sainte à Séville il s'en passe de drôles dans les chambres sans verrou (c'est même pour ça qu'elles ont fait le voyage). Bref l'Espagne de Charles III ressemble à un dessin de Dubout avant la lettre, où le conformisme le plus intransigeant engendre la fantaisie sexuelle la plus débridée : car naturellement plus on défend, et plus le public prend un malin plaisir à transgresser.
D'ailleurs le moindre étranger, arrivant en Espagne, y est suspect : en 1764 Beaumarchais ne doit à rien moins que l'appui du roi lui-même de ne pas aller en prison, et Casanova, lui, est jeté pendant 43 jours dans celle de Barcelone pour une aventure galante. Il est vrai qu'où qu'il aille, le Vénitien tâte de la tôle.
*
A Paris le 14 Avril 1766.
Je vois, belle amie, qe vous n'avez point été la victime de cette singulière conspiration : elle a fait içi beaucoup de bruit, et l'on plaint le Roi. Enfin vous nous annoncez la fin de cette révolte, (1) qui a du vous causer quelque crainte ; ce qui m'en fâche le plus, c'est qu'elle ait retardé vos affaires. Dieu veuille qu'elles finissent bien vite, et pour votre repos et pour votre retour ; vous êtes informée par ma lettre précédante de tout ce qui s'est passé au sujet de votre logement vous sortez de la maison et non pas du quartier, à peu de chose prés vous serez logée de même, avec un hôte plus honnête. Demain on déménage vos meubles ; ils n'ont qu'un pas à faire, j'y veillerai, soyez tranquille ... J'ai communiqué à M. de la Pailletterie la lettre de M. de Nerel. Il a retiré vos lettres de naturalisation, dont le duplicata a du vous être adréssé par M. Giamboni, je souhaite qu'il concoure au succès de vos affaires. C'est de M. Yvel que dépend la nouvelle lettre de recommandation du Ministre, et je l'en ai vu fort occupé, croyez qu'il fera ce qu'il pourra.
... Vous aviez grand besoin de La Jeunesse, et je suis charmé de ce que vous m'en dites. L'autre est toujours dans une condition orageuse qu'il n'aura pas de peine à quitter. J'ai peu vu M. le Comte de Creuts, parce que je n'ai pas été beaucoup à Paris. Je l'ai trouvé un peu changé, un peu bruni ; plus sérieux et plus triste, n'allez pas recevoir les impressions, concevoir surtout votre gaîté.
Antonia n'a rien reçu du comte d'Argigny ; elle fera les commissions dont vous la chargez, son camarade Moretto m'est venu voir, il se porte très bien. J'aurais une nouvelle de chien à mander à Fils Fils si je ne craignais de lui faire peur. Un petit chien de Mme la Maréchale d'Estrées était devenu fou d'amour, sa maîtresse n'a pas voulu le marier ; sa folie a passé jusqu'à la rage, et il a mordu le doigt de Mme la Maréchale, à qui la tête a tourné. On lui a excorié le doigt, on lui fait prendre toutes sortes de remèdes et on n'est pas sans crainte ; il faut prévenir de pareils accidents et marier promptement tout ce qui est en chaleur ; quelque belle chienne espagnole profitera de cet exemple et recevra les embrassements de votre toutou chéri (2).
Notre reine est toujours dans le plus grand danger ; la Faculté parle fort mal de son état, et chaque jour ajoute à nos craintes. Sa Majesté a été surtout affectée de la mort de Melle Perrin, sa femme de chambre favorite qui vient de mourir de la même maladie qu'elle a pris auprès d'elle. Mme la Dauphine a été aussi fort incommodée ; si les rois et les princes sont tourmentés par les maladies et les séditions, le Ciel ne veut donc pas que personne ne jouisse du bonheur dans ce monde.
Ne vous tuez pas à m'écrire, j'ai été charmé de tous les récits que vous m'avez faits mais celà doit vous coûter trop de peine, je veux aussi que vous ayez mal au poignet pour moi. Deux mots de votre santé, un mot de vos affaires ; vos ordres nécessaires voilà tout ce que je demande... Je vais partir pour Choisy, où le Roi va se distraire 24 heures. J'y resterai quelques jours pour faire travailler à mon hermitage et le mettre en état de vous y recevoir. L'hermite alors sera le plus heureux solitaire qu'il y ait. Il ornera sa chapelle de fleurs et sonnera toutes ses cloches. Adieu, Madame et belle amie, je vous rends le plus tendre et le plus sincère hommage.
_____________
(1) : Il s'agit toujours de la révolte des chapeaux et de Charles III.
(2) : Adélaïde-Félicité Brulart de Puisieux, seconde femme de Louis César Le Tellier, duc et maréchal d'Estrées, qui a 71 ans cette année 1766. Elle habitait 17 place Vendôme.
*
Expulsion des Jésuites d’Espagne
A Paris le 20 avril. (1766)
Je m'étois bien douté ma chère Emilie, de la cause de votre silence ; je ne pouvois l'attribuer qu'à celle que vous m'apprenés par votre lettre du 6 de ce mois. Tous ce que je crains le plus au monde est de vous savoir malade dans le pays où vous estes ; vous me rassurez sur votre état présent et sur celuy de La Jeunesse qui devoit ajouter à votre inquiétude, c'est encor dans ce moment que nous vous avons appris l'accident arrivé au père de votre camarade ; on en a eu le plus grand soin, je lay vu par moi même, je lay trouvé entouré de deux ou trois personnes qui s'occupaient à le réjoüir, il a encor les jambes un peu foibles ; on le promène avec des liziéres, on le baignera quand il fera un peu plus chaud, je l'enverray aux eaux si cela est nécessaire enfin croyés qu'il ne luy manque rien et quil lui reste toute sa vivacité et ses grâces. Antonia vous fera ces détails mieux que moy, elle a été bien malheureuse de cet accident, je lay vûe dans l'état où vous auriés été vous même, et dans lequel j'aurais été bien fâché de vous voir. Je feray sçavoir à vos amis l'etat où vous vous estes trouvée. Antonia ira chés quelques uns, je verray les autres, je passeray aujourdhuy ou demain à Ihotel de Suèdes pour y voir vos amis, et pour qu'ils instruisent labbé Belliardy que je n'ay pas revu depuis ma séance chés le Gouverneur. Jay vu le baron qui se prépare toujours à partir au commencement de may. Je voudrais pour vous qu'il fut là bas, j'aimerais mieux encor que notre consul, votre conseil, y retournât. Jay reçeu hier la pragmatique que vous m'avés fait le plaisir de m'adresser, jen ay fait l'usage que vous m'aviés indiqué et mon ami vous est fort obligé, il a déjà profité d'une partie de la pacotille de M. Nerel, il sera charmé de la nouvelle qui a surpris toutte l'Europe (1) elle nous étoit déjà annoncée par quelques courriers diligents ; on admire le secret courage et la prudence de votre Cour, quelque lenteur quon luy attribue elle a été bien plus vite que nous. Sa conduite justifie encor celle qu'on a eue et qui ne tardera pas d'être suivie par d'autres puissances. Il restoit encor à notre Cour des protecteurs de la Compagnie qui seront affligés, mais le public est fort aise et je crois que notre maitre l'est aussi (2). Je n'ay pu vous écrire l'ordinaire dernier ayant fait un voyage pendant ce temps là, jen avois prévenu Antonia pour quelle y supleat et vous mandat des nouvelles du petit infortuné. Jattendray avec empressement celles que vous me promettés. Votre maladie ne tenant qu'à votre rumatisme et à ces coliques, dés qu'elles sont appaisées, vous vous rétablirés aisément dans le beau temps qui nous arrive ; il nous étoit arrivé il y a un mois, et depuis quinze jours il a fait un froid assés rigoureux et un temps fort désagréable. Celà ne mempêche pas d'aller touttes les semaines dans mon hermitage que je continue à mettre en état pour vous y recevoir quand il plaira à Dieu et à son archevêque. Je souhaite que ce saint temps luy inspire l'esprit d'humanité, de justice et de bienfaisance qui devroit distinguer les prélats de son ordre. Tout ce qui se passe en Espagne ne peut il pas encor contribuer au retard de vos affaires, voilà ce que je crains, parce que je crains tout ce qui prolonge votre absence, ce qui afflige votre coeur, et ce qui expose votre santé. Occupés vous delle sur toutte chose, ma belle amie, soumettés y tout autre interest, il faut revenir bien portante ; après l'examen de l'histoire et du roman de votre vie, jay vu que vous avés été plus heureuse dans le pays que nous habitons que dans tous ceux où vous a promené la fortune ; vous y trouverés encor des fleurs, l'amitié en fera naître sous vos pas, vous estes d'âge et de figure à faire aussi d'autres moissons ; à moins que je ne voye le bonheur en personne qui vous retienne par la main au delà des rochers, il faut les franchir pour revenir aux bords de la Seine ; c'est où je vous souhaite. Amen.
__________________
(1) : Il s'agit de l'expulsion des Jésuites d’Espagne, le 31 Mars, sur ordre du Roi Charles III et du comte d’Aranda. L'événement, venant du Roi Très Catholique, fit un bruit considérable. Les Jésuites avaient déjà été chassés de France le 6 Août 1762, où le Parlement de Paris avait dissous la Société de Jésus. C'est l'aboutissement d'une lutte qui durait en France depuis plus de cent ans entre Gallicans et Ultramontains. Depuis les guerres de religion, les Jésuites avaient toujours cherché à s'immiscer dans les affaires non seulement spirituelles, mais nationales. En Espagne ils créaient un véritable Etat dans l'Etat. En France on leur reprochait, de plus, de dépraver la jeunesse par leurs mauvaises mœurs : certaines médailles frappées sur ordre de la Pompadour sont explicites à cet égard. Les Jésuites furent tour à tour chassés du Royaume de Naples (20 Novembre 1767) puis du Duché de Parme (7 Février 1768). Finalement, le 21 Juin 1773, le Pape Clément XIV lui-même supprima l'Ordre des Jésuites. On essaie actuellement, fin du XXe siècle, de les réhabiliter.
(2) : Louis XV.
*
A Paris le 21. (Avril 1766. Voir la lettre du 14 Avril).
Depuis la dernière lettre que j'ay écritte, de ma belle Espagnole je n'ay receu aucune des siennes ; je ne doute pas que le trouble qui agitte le coeur de l'Espagne ne luy donne de l'embarras pour ses affaires par l'éloignement de la Cour et la dispersion des personnes dont elle peut avoir affaire. On répand icy la capitulation qui termine les débats du peuple et du Roy. Il est malheureux que ce monarque ait été réduit à cette extrémité. Notre Cour est encore agittée par la crainte, quoyque la Reine soit mieux depuis quatre ou cinq jours, on n'a point d'espérance certaine pour sa conservation. Mad. la Dauphine est aussi malade et a été saignée deux fois, elle est dun grand changement
changement et elle a la toux. Ses enfants ont été malades, il se porte mieux. Heureusement le Roy jouit d'une très bonne santé. La M. ale detrée (Maréchale d'Estrées) dont je vous ay parlé ne sera point enragée : Antonia vous rend compte dans une lettre cy jointe de votre nouvel établissement. C'est comme si vous nétiés pas déménagée ; j'ay tout vu et vous pouvés être tranquille. Voilà une lettre que M. de la Pailletterie me charge de vous faire passer, il me prie de le voir. Je pars pour Choisy et ne seray à Paris qu'à la fin de la semaine. Autre lettre cy jointe du général du Clergé, je pense quil doit vous mander quil va s'occuper de vous. L'assemblée du Clergé recommance les premiers jours du moy. Il est bien essentiel que votre pension soit décidée. J'attends avec grand empressement de vos nouvelles, je n'en ay pas d'autres à vous mander içy. Lheure me presse et j'embrasse ma belle et chère Espagnole qui sera françoise pour moy et pour tous les françois qui luy sont attachés.
*
A Paris le 27 avril 1766.
Je reçois régulièrement les nouvelles d'Espagne qui me sont chères, ce sont celles de ma belle amie. Je vois qu'au milieu du trouble et des séditions elle se porte bien. C'est l'article le plus intéressant pour moy ; ce que je crains fort c'est que tout cecy ne retarde la décision de vos affaires ; je vois par votre lettre du 10 le terme où elles en sont et j'attends avec autant d'impatience que vous le sort du placet qui doit être présenté au Roy ; je vous recommande ensuite à l'équité de vos juges que le ciel bénira sils vous rendent heureuse. Par le récit que vous me faites de l'intérieur de votre vie, je vois dans quelle solitude dans quel ennuy vous la passés, je crains aussi pour vos ressources que le temps doit ajfoiblir, cest à quoy votre espoir et votre courage doivent beaucoup vous servir, c'est ce qui me fait désirer aussi plus ardemment la fin de tout cecy. J'ay fait votre commission auprès d'Antonia que jay été voir hier dans votre nouveau logement qui est tout arrangé et bien arrangé. Je crois que vous en serés contente ; chaque chose a trouvé sa place, il n'y a aucune dépense aucune augmentation à faire, vous pouvés arriver, vous coucher, vous lever, tout se trouvera dans lordre que vous le désirés. Je crois que votre songe sur M. Horntner naura été qu'un rêve. Je me suis informé de ses nouvelles ; son indisposition dure encore, mais elle n'est point mortelle. J'ay chargé Antonia de sen informer plus particulièrement auprès de Mrs. Cassaig et Janselme, et vous recevrés par ce même ordinaire l'éclaircissement quelle pourra avoir ; je me presse de vous écrire parce que je pars pour la campagne. Jestime et loüe vos inquiétudes pour la santé d'un homme qui vous a fait et voulu du bien et auquel vous devés ce sentiment et cette reconnaissance (1). Voicy effectivement le temps où M. de St Julien doit agir pour vous auprès de son clergé qui se rassemble les premiers jours du mois prochain, vous avés très bien fait de luy écrire, je pense que vous avés du recevoir de ses nouvelles il y a huit jours. Je tacheray de le voir, je suis persuadé quil fera tout ce quy dépendra de luy pour vous rendre pensionnaire de Nosseigneurs qui ne peuvent pas mieux placer le superflu de leurs richesses.
________________
(1) : Cette longue tirade sur M. Hertner, banquier lyonnais, montre bien où vont, même en rêve, les préoccupations d'Emilie : à des gens d'argent qui peuvent lui faire avoir des pensions. M. Bollioud de Saint-Julien, Receveur Général du Clergé, n'échappe pas à la règle qu'elle s'est fixée.
Je nay pas grandes nouvelles à vous mander, notre Reine est réellement mieux depuis plusieurs jours sans qu'on puisse absolument décider si elle vivra (1). Mme la Dauphine a été aussi malade, mais elle est sans danger; on soccupe fort dans ce moment du prince (2) héréditaire qui est icy. Les belles les grands et le Roy l'ont beaucoup fêté, et le prince est dit-on fort aimable. On parle d'une révolte arrivée encore à Berlin et lon dit que le Roy de prusse a pris un parti plus violent que le Roy despagne ; tout le monde suit son caractère.
Le temps est beau, j'en profite pour aller cultiver mon jardin, et disposer la chambre qui vous recevra quand vous pourrés lembelir de votre présence. Puisse ce moment netre pas bien éloigné, et puissent l'angloise et la françoise et l'espagnolle y faire avec moy une partie quarrée. Adieu belle dame. Conservés vous sur toute chose et aimés le plus attaché de vos serviteurs.
J'ay vu hier le père au fils, plus beau plus jeune plus brillant quil ne fut jamais, mes compliments à sa progéniture.
________________
(1): Marie Leszczynska ne mourra que deux ans après, le 24 juin 1768.
(2): Ce Prince Héréditaire est le futur duc de Brunswick, auteur du célèbre "Manifeste" qui en 1792 souleva la France contre la Prusse. C'est le futur vaincu de Valmy. Né en 1735, comme Emilie, il n'a cette année 1766 que 31 ans. Général en chef des Prussiens, il sera tué en 1806 à Auerstaedt, par les troupes de Davout.
*
Exécution de Lally-Tollendal
A Paris le 10 Mai 1766.
C'est un assez long voyage que j'ai fait à Dampierre qui m'a empêché la semaine dernière d'écrire à ma chère Emilie. Cette faute ne vient point de mon inexactitude, encore moins d'aucune diminution de sentiment pour elle. Les peines augmentent par le retard de son repos, et mon intérêt s'accroît à mesure, au lieu de s'affaiblir. J'ai vu par sa dernière lettre les nouveaux moyens qui vont être employés pour parvenir à la conclusion tant désirée ; ils me paraissent nobles, intéressants, décisifs, dignes du courage de celle qui les emploie, et du protecteur qui en est l'objet. Le Duc d'Arenda jouit içi de la réputation que vous lui attribuez. Avec les appuis qui vous y conduisent, j'espére, non la fortune que la loi et les poursuites pourraient vous attribuer, mais un état honnête, suffisant, tel qu'il pourra suffire à votre bonheur joint à la liberté. J'ai diné avant-hier avec le Comte de Creuts ; je lui ai fait part de tout ce qui était écrit pour lui. Il y a été sensible, comme vous le croyez bien. Je me suis acquitté de vos ordres auprès de la plus grande partie de vos amis dont le zéle n'est du tout point refroidi, ils feront ce qu'ils pourrons pour faire renouveller les marques de bienveillance qui vous ont été accordées ; je voudrais tenir toutes ces plumes là ; comme je les ferais aller !
... J'ai ouï dire que M. Horrutence se portait assez bien, j'espére qu'il vous donnera le temps de lui marquer toutes vos alarmes et la reconnaissance dont vous vous acquittez par votre inquiétude. Antonia, Toutou, votre appartement, votre lit sont là tout prêts à vous recevoir. Ce gîte vous plaira, je crois, autant que celui que vous habitez.
Il se passe des scènes tragiques à Paris comme en Espagne ; celles-ci ne sont pas d'une si grande conséquence. Les gazettes vous conteront la fin de ce M. de Lolly, ce tyran et ce marchand de l'Inde qui a été puni du crime dont il a été convaincu. Il eût hier la tête tranchée en Place de Grève, par un jugement unanime. Il est mort de la manière farouche et bizarre dont il a vécu ; il a plaisanté ses juges sur la sellette, et mordu son confesseur dans la prison. Il a cherché plusieurs moyens de se défaire, pour éviter la honte de l'échaffaud ; on lui a ôté un cure-dent d'acier qu'il avait. Après la lecture de son arrêt, il a demandé sa redingote au lieu de son habit, et y a trouvé un compas dont il s'est enfoncé une pointe dans le corps, deux doigts plus bas que le coeur. On a vu, à quelques mouvements qu'il a faits, qu'il tachait, à la manière des sauvages, d'avaler sa langue, et on lui a mis un bâillon, avec lequel on l'a mené dans un tombereau au lieu du spectacle. Arrivé sur l'échaffaud, il a jeté sa perruque au nez du confesseur et l'a envoyé paître. Voilà dans quelles dispositions il a perdu la vie et sa mauvaise tête. Le fils du bourreau l'a jeté à bas du premier coup sans que la tête fut entièrement détachée ; la décollation a été achevée par le bourreau père. (1) Voilà un assez vilain détail que je vous fais de la mort et du pêché. Aussi le public a battu des mains, les juges sont applaudis et le Roi très approuvé d'avoir refusé sa grâce. Toutes les santés de Versailles vont bien ; je suis souvent témoin de celle du maître à Choisy. Je vais beaucoup habiter ce lieu là ; en vous y attendant je fais des voeux pour que ce soit bientôt, adieu, belle et tendre amie.
___________
(1): Le 9 mai 1766, le comte de Lally-Tollendal, 64 ans, accusé d'avoir capitulé à Pondichéry devant les Anglais, fut décapité. Il s'était montré d'une extrême violence dans son commandement, faisant attacher les brahmanes à la gueule de ses canons, etc. Il était à moitié fou.
*
A Choisy le 18 may 1766.
Jay reçeu bien régulièrement, ma chère amie, vos lettres du 10, du 21 et du 27 de l'autre mois. Jay répondu aux deux premières avec la même fidélité ; elles me rassurent sur votre santé, elles entretiennent mes espérances sur le succès de vos affaires, elles me parlent de vous. Antonia vous écrit, vous trouverez sa lettre jointe à la mienne, en voilà une autre qui vient de loin, on vous fait le même honneur qu'à Fontenelle, on luy écrivoit à Paris sans autre adresse, parce qu'un homme comme luy n'en avoit pas besoin. Peut être aussi cette lettre n'est elle pas pour vous. Antonia est trop dans le bonheur du mariage pour ne pas donner à Moretto les conseils quelle a pris pour elle même, elle va luy chercher femme, et ce sera un beau train. La Maréchale qui n'avoit pas voulu marier le sien et qui sen étoit mal trouvée, est tout à fait rétablie et hors de crainte.
On travaille tous les jours à l'assemblée du clergé, l'article des pensions est la dernière chose qu'on y régle. Je say que M. de St Julien s'occupe de vous. Je sens votre impatience et l'utilité dont vous seroit l'effet de votre pension pour vous servir de raison et de prétexte de retour. Vous en avés beaucoup d'autres à alléguer, la langue que vous ignorés, la nature du climat qui peut vous être contraire, la proximité du séjour de votre mère et votre souvenir du retour de Londres.
Votre crainte est un sentiment délicat qui me fait plaisir. Beaucoup de choses doivent vous rassurer ; mon expérience, mon âge et l'attachement très particulier que je vous ay voûé. Je passe ma vie en l'air, içy, là, plus à la campagne qu'à la ville et je ne vois pas autant que je voudrois le C. de Creuts et le Baron que vous aimés. Ils se portent bien et se divertissent. On ne parle à Paris que de deux choses, du prince héréditaire auquel tout le monde donne des fêtes, et d'une bourgeoise célèbre qui part demain pour l'allemagne et qui va (1) être reçue comme une reine par un Roy qui l'attend. On dit que les parents de M. de Lally veulent en appeller en cassation d'arrêt pour la mémoire du décolé ; je ne crois pas qu 'ils obtiennent ce qu 'ils désirent ; on parle d'un autre homme qui a eu la tête coupée, c'est le gardien des Capucins de la rüe St Jacques qu'on a dit s'être mis dans cet état ; on croit que ses confrères l'ont aidé et l'on garde le monastère.
Voilà les pauvres petites nouvelles que je puis vous mander. Je me suis acquitté de ce que vous désiriés auprès de M. de St Germain qui a eu la lettre de M. l'abbé Billiardy qui fait bien de vous protéger. Dieu le bénira.
M. de St Germain dans ce moment est à la campagne, il reviendra dans cinq ou six jours. Antonia s'abouchera avec luy pour voir le moyen de vous faire passer cette Robe, on fera tout ce qu'on pourra pour vous complaire. Adieu belle dame, cette écritture imparfaitte vous dira que je suis préssé dans ce moment, je vous assure cependant avec la plus profonde refflexion que je vous aime de tout mon coeur.
________________
(1): Madame Geoffrin et le roi Stanislas Poniatowski.
*
A Paris le 26 may.
Je ne vous écriray qu’un mot aujourdhuy ma belle et chère amie, pour accompagner trois lettres que jay été chercher à votre hôtel ; tout y est en très bon ordre. Antonia, Moretto, tout va bien, tout vous attend, cependant on fait aujourdhuy le paquet des choses que vous désirés et on va lexpédier au hasard quil revienne sans vous. Je crois qu'au nombre des lettres que je vous envoyé il y en a une de M. de St Jullien qui vous parlera sans doute de votre affaire du clergé. Je passe ma vie à la campagne et je reviens de préférence le dimanche pour vous écrire le lundy. On me presse pour repartir pour Dampierre recevés mes voeux et mes amitiés les plus tendres.
Votre La Jeunesse a quitté la maison où il étoit, il dit que cest un enfer où il ne pouvoit faire ni son salut ni sa fortune. Comme il est sans rien faire et que jay renvoyé le domestique que j’avois, je vais le prendre avec moy quelques jours jusqu'à ce qu'il m'en arrive un quon me promet, vous voulés bien me le permettre. Il me rappellera sa maîtresse que j'aime de tout mon coeur.
Mes complimens à votre La Jeunesse que je loüe de sa constance et de son attachement pour vous.
*
A Paris le 1 ° juin (1766)
Après ma dernière lettre écritte, j'ay reçeu, mon intéressante amie, celle du 12 may que vous m'avés adréssée; je vous ay accusé la réception des autres assés exactement, et je crois qu'elles me sont touttes parvenues. Il y a deux jours de retard, parce que mon ami d'Harboulin est à la campagne, d'où il me les a renvoyé. Cette lettre du 12 m'a fait grand plaisir par tous les détails qu'elle contient : je vois que votre conduite est approuvée de tout le monde, la considération avance beaucoup les affaires. Mr. de St Julien a bien fait de soutenir votre courage par ce qu'il vous a mandé. Je vais vous dire pourquoy je n'ay pas vu Mr. de St Jullien comme vous me l'aviés recommandé. Il s'est passé différentes choses entre sa femme et un comte de mes amis, que SJ. a pris fort en guignon. Je crains d'avoir été mêlé dans tout celà et que ma présense au lieu de vous servir ne fut qu'importune. D'ailleurs je suis informé que vous n'avés besoin d'aucun solliciteur auprès de luy. Il vous sert bien sûrement, et je ne doute pas qu'il n'obtienne ce que vous désirés en tout ou en partie. J'aime mieux avoir cette explication avec vous que de vous laisser en doute de mon exactitude. Antonia qui se porte bien, aussi bien que Toto, ira voir ce trésorier. Elle s'y est présentée plusieurs fois et ne l'a pas trouvé. Quant à l'article du loyer prochain n'en soyés point en peine je me charge de l'acquitter ainsi que le suivant, mais j’espère que vous ne mettrés pas à cette épreuve là, et que nous vous reverrons avant le terme de quatre mois. Je donneray à Antonia quelque argent pour qu'elle ne manque pas. Je l'occuperay un peu puisque vous le voulés. Ce mariage ne laisse pas que de la tirer de l'oisiveté où vous l'aviez laissée ; je luy recommande fort de ne pas se mettre dans le cas de l'accident qui luy est arrivé (1) à la Pailleterie, quoyque l'objet soit devenu plus légitime.
Pour m'entretenir encor plus de votre idée, vous savés que j'ay pris votre La Jeunesse de Paris pour me servir dans l'intervale. Il me sert depuis huit jours, et je suis content de son exactitude. Quoy qu'il ne soit pas au fait du service d'un homme, je le garderay le plus que je pourray, afjin qu'il vous attende plus patiemment ; il étoit dans une caverne, il est dans un jardin qu'il cultive avec moy pour vous donner une salade et un bouquet à votre retour ; je vais demain à Choisy parce que le duc de Coigny y reçoit le Prince héréditaire et je suis de cette fête là. Je devrois être glorieux d'être connu sans le savoir de plusieurs princes d'Allemagne. Le Roy de Prusse a bien grondé Mme de Coigny de ne m'avoir pas mené avec eux ; ils en ont été bien reçus et ils m'assurent qu'on m'auroit fait aussi une bonne réception.
J'aime mieux vous attendre içy et me trouver aux pieds de votre canapé qu'aux pieds du trône. Il n'eût aussi tenu qu'à moy d'aller à Varsovie. Un coin de la rivière de Seine me plaît mieux que tout celà, dans l'espoir d'y voir Emilie. J'ay songé à vous le jour de votre sainte. (2) St Bernard aura aussi mon hommage et ma pensée parce qu’il me rappellera les bonnes oeuvres que vous ferés à mon intention, (3) vous estes dans un pays tout dévot, ma très sainte Dame mais s'il vous détache des choses de la terre, je déffie qu'il ote à votre coeur le sentiment qui le lie aux objets d'une tendre amitié.
Je verray le marquis dés que je pourray, je suis fort en l'air toutte la semaine ; je souhaite fort que votre ami de Rouen (4) vous revoye heureuse, il mourroit plus content. Il a mérité de vous ce que vous luy rendés, tout le monde n'a pas suivi son exemple et n'a pas mérité comme luy. J'ay passé deux fois chés M. Yvel sans le trouver, il court beaucoup ainsi que moy. Je vais passer huit jours à Dampierre et tacheray de revenir à temps pour vous écrire dans la huitaine, quand celà n'arrivera pas ne l'attribués qu'à mon éloignement de la capitale. Caressés pour moy le fils, je diray beaucoup de choses pour vous à son magnifique père que l'on cherche à marier selon vos ordres. Adieu, ma chère Emilie, que le Ciel abrège votre absence et vous rende aux voeux de l'amitié, vous savés que j'en forme et en dois former sur celà plus que personne au monde. Voilà une lettre que La Jeunesse vient de m'apporter de chez M. de St Julien, je souhaite qu'elle entretienne vos espérances.
_________________
(1) : Une fausse couche.
(2) : La Sainte Emilie, le 2 juin.
(3) : C'est la phrase qui a permis l'identification de l'auteur de ces lettres : Gentil-Bernard.
(4) : M. Horrutence.
*
Lundy 9 Juin 1766.
Je repasse exprès par Paris, ma chère Emilie, le jour de votre poste d'Espagne pour vaquer à votre correspondance, pour recevoir vos lettres et vous écrire ; voilà ce qu'on m'apporte de chés vous ou tout va bien, logement, toutou, femme, tout est en bon état ; qu'il en soit ainsi à Madrid. Je trouve un long intervale depuis la dernière de vos lettres que j'ay receüe, elle étoit du 12 may. J'en attends avec certitude, si vous n'êtes pas malade ; parce que je say que vous aimés mon repos. Mon ami d'Harboulin est à sa terre, et cet éloignement peut causer du retard. Mandés moy d'abord que vous vous portés bien ; je n'ose encore attendre quelque mot décisif sur la conclusion de vos affaires. Je connois avec quelle lenteur tout se traite, se négocie et se termine dans le pays que vous habittés ; nous avons craint les glaces et les tempêtes en allant, le calme et les chaleurs vont vous faire peur à votre retour ; n'importe j'aime encor mieux ce temps et ce retour là.
Jay donné à Antonia des rideaux à faire et pendant que je l'occupe ainsi La Jeunesse qui est toujours avec moy et dont je suis content travaille au jardin de lhermitte ; vous voyés bien que nos deux maisons n'en font qu'une, je voudrois quelles fussent encor plus unies ; mais la chaîne des Appenins est une terrible barrière. Je n'ay rien de nouveau à vous dire de ce pays cy, tout y est à l'ordinaire. La Cour du Roy est très ambulante, celle de la Reine fort sédentaire. Il est incertain si lon ira à Compiégne. Comme je n'y mettray pas le pied cette année, celà minporte peu. Je vais partir pour Torcy (1). Adieu ma belle Emilie je laisse ordre pour qu'on m'envoye promptement mes lettres parce que j'en attends des vôtres. Je voudrois savoir un mot de tendresse espagnole ; je terminerais par là cette lettre. A ce deffaut je vous repetteray dans la langue qui est devenüe la votre, que je vous aime de toutte mon ame.
Je sens quil vous manqueroit quelque chose si j'oubliés de baiser icy la patte de fils fils.
___________
(1): Torcy (Seine et Marne). Appartient à Jean-Baptiste Colbert de Torcy, marquis de Croissy, dit "Pilo". Ce courtisan assidu de Louis XV avait épousé la tante du duc de Coigny: Charlotte-Henriette-Bibienne.
*
Une dent cassée
J'ai reçu votre dernière lettre à la campagne, et je suis revenu passer 24 heures à Paris pour faire ce qu'elle m'ordonne ; je n'ai rien eu de plus préssé que de voir Fayol pour le petit détail qui le concerne ; il supléra aisément à la perte que vous avez faite ; mais il ne le peut pas sans avoir un modèle ; il eût fallu m'envoyer les deux parties de la pièce qui fut cassée. Si vous ne l'avez pas, il faut, sur celle qui vous reste, faire un modèle en cire parfaitement semblable et l'envoyer dans une coquille de noisette ou quelque enveloppe sure. Il fera alors ce que vous désirez. Sans celà, ce qu'il pourrait faire de mémoire ne vous servirait de rien ; il faut aussi marquer de quel côté de la bouche elle doit être adaptée ; il me parait l'avoir oublié. Il est bien fâché et moi aussi de ce retard. Je me hâte de vous instruire ; quand la chose sera faite, je chercherai la voie la plus sure pour vous la faire parvenir. Si vous avez quelque instruction à me donner encor sur celà je la recevrai et l'éxécuterai fidèlement. (1)
__________
(1) : Le fait qu'Emilie, à Madrid, commande à Paris un appareil dentaire montre à quel point l'Espagne est arriérée.
(2)
*
J'augure toujours bien de votre position sur ce que vous me dites, et vous me rassurez beaucoup en m'apprenant les marques d'amitié essentielles que vous donne la personne dont vous me parlez ; c'est faire emploi de toutes les manières d'obliger et mettre à contribution tous les sentiments de la reconnaissance. Je vois qu'il y a en Espagne des gens qui pensent comme à Paris. Ces gens là méritent bien qu'on fasse des voeux pour eux, et j'en fais de tout mon coeur. Je verrai M. Partier, et j'exciterai son zéle pour vous aider en quelque sorte à vous acquitter de ce qu'on fait pour vous.
Je viens de passer dans votre demeure ; je souhaite au fils la gaîté et la bonne humeur qu'a son père. Antonia est toujours une garde fidèle. Vous êtes instruite sans doute que le baron est reparti pour la Suède où il va prendre les ordres et les instructions de sa Cour pour aller, à ce que l'on croit, dans le pays que vous habitez. Il succédera au Comte de Creutz pour être ensuite son successeur à Paris. Ainsi les Affaires Etrangères s'arrangeront avec les intérêts de l'amitié particulière, qui vous procurera des sociétés que vous aimez. C'est dommage qu'un homme de cette nation se soit rendu indigne de ce désir ; aussi restera-t-il là-bas sans que nous le regrettions ; et vous voudrez bien sur celà imiter notre indifférence.
J'ai diné il y a quelques jours avec le Comte, et nous avons bu à votre santé : il a encore plus d'espérance que moi sur le dénouement de vos affaires. L'extrême intérêt à toujours plus de crainte. Puissent les Rois concourir à la justice que vous rendent vos amis. Mon coeur vous suit à Arantjuez pour vous attendre ensuite à Paris. Adieu, belle Emilie, portez vous bien surtout ; j'ai craint les glaces des Pyrénées je redoute les chaleurs de l'Espagne ; il faut toujours craindre quand on aime, et vous savez combien vis-à-vis de vous ce sentiment doit être naturel.
*
A Paris le 29 Juin 1766.
Je reviens exprès de la catnpagne ma chère Emilie pour éxécuter vos ordres et recevoir de vos nouvelles. Jay cette fois le plaisir de trouver deux de vos lettres, lune du 7 lautre du 12 de juin. Vous entrés sur vos affaires dans des détails qui me rassurent beaucoup et me donnent l'espérance d'une plus prompte décision ; je n'ose me mettre des chimères dans la tête mais enfin je vous envisage avec un état honnête et suffisant, en faut-il plus pour le bonheur, surtout après les peines qui ont accompagné votre vie. Je vois que tous vos protecteurs se maintiennent dans la chaleur de l'interest qu'ils ont pris pour vous, elle est bien nécessaire pour abréger les lenteurs que les espagnols mettent clans tout ce qu'ils font. Je vois que vous passerés encore en Espagne le temps des chaleurs ; mais enfin l'automne nous rendra notre Emilie, notre nouvelle patriotte. Je verray M. Partier pour m'acquitter de votre reconnaissance. Je feray vos amitiés au Comte quand je pourray l'attraper ; ne vous mettés point en peine de votre loyer, je payeray ce terme cy pour vous mettre en crédit ; celà est plus convenable. Je me suis chargé de cette partie, je ne veux la partager avec personne ; je me serois également acquitté de ce que vous désirés auprès d'Antonia, je ne luy ay donné que deux loüis depuis que vous estes partie, si elle a besoin je luy en donneray et je m'informeray delle si Mr. de St Germain a fait ce que vous luy demandés. Jay toujours auprès de moy La Jeunesse et jen suis content. Je ne viens point à Paris sans savoir des nouvelles de votre logement et du joli monstre qui le garde, il souhaite à son cher fils la santé dont il jouit et les femmes quil a. La ville fournit peu de nouvelles l'été. Nous avons perdu le M.al de Noailles et l'ambassadeur de Malte est fort mal. Le prince dont je vous parlois est ce luy de Bronsvik qui a tant fait parler de luy cette dernière guerre. On luy a fait içi la plus belle et la plus magnifique réception, il est parti pour l'Italie. Je ne vous parleray plus de la Suède ; elle a du laisser dans votre âme une impression douloureuse. Vous souvenés vous des larmes dont vous m'avés fait accompagner les vôtres à ce sujet ; il n'en faut plus verser, ma belle amie, une amitié tendre et sure peut produire un bonheur suffisant. Vous trouverés cette ressource, et si vous la cherchés vainement ailleurs, vous la trouverés dans mon âme. Je vais retourner aux champs, je voudrais bien vous voir joüir d'une vie aussi tranquille que la mienne, que lespagne vous rende à la france avec ce quelle vous doit et nous travaillerons à celà.
J'embrasse encor ma très chère Emilie.
*
A Paris le 4 Juillet 1766.
J'ay reçeu la dernière lettre de ma chère Emilie, elle est du 26 juin, elle dit que sa santé est bonne, que fils fils est mieux, que les juges sont choisis et que dans la quinzaine le sort d'une femme intéressante peut être décidé. Je suis bien aise qu'elle ait reçeu des lettres utiles et agréables. L'assemblée du Clergé est séparée, leur trésorier est parti sur le champ et j'ignore le succès de ses soins pour l'affaire de la pension, vous en serez informée avant cette lettre, car il vous a écrit avant son départ ; jaimeray bien les Evêques et je seray aussi dévot qu'eux sils ont fait quelque chose pour vous.
Jallay diner hier à l'Ecole Militaire et je fus ensuite chés Mr. Parthier pour luy parler de vous et macquitter de tout ce que vous me chargés de luy dire au sujet de votre reconnaissance pour M. l'abbé Belliardy. Il a été charmé d'apprendre de vos nouvelles et d'avoir pu contribuer au succès de vos affaires. Il marquera la reconnaissance au Ministre qui vous protège, et sera comme tous vos amis enchanté d'apprendre la fin de vos peines.
Je retourne à la campagne pour toute la semaine. Le Roy va à Choisy. Rien de nouveau à la Cour. Je n'habitte point la ville, jattends que vous y soyés. Antonia mapporte les deux lettres que je mets sous cette envelope, je voudrois my mettre aussi et passer les Pirenées pour revoir une personne que j'aime et que j'aimeray toujours.
Le père à fils fils se porte bien.
*
A Paris le 14 Juillet.
Ma belle amie je n'ay point eu de vos nouvelles depuis dix ou douze jours et j'en attends avec impatience pour savoir ce que décideront vos juges. Je crains encor la lenteur de leurs opérations et de leurs recherches. Je say que dans aucun genre on ne finit rien dans le pays où vous estes, et je souffre de l'ennuy que vous devés avoir.
Je viens de payer le terme échu de votre maison n'ayés aucune inquiétude à cet égard. Tout se passe bien chés vous, votre gardienne est fidèle et son élève se porte bien. Je ne suis pas si content de La Jeunesse, parce qu'il s'est mis dans le cas de metre peu secourable, il a eu quelque foiblesse qui l'ont mis dans un état fâcheux et il ne peut sortir de sa chambre où il fait des remèdes ; je suis toujours sans domestique ; je luy donnerai le temps de se remettre mais je ne pourray pas le garder. C'est un pêché pardonnable mais fort incommode pour le service. (1)
Antonia que je viens de voir m'a dit que les souliers que vous demandés partiraient cette semaine. Mr. de St Germain tachera que ce soit par le courrier. Antonia ne vous écrira que lorsqu 'ils seront partis. Je retourne à la campagne et je fais des voeux pour que notre amie nous soit bientôt rendüe.
______________
(1) : La Jeunesse n°2 a attrapé une maladie vénérienne.
*
A Madame de Saurin à Madrid
A Paris le 28 (juillet 1766)
Je n'ay point eu le plaisir d'écrire à ma chère Emilie la semaine dernière. Je nétois pas à Paris. J'ay reçu à mon retour sa lettre du 7 de ce mois à laquelle je dois répondre. L'absence des courtisans d'Aranjuès n'aura pas été longue. Nous avons bientôt appris la mort de la Reine, jespére quelle vous mettra à portée d'accéllérer le jugement que vous désirés, et que votre avocat sera digne de sa cause (1). Je nay point encore entendu parler de Mr Chevalier bijoutier auquel vous avés remis le petit paquet pour Fayol. Si vous me mandés son adresse, je feray les démarches que vous me prescrirés. Je suis bien aise que M. le Mquis de Crillon me fasse lhonneur de se souvenir de moy. Je suis charmé d'apprendre de ses nouvelles, il y a bien longtemps que je luy suis attaché, je vous prie de l'assurer de tout te ma reconnoissance et de tous mes sentimens.
Jay appris par Antonia que M. de St Germain a fait partir le paquet de vos souliers sans doute par l'adresse que vous me marqués. Je ne pourray faire que dans trois jours votre emplette de coton rouge et de ruban. Vous demandés une troisième chose mais cette chose étoit écritte sous le cachet d'un poulce qui l'a effacé, de manière que je n'ay pu le lire, ni le deviner. Votre paquet étant parti, je verray à vous faire parvenir celuy cy le mieux quil me sera possible. Quand j'auray la petite fiole de Fayol j'auray attention surtout dé faire ce que vous me dittes. Tout est chés vous dans le même état je vois Antonia tous les huit jours, je suis presque toujours absent mais je reçois vos lettres exactement, elles m'intéressent trop pour ne pas les désirer et me procurer les moyens les plus prompts de les recevoir ; quand pourray je ne les plus attendre que de la rue neuve des petits champs. Il y a un siècle que je n'ay vu le Comte, quand je seray à portée de voir Mr Partier vous devés croire que je ne vous oubliray pas, écrivés luy aussi tôt que vos affaires seront finies. C'est vous qui m'apprenés le don annuel de 600 que nosseigneurs vous ont accordé ; je vous en fais mon compliment de toutte mon âme (1). C'est un service que l'amitié vous rend ; vous pourés faire valoir labas cette distinqtion et cette récompense éclaisiastique. Auroit on moins de justice et moins dégard pour vous dans le pays même de la Religion. On ne dit içy aucune nouvelle. La santé de nos princesses est assés bonne pour que le voyage de Compiégne soit décidé, le Roy ira le 7 aoust avec toutte sa famille. Il est vray que le voyage sera plus court. Adieu ma très chère Emilie que j'aime et que j'embrasse de tout mon coeur.
_______________
(1): Emilie reçoit (à quel titre?) 600 livres de don annuel du clergé: deux fois plus que ce que touche un curé de campagne pour son casuel.
*
A Paris le 10° aoust1766.
Je reviens à Paris, Belle Emilie, le plus exactement qu'il m'est possible, les jours que je puis vous écrire et que je puis espérer recevoir de vos nouvelles. Je n'en ay pas reçeu depuis votre lettre du 21 Juillet, vous et fils fils vous portiès bien ; vous estes toujours dans l'attente et nous aussi. Je pardonne à vos affaires de vous retenir encor pendant les chaleurs, mais quand les fraicheurs de l'automne rendront la route supportable, je sauray bien mauvais gré aux espagnols sils vous retiennent encore. La justice qu'ils rendent est aussi lente que la guerre qu'ils font. On a du faire partir un petit paquet qui a été remis à Mr. de Saint Germain et qui contient plusieurs coupons de ruban tels que vous les désirés ; je ne réponds pas de mon goût, je ne suis sur que de mon zéle. Il y a plusieurs paquets de coton rouge, jay pris tout ce que jay trouvé de plus beau dans les boutiques. Je désire avoir bien fait. Je n'ay point entendu parler de l'homme que vous m'avés annoncé dans votre précédante lettre, ni du dépost dont il est chargé, j'attends sur celà ou par luy ou par vous d'autres éclaircissements. Voilà une lettre d'Antonia qui vous donnera de ses nouvelles et de celles du père. Tout se porte bien chés vous. Toutte notre Cour est établie à Compiégne où nos princesses sont arrivées à bon port. Je crains detre obligé dy passer quelque temps pour les affaires de ma charge des Dragons (1). Je n'en seray pas moins occupé des vôtres. Ma belle amie, l'année se passera peut être sans que nous nous voyons et lespace est bien long pour quelqu'un qui vous aime autant que je fais. Que votre bonheur résulte de cette absence. Je le pardonneray à votre destinée. Bonjour, adieu, ma très chère Emilie.
_________________
(1): Gentil-Bernard, on le sait, est secrétaire-général des Dragons de France.
*
Emilie retrouve en Espagne le marquis de Crillon
A Choisy le 31° aoust (1766).
J'envoyé cette lettre à Paris pour qu'on la fasse passer à Madrid à ma chère Emilie dont jay reçu les dernières nouvelles dattées du 14 décembre. Je suis bien aise de voir que l'étrange scène de sa mégère de femme de chambre nait point eu de suite pour la santé de sa maîtresse. Je vois, ma belle amie, ce qui cause encor les retards de votre jugement, toujours la lenteur espagnole ; je sens combien elle afflige l'impatience françoise. Je vous ay fait mon compliment sur la munificence eclaisiastique quelque modique qu'elle soit ; ses agents sont plus magnifiques qu'elle. (1) Je ne suis pas à portée de voir Antonia en ce moment, je m'informeray de ce que vous désirés savoir, je crois luy avoir donné quatre loüis depuis votre départ. Quand jiray à Paris, je verray à faire l'emplette de coton blanc que je navois pu deviner dans votre autre lettre. J'ay moins de regret à ne point habitter Paris dans votre absence, mais jy serai plutôt rendu que vous. Je m'amuse toujours de l'embellissement de ma retraitte et je mène une vie très tranquille. Le Roy est venu faire une course légère à Choisy, Bellevüe, La Meute, St Oüen, Chantilli. Il sera huit jours absent de Compiégne. Les camps sont finis et il ne se passe rien de nouveau. Vos amis de Suède ne vous aimeront pas comme ceux de Paris. Je vous recommande à ceux que vous venés de vous faire en Espagne, et je prie Messieurs vos avocats surtout de vous rouvrir les portes de notre Royaume.
Renouvellés à Mr. le Marquis de Crillon les assurances de mon ancien attachements pour Luy, qu'il conserve le plus longtemps qu'il pourra cette gaité précieuse qui faisoit le charme de son caractère et de ses sociétés, elle est bien aussi votre partage si le sort qui vous a persécuté jusqu'içy veut vous la rendre et vous rendre aux amis qui vous appellent.
_____________
(1): Il s'agit évidemment de la rente sur le Clergé.
*
Ainsi donc Emilie a retrouvé en Espagne le marquis de Crillon chez qui au début des années 1750 elle a passé une partie de sa jeunesse quand elle était la pupille de M. de Flobert. Voici ce qui s'est passé : le marquis de Crillon était parti, commandé par le Prince de Soubise, pour la Guerre de Sept Ans. Il s'y était distingué, comme à l'ordinaire. "Il surprit Lippstadt, arrêta à Weissenfels l'armée de Frédéric II le 31 Octobre, fut blessé à Rossbach le 3 Novembre. Lieutenant-général le 1er Mai 1758, toujours sous Soubise, il commanda l'aile gauche de l'armée à la bataille de Lutzelberg le 10 Octobre 1758, poursuivit l'ennemi en déroute, prit 18 canons à Spangenberg, puis la ville de Gottingen. Nommé le 1er Mai 1759 commandant en Picardie, Artois et Boulonnais, il fut chargé de préparer une descente en Angleterre. Homme d'imagination, il présenta un projet avec cannonières, qui ne fut pas accepté. On parla alors de donner son commandement au Prince de Beauvau ; Crillon protesta, et comme il avait déjà éprouvé quelques autres dégoût et qu'il estimait ses services mal récompensés, il demanda, en 1762, à passer au service de l'Espasne, unie à la France par le Pacte de Famille. Il rejoisnit l'armée espagnole au siège d'Almeida au Portugal et demeura à la Cour d'Espasne." (Biographie Française).
Encore un qui aurait pu dire : "Ingrate patrie, tu n'auras pas mes os." En Effet Crillon fit en Espagne une carrière bien plus remarquable qu'en France. "Il revint pourtant en mai 1768 à Versailles où il reçut grand accueil mais aucune faveur. "
*
Emilie devient légitimement Madame de Portocarrero
A Madame de Saurin à Madrid.
A Paris le 22 (septembre 1766).
Je reçois, belle et chère amie, trois de vos lettres en fort peu de temps, c'est pour moy une gradation de plaisirs parce qu'elles établissent l'espérence de la fin de vos affaires et de votre prochain retour. Au nombre de ces lettres m'a été rendu le petit paquet dont vous aviés chargé un voyageur qui est arrivé après deux mois de voyage, je n’étois point à Paris lorsquil a passé chés moy. Je vais porter moy même le dépost chés le dentiste pour vous envoyer ce que vous désirés si vous avés le temps de le recevoir et pour le trouver tout prêt à votre arrivée.
Jay receu votre lettre pour M. horutence, jay envoyé chés M. Janselme comme vous me l'avés recommandé, jay su que votre ami est toujours malade. Mr. Janselme devoit partir le surlendemain pour aller à Roïien et je luy ay fait remettre votre lettre qui par cette voye arrivera en sûreté ; je désire de tout mon coeur que la négociation qui y est traitée ait un succès heureux et que votre ami vous donne la consolation de le revoir.
Ouy Madame de Portocarrero je vous appelleray de ce nom là avec plus de plaisir, que si je m'entendois donner le nom d'Altesse. Votre dernière lettre du 8 m'enchante et vous estes bien aimable de m'avoir écrit ce mot, il marque lopinion que vous avés du vif interest que je prends a vous et vous ne vous trompés pas. Je vois enfin que vous ne tarderés pas à savoir votre sort et il se laisse entrevoir sous un aspect agréable. L'Espagne a raison de bien traiter tous les êtres de quelque côté quils viennent, un Dieu, un père une nature doivent vouloir quits vivent et quits soient heureux.
Vos lettres et vos paquets ne m'incommodent point, ils arrivent à mon ami d'Harboulin qui me les fait passer sur le champ et qui le fait avec plaisir. Je nay pas vu depuis quelques jours Antonia mais jay envoyé chés elle, le toutou se porte mieux quoy quil ne soit pas entièrement guéri, ses coliques s'éloignent et il n'est pas changé. Je vous félicite de la bonne santé du fils, et des soins constants de La Jeunesse, que Dieu bénira et dont vos amis se souviendront. Je vais faire un voyage de cinq ou six jours, mais on me fera passer soigneusement vos lettres, adieu belle Emilie, je brûle d'envie de vous revoir et de vous embrasser.
*
A Paris le 6 8bre 1766.
Voilà ma chère Emilie, deux lettres qu'Antonia m'apporte pour vous les envoyer, elle m'assure qu'elle vous écrit tous les huit jours, jen fais de même le plus quil m'est possible et votre empressement à recevoir de mes nouvelles est trop honnête et trop flatteur pour que je n'y réponde pas ; vous devés être tranquilisée sur le sort du père à fils fils, on vous mande qu'il ne s'est jamais mieux porté, et je le certifie, soyés tranquille à son égard et comptés sur touttes ses fureurs. A propos de nouvelles de chien, le Marquis m'a écrit ces jours cy pour le sien qu'on refusoit de luy rendre. J'ay fait venir le garde qui m'a avoué avoir tué le chien de chasse sans le vouloir, je lay forcé d'en donner un autre tout dréssé à M. de la Pailleterie, c'est tout ce que j'ay pu faire. Je vois par vos deux lettres du 15 et du 22 de l'autre mois quon s'occuppe toujours de vos affaires et quelles tendent à leur fin. Que Dieu l'y amène incessamment, j'ay peur des glaces. Nous venons déprouver la chaleur et le beau temps dont nous n'avons pas joui cet été. Les voyages du Roy à Choisy sont commencés et Sa Majesté y va touttes les semaines ; je suis contrarié dans mes travaux, les ouviers me manquent, et je ne seray pas établi cette année comme j'y avois compté, je prends patience ; c'est ma faute, j'ay voulu trop entreprendre, mais enfin je jouiray et la chère Emilie partagera quelquefois ma retraitte ; je souhaite bien ardemment la revoir dans la sienne entre les deux petites bêtes noires ; jay fait faire ce que jay pu pour faire prononcer à Antonia le nom que vous prendrés ce là n'est pas possible, elle ne dira jamais Portocarrero. Pour moy je le prononceray avec autant de plaisir que de facilité, et il me donnera du goût pour l'Espagne. Je veux seulement qu'on l'accompagne de ce qu'il faut pour le porter avec la décence quil mérite ; vous y ajouterés bien tout le reste. On dit que le petit prince de Nassau a été tué à son régiment s'étant battu avec son lieutenant-colonel (1). M. de Lauraguais (2) en sortant de la Bastille a été conduit au château de Dijon. On assure que Mr. le duc d'Eguillon (3) est rappellé de Bretagne, on ne trouve que ce moyen pour finir toutes les discussions qui désolent cette province. On envoyé à sa place un esprit pacifique, Mr. Duchâtelet. L'affaire de Mr de La Chalotais est surcise et le Roy veut qu'elles soit examinée dans son conseil et sous ses yeux. On enterre aujourdhuy avec beaucoup de pompe Me. la Comtesse de Toulouse (4). On marie avec beaucoup de magnificence Melle de Monconseil (5) avec le frère du Prince de Chimay. c'est pour aller à cette nopce que je suis obligé de quitter ma chère Emilie que j'embrasse de touttes mes forces et que j'aime de toutte mon âme.
_______________
(1) : La nouvelle de la mort en duel du petit prince de Nassau est fausse. Le prince de Nassau-Siegen, célèbre par ses aventures, est un officier de Dragons qui s'illustrera presque toujours sur mer. C'est probablement à la suite de ce duel qu'il s'embarqua, en novembre 1766, à bord de la Boudeuse, dans l'expédition que Bougainville menait à Tahiti, la "Nouvelle-Cythère". Le prince de Nassau a écrit de son voyage une intéressante relation. Sa vie fut un vrai roman.
(2) : Le comte de Lauragais (1733-1824) est bien connu des familiers du siècle de Louis XV. Ce grand seigneur touche-à-tout réforma le théâtre : c'est à lui qu'on doit la précision dans le costume historique et la suppression des banquettes sur la scène. Il travailla avec Lavoisier et fit partie de l'Académie des Sciences, a écrit des pièces qu'on ne joua pas. Surtout connu pour ses bons mots, Lauragais trouva moyen de mourir à 91 ans, probablement un des derniers d'une génération bouleversée.
(3) : Le duc d'Aiguillon: "homme d'esprit, mais dur et despote" (Saint Priest). "Il s'était fait haïr en Bretagne, où il commanda longtemps." S'est heurté au procureur général du Parlement de Rennes, La Chalotais. Ancien amant de Madame de Chateauroux, qui lui a préféré Louis XV.
(4): La comtesse de Toulouse : Sophie de Noailles, veuve du duc d'Antin, (seul fils de M. et de Mme de Montespan et courtisan incroyable de Louis XIV) avait épousé en secondes noces le comte de Toulouse, dernier fils de Louis XIV et de Mme de Montespan. C'est une des plus anciennes amies de Louis XV.
(5): Adélaïde-Félicité-Henriette Guinot de Monconseil épouse à 16 ans Charles-Alexandre-Marc-Marcellin d'Alsace, prince d'Hénin, 17 ans. Ce mariage fastueux ne donna pas d'enfant, et le prince d'Hénin fut guillotiné en 1794, à 46 ans. Sa femme est la princesse d'Hénin, dont il est beaucoup question dans le "Journal d'une femme de 50 ans" de la marquise de la Tour du Pin, dont elle est la tante par alliance.
*
A Paris le 10 8bre (1766)
Je n'ay pas receu de nouvelles d'Emilie Carrero depuis ses lettres du 12 et du 20 du mois passé. J'ay été absent toutte cette semaine. Le Roy a fait son dernier voyage à Choisy, j'en reviens et je seray plus sédentaire à Paris. Mr Portier m'a répondu par un billet qu'il feroit ce que vous désirés et qu'il exorteroit encor cet honnete consul a vous donner conseil et secours. Le cte d'Egmont n'est point encor à Paris, je ne say quand je pourray le joindre. Voicy une lettre de Mad. la Ctesse (1) de Lismore quelle madresse avec un billet pour vous la faire passer. Voilà le bulletin d'Antonia, elle et Moretto se portent bien et désirent la même santé au fils de Moretto. Je fais des voeux pour celle d'Emilie et pour son entière satisfaction, je n'en forme plus pour son retour avant lhiver ; parce que lhiver est arrivé et que je ne luy conseille point du tout de se mettre en chemin aux mêmes risques quelle a courus l'année dernière. Ma chère amie il faut attendre le printemps, vos affaires lexigent peut être, votre santé et votre vie le demandent avec plus de force. Oubliés nous pendant ce temps là, ou souvenés vous en sans peine. Nous vous garderons nos coeurs, conservés nous votre personne. Jay diné hier chés le Cte de Creutz, vous devés croire que vous avés eu part à cette réunion et quil a été mention de vous, il nest pas davis non plus que moy que vous passiés la barrière des néges ; il m'a dit ce que vous m'avés déjà mandé sur l'état de vos affaires, et il paroit s'y intéresser beaucoup. Je le verray plus souvent et l'interest et l'amitié nous ramèneront souvent à vous. Mandés moy donc quel est le projet de votre hiver et les moyens que votre bon esprit vous en fera prendre pour adoucir la rigueur. A trois cent lieues de vous nous n'y pourrons contribuer que par nos voeux et nos prières. Devenés dévotte si vous pouvés, mais point d'excès je vous conjure, et ne laissés pas prendre plus d'empire aux curés d'Espagne qu'à celuy de St Sulpice. Vous voyés que je fais ce que je peux pour m'étourdir sur votre absence, j'ay beau plaisanter, je ne seray pas moins affligé d'une aussi longue privation. Si vous pensés de même, vous en adoucirés la rigueur. Bonjour je suis préssé d'envoyer ce paquet au bureau qui doit l'expédier.
_________________
(1) : Elisabeth O'Brien, comtesse de Lismore, dame du Palais de la Reine d'Espagne en 1743, séparée de son mari. Maîtresse de Saint-Albin, bâtard du Régent et archevêque de Cambrai, puis du Prince Constantin de Rohan. Mère de lord Tallow, un débauché (voir les "Mémoires" de Casanova).
*
Emilie se désespère
A Paris le 13 8bre (1766)
Je reçois ma chère amie au moment que j'allois vous écrire votre lettre du 28 7bre elle me prouve mieux votre amitié que tout ce que vous ferés faire [?] votre coeur y dépose avec la confience que je mérite touttes les amertumes quil ressent, il est des moments où elles s'accumulent au point que je les vois. L'âme s'affaisse et le courage se lasse mais je connais le fond de votre âme et l'étendue de vos ressources ; tout ce que je crains, c'est qu'un ébranlement si fort n'affecte votre santé ; enfin belle amie il faut venir à bout de votre grande entreprise ; elle est mêlée de petits incidens fâcheux qu'il faut supporter. Je conçois le désagrément de votre intérieur, auquel vous nestes point accoutumée, il est désolant parce qu'il est journalier, La Jeunesse tiendra bon, il doit voir le terme et tout l'interest que tous vos amis prendront à luy. Un mot de votre lettre
Lettre m’a fait frissonner "si je suis obligée de passer encor icy lhyver". Eh vraiment c'est ce que je crains. Je l'aimerois mieux encor que de vous voir partir à la fin de décembre. Votre santé surtout. Je gémirois sur le sort de cet hyver passé dans un lieu qui vous déplaît, mais je serois au moins sans crainte pour votre vie, il est certain que si dicy à un mois je ne vous vois pas en route ; je n'ay despoir qu'au printemps. Voilà bien un autre sujet de courage pour vous et pour vos amis. Si vous n'avés et s'il n'existe aucun titre de votre mariage je conçois qu'il est impossible que vous songiés à porter ce nom (1). Eh bien vous aurés celuy qu'on vous décerne, il suffira bien pour vous donner un état honnete mais de quels moyens seratil accompagné, voilà ce qui m'inquiète encore ; ce qui doit vous occuper surtout est le degré de solidité qu'on donnera à l'arrengement qui sera fait pour votre payement en France. Les pistoles d'Espagne vont lentement comme les espagnols. Je vois que Lascaris s'v prend mal pour vous plaire, qu'il s'intéresse à votre sort il le doit et c'est bienfait, mais il se fait voir trop intéréssé au sien (2). Je m'en rapporte à votre bon esprit pour le ménager autant quil sera convenable ; je m'en rapporteray ensuite à votre inclination et à votre coeur pour chercher votre bonheur où vous croirés pouvoir le trouver plus sûrement. Par les connaissances que jay acquises sur vous, je ne vous conseillerais l'hymen qu'avec une passion. Ses chaînes pourraient encor vous plaire si elles vous faisoient trouver de quoy satisfaire à des sentimens d'élévation et de fortune qui pourraient satisfaire votre ambition. Sans celà, la rettraite l'amitié et le repos. Ce dernier parti conviendroit mieux à ceux qui l'ont toujours choisy de préférence mais ils sacrifieront toujours tout pour ce qui vous plaira le mieux. Ce qui m'a prouvé le plus combien vous étiés affectée quand vous m'avés écrit cette lettre, c'est le silence cruel que vous avés gardé sur fils fils et sur toto, voyés quel simptome de douleur et quel égarement. Que l'espagnol se porte aussi bien que le français et vous serés fort contente sur l'article des chiens. Occupés vous des caresses de celuy que vous possédés, dittes luy quelque chose pour moy. Ne dittes rien à vos vilaines femmes. Je ne say pourquoy nos lettres vous arrivent si irrégulièrement ; les vôtres sont très exactes et l'ami d'Harboulin nous sert fort bien. Employés le toujours de même, fasse Dieu pourtant quil ne prenne pas encor ce soin là longtemps. Adieu ma chère amie, mon intéressante Emilie, il est écrit dans votre destinée que le bonheur vous coûtera mais que vous aurés le bonheur. J'ay donné 2 louis à Antonia.
_______________
(1) Emilie ne veut plus s'appeler Madame de Saurin.
(2) : Le comte de Lascaris n'aurait-il pas perdu tout espoir d'épouser Emilie?
*
A Madame de Saurin à Madrid
A Paris le 19 8bre
Je ne puis vous dire qu'un mot en passant par Paris ; je le remets à votre poste où j'apprends que tout va bien. Je nay point eu de vos nouvelles depuis la dernière lettre que je vous ay écritte, mon âme est toujours en peine jusqu'à ce que je voye votre sort et votre retour décidés, et votre personne en deçà des Pyrénées. J'ay fait passer à M. de Saint Germain par Antonia une petite provision de cotton blanc fin pour broder, je souhaite qu'il réussisse votre dessein. J'avais oublié cette commission, je répare ma faute. Je le répété je ne puis vous dire qu'un mot : j'aime bien ma chère Emilie.
A Choisy le 20° 8bre 1766.
Vos lettres, Belle Emilie, du deux et du cinq de ce mois me sont parvenues. La première contenoit une lettre de change de 200 L. dont vous me marqués la destination; je lay remplie, Antonia doit en toucher le contenu ; elle compte bien ménager cet argent. Je l'ay vue en passant par Paris. Le père de celuy qui est se porte bien ; et il a, je crois, grande impatience de vous voir dans sa demeure. Votre seconde lettre est remplie d'une amitié tendre, et d'une confience soutenue que je mérite par la constance de mes voeux et le redoublement d'interest qui m'attache à votre situation présente ; j'entrevois que c'est par la connoissance que vous en avés, que vous éloignés la confidence quil faudra me faire de votre séjour en Espagne cet hiver ; votre embarras fait mon éloge et le votre, vous reculés la peine que vous aurés à me l'apprendre et celle que vous aurés à me le dire. Eh ! bien je m'y suis préparé c'est moi qui vous chercheray des consolations et qui vous armeray de courage. Voilà l'entrée de l'hiver, et je redoute Agreda malgré sa sainte (1) ; votre besogne est la plus importante de votre vie, il ne faut pas la laisser imparfaitte ; je vois tout l'ennuy qui vous attend et le malaise que comporte l'usage de mauvais serviteurs et le manque de beaucoup de choses ; des personnes qui vous sont nécessaires peuvent désirer que vous restiés, enfin dautres raisons que je puis ne pas connoitre peuvent et doivent vous faire prendre votre parti. Si vous ne sortés pas de Madrid dans quinze jours, Paris ne vous reverra pas avant le mois de may, voilà le calcul de ma patience. Vous m'avés fait plaisir de me mander tous les détails de votre intérieur, quelques désagréments qui y soient attachés. Je bénis toujours le bon esprit qui vous a fait faire choix de La Jeunesse ; avec luy je voudrois que vous eussiés Antonia et Toto, je vous plaindrais moins. J'ay remis à cellecy un assés gros paquet d'écheveaux de coton le plus fin que j'ay trouvé, elle a chargé M. de St Germain de vous le faire passer sil peut. Quant à l'objet de Fayol je vous ay mandé que je l’en avois rendu dépositaire en le priant de profiter du modèle. Je descendrai chés luy dés que j'iray à Paris, mais le monsieur Barère je ne scay où le prendre. Je n'ay point son adresse, il faudroit me la mander. Mettés moy à portée den faire usage. Jhabitteray continuellement ce séjour jusqu'au milieu du mois prochain que je quitteray mon travail champêtre. Les contrariétés que j'ay éprouvées des entreprises ausi peut être un peu folles sont cause que mon domicile n'est pas en état comme je l’esperois ; je n'en pourray joüir à mon aise qu'au printemps. Pourray je vous le faire voir ! Je n'accompagneray cette lettre d'aucune nouvelle. Cette Cour n'en fournit point et j'ignore ce quon dit à la ville. Mes absences m'empêchent de voir aucun de vos amis. J'ay reçeu encor deux lettres du Marquis. Le garde à quy je luy avois fait remettre son chien, soit vray ou faux dit avoir tué par mégarde à la chasse, ce chien quil disoit assés mauvais. Le Marquis soutient quil étoit excellent et Derau le garde en a rendu un fort mauvais. Le Marquis se plaint à moy je ne say qu'y faire. Je crains detre envelopé dans la disgrâce du garde. Ne luy remettes jamais celuy qui vous est cher.
______________
(1) : Gentil-Bernard fait allusion à Marie d'Agreda, visionnaire et mystique (1602-1665) qui écrivit la "Mystique Cité de Dieu" ou "Histoire Divine de la Très Sainte Vierge Marie” ( 1696) ouvrage condamné à Rome.
*
A Paris le 26
Jay receu belle Emilie assés longtemps après leur datte les lettres du 25 et du 26 dont
dont vous mavés honoré ; elles laissent encore de l'indécision sur le moment de votre départ ; comme vos affaires trouvent de l'obstacle par l'éloignement des personnes dont vous avés besoin, je livre encor cette lettre au hazard de ce qui pourra arriver. Et je vous manderay simplement comme vous le désirés que vos toutous se porte bien, et que le fils est le plus beau du monde en désabillé. Mme Dalmés vous attend comme le Messie, elle gronde quand elle n'a pas de vos nouvelles, elle sapaise quand je luy en fais savoir et elle vous aime bien, vous trouverés d'ailleurs tout en ordre et vous me trouverez toujours, Emilie, le plus zélé de vos serviteurs et le plus tendre de vos amis. M. Yvel n'étant point à Paris je n'ay pu m'acquitte de votre commission.
*
M. de Nerel à Madame de Portocarrero
Montjoli ce 29 Octobre 1766.
Madame,
Qu'il y a longtemps que vous ne m'avez honoré de vos chères nouvelles ! Si je ne connaissais votre façon de penser, je croirais que vous oubliez facilement les gens, mais je vous rends trop de justice, et je suis persuadé que je ne dois attribuer votre silence qu'à la trop grande quantité d'affaires dont vous êtes accablée.
Je vous ai marqué, Madame, par une de mes dernières, que j'avais chargé un ami d'un paguara rempli de quelques petits morceaux d'histoire naturelle adréssés à M. Bernard. J'ai appris avec douleur que cet ami, nommé M. Careau, était mort le 9° jour de sa traversée, et comme M. Bernard ne m'en a point accusé la réception je crains qu'il ne lui ait point été envoyé. M. Lafïte, ami de Careau s'était chargé de mes lettres, tant pour M. Bernard que pour M. de La Pailletterie. Je présume qu’il se sera chargé, à la mort de son ami, des effets qu’il pouvait avoir. Il y avait sur le paguara deux adresses de M. Bernard, et une carte sur laquelle était écrit Histoire Naturelle. Je serais bien fâché que cette petite misère se trouvât perdue ou égarée, parce que si ces sortes d'effets souffrent un trop long retard, ils se gâtent. Je recommandais aussi M. Lafite à M. Horntner. Si au cas celà n'était point encore parvenu à M. Bernard, je vous serais bien obligé de charger quelqu'un, de la part de M. Bernard, de les retirer à Bordeaux. Le paguara dont était chargé M. Careau mort dans la traversée de Cayenne à Bordeaux en France, se doit trouver dans les effets du mort sur "La Francine", petit senau appartenant à M. de La Borde, négociant à Cayenne, chargé pour le compte de M. Lafite et Madame Le Compte. Je vous donne ces renseignements afin de tacher de le retrouver s'il est égaré, et ne voulant pas passer pour un gascon. Ces drôleries là font plus de peine quand elles se perdent que quelque chose de bon, et on ne se fait pas un cas de conscience de les voler. C'est assez, je crois, Madame, vous ennuyer pour une vétille.
Je ne vous demanderai pas, Madame, de me donner des nouvelles que l’on appelle nouvelles içi un an après les évènements, mais des vôtres qui m'intéresseront toujours beaucoup, de vos affaires et de celles de vos amis qui voudront bien m'honorer de leur souvenir.
J'ai vu avec grand plaisir dans les gazettes l'avancement de Monsieur le baron de Frienndorff, nommé ministre plénipotentiaire de la Cour de Suède en Espagne. (1)
Je vous souhaite une très bonne santé, bonne réussite dans vos affaires. Je suis maintenant le gardien de l'habitation de M. le baron de Bennes jusqu'à son retour, il y a cinq semaines qu'il est parti.
J'ai l'honneur d'être, Madame, avec les sentiments les plus respectueux
Votre très humble et très obéissant serviteur
Nerel
Oserais je vous prier d'assurer M. Bernard de mon respect. M. Lafite était chargé de deux cannes de bois de couleurs, une pour M. le marquis, et l'autre pour M. Bernard.
_______________
(1): Le baron de Friezendorff, chargé des Affaires de la Cour de Suède, habite en 1765 l'Hôtel de l'Ambassadeur de Suède.
*
Emilie est en Espagne depuis un an
A Paris le 8 Xbre (1766)
Je n'ay que le temp de glisser un mot dans le paquet qu'Antonia va faire passer au Bureau de vos dépêches, elle vous réponds sur l'article de La Jeunesse auquel je ne crois pas que vous soyés beaucoup redevable, il s'est mal comporté et je ne crois pas que ce sujet soit bien convenable à votre service. Il y a du dérangement dans notre correspondance, je me plains comme vous que nos lettres n'arrivent point à temps, je ne say si nos facteurs se lassent. Comme nous en avons besoin il faut les ménager. Voilà prés de 15 jours que je n'ay point reçeu de vos nouvelles ; voilà plus d'un an que je ne vous ay ouï, tout celà est bien long et peut l'être encor. J'espére que votre première lettre me mettra au fait de ce que vous désirés, sur plusieurs choses que je vous ay demandées. J'exécuteray vos ordres comme vous savés bien avec autant d'affection que de zéle. Dittes moy où vous en estes présentement. Je vous vois un état, et je ne vois pas une fortune compétente à ce que le ciel vous a fait naître et encor moins à ce que vous mérités. Ce que je say c'est que vous tirerés le meilleur marché possible de votre situation. Quelle quelle soit elle intéressera également vos amis qui vous sont bien dévoués. Je leur donnerais l'exemple s'ils en avoient besoin. Bonjour ma chère Emilie je suis fâché de vous quitter si tôt, jespére avoir demain ou après demain de vos nouvelles.
Au dos de la lettre, cette chanson, d'une autre main que celle de Gentil-Bernard:
Ma flame toujours pure
Est le fidel tableau
De la simple nature
Est il rien de plus beau
L'Amour remet ses armes
Son carquois son bandeau
Au pouvoir de tes charmes
Qui valient son flambeau
Un mot seul un sourire
Mélèvent jusquaux cieux
Plus grand sous ton empire
Quau rang meme des dieux
Pour toi charmante Flore
Mil soupirs amoureux
Te prouvent dés loraure
Mon amour et mes feux
Dans nos champs que de gloire
Malgré tous mes riveaux
Une douce victoire
Est le fruit de mes meaux
Dans lombre et le silence
Je jouis prés de toi
Du prix de la constance
Dun berger tel que moi.
*
A Paris le 15 Xbre 1766.
Je vois Belle Emilie par votre lettre du 24 9bre que vous avés été indisposée d'un accès de colique et dun rhumatisme jespére que vous avés été quitte de ces vilains maux, je vois la continuation des soins de La Jeunesse pour vous et l'attention quil a de vous garentir des risques de la saison ; vous estes bien heureuse davoir un serviteur si attaché et si utile, Dieu le bénira, et vos amis le serviront. Je sens bien combien Antonia vous seroit nécessaire pour rendre votre séjour plus supportable. Elle s'ennuye beaucoup de votre absence, elle ne quitte pas votre appartement et la garde de votre chien qui passe sa vie à merveille, je souhaite à son fils une santé aussi parfaitte. Jay vu quelque fois le Comte de Creuts et nous avons toujours parlé de vous. Il a les mêmes doutes que moy sur le temps de votre retour, il connoit les lenteurs espagnoles et les chicanes de l'interest, peutêtre n'estes vous pas si prête à revenir, malgré le désir que vous en avés ; vous avés trop sacrifié pour ne pas vous livrer encore aux sacrifices nécessaires. Il en est tel que j'aurois cependant peine à vous pardonner, parce que je ne me ferois point à lidée de ne plus vous revoir ; au point où vous estes vous devés entrevoir votre sort et avoir pris déjà votre parti sur létat de la fortune qui vous attend. Quoy quil se trouve peutêtre borné vous pouvés être heureuse en vous formant un plan de vie convenable, et le suivant avec fermeté, soit dans le pays où vous estes ou dans celuy qui vous désire. Il ne se passe aucune nouvelle digne de vous être mandée, notre Dauphine est toujours assés mal et elle aura de la peine à échapper au sort de son mari ; il se fait beaucoup de mariages qui ne vous importent guère, on donne des spectacles nouveaux que vous ne vérrés point, je crois que ceux de Madrid ne vous amusent pas beaucoup. Antonia m'a dit que le maître du lieu quelle habitte la presse un peu pour son payement. J'ay répondu que si je n'avois point de vos nouvelles à ce sujet je payerois un quartier au premier de janvier et que je répondrois des autres, ainsi il sera tranquille, voilà belle amie tout ce que je puis vous mander pour le présent, jy ajoute les protestations de la tendre amitié que je vous ay voüée.
J'ay dit à Antonia tout ce que vous m'avés mandé d'obligeant pour elle, elle y a été très sensible, si elle pouvoit faire le saut des Pirénées, elle le feroit volontiers pour vous donner les soins dont vous avés besoin.
*
Emilie fait des ravages
A Paris le 27 décembre 1766.
J'ai reçu, belle amie, vos lettres... d'une année que j'ai passé sans vous voir. Ces lettres sont remplies de vos attentions et des marques d'une amitié tendre ; je la mérite par l'attachement que je vous ai voué, et le changement d'année, de lieu, de climat n'auront aucune influence sur sa durée. J'ai lieu d'être plus inquiet de votre santé que vous ne devez l'être sur la mienne ; il est vrai que j'ai éprouvé quelque dérangement il y a prés de deux mois : j'avais amassé de la bile je ne sais comment, j'ai fait quelques remèdes de bonne femme, et le bonhomme est guéri ; puisse votre colique et votre rhumatisme n'avoir pas eu plus de suite ; j'exhorte toujours votre bon et fidèle serviteur à vous rendre les bons offices dont vous vous louez, pour qu 'il vous ramène en sûreté, santé et prospérité. J'ai dit à Antonia ce que vous m'avez chargé de lui témoigner ; je ne doute pas qu'elle ne se prête à la bonne oeuvre que vous imaginez si l'on s'y prête ; mais je ne sais si on l'acceptera ; j'attendrai pour lui en parler qu'on en marque le désir et je garderai votre lettre comme vous me mandez de le faire.
J'ai fait passer à Sibuet celles que vous m'avez adréssées pour M. Horrutence, à qui je souhaite de longs jours. Je n'ai pas revu ni entendu parler de M. de la Pailletterie ; ce que M. Yvel a fait peut remplacer cet office, que l'autre n'a pas voulu ou peut-être pu vous rendre ; il n'avait pas paru manquer de bonne volonté mais d'assurance.
J'ai passé deux fois chez M. Giamboni que je n'ai pu voir parce qu'il était malade ; ils s'entendent très bien, lui et M. Yvel pour vos intérêts et vous pouvez compter sur eux. Je ferai usage de l'article ostensible de votre lettre qui regarde M. Giamboni pour vous procurer les deux articles qui valent une petite fortune ; vous croyez bien d'ailleurs que je suis peu étonné de ce que vous me dites avec beaucoup de modestie des ravages secrets que vous faites sur des âmes sensibles. Je me suis toujours attendu qu'ayant pâti des flammes dans les pays du Nord, après avoir soumis anglais, russes, suédois, le chaud climat de l'Hespérie vous donnerait encore de plus vives marques de sensibilité, et égalerait bien au moins vos conquêtes d'Italie. Je suis fâché qu'il en résulte des inconvénients, je vous connais assez d'expérience et de ménagement pour ramener sans vous compromettre le degré de chaleur nécessaire à la conformation de vos œuvres ; c'est le cas de se permettre l'air qui peut séduire sans tromper. La nécessité du sort et la faiblesse des hommes font [?] cette maxime, qui produit le bien et ne fait pas grand mal.
M. de Saint Priest a reçu votre lettre et sollicitera votre demande, il compte obtenir la recommandation que vous désirez, mais le prince est depuis trois mois à la campagne ; il revient les premier jours de janvier, on le fera agir le plus tôt qu'on pourra et le marquis répondra alors à votre lettre.
... J'ai donné un louis à Antonia pour le faire passer au père de La Jeunesse ; je vous recommande toujours aux soins de ce fidèle serviteur.
Je vous renvoie la lettre de M. de Nerel, dont j'ai pris lecture ; je lui suis son obligé d'avoir songé à moi. Je recevrai pour vous, quand on m'en donnera avis, la pacotille qu'il envoie et qui vous amusera. Je n'ai point de cabinet d'Histoire Naturelle, et mes goûts ne se sont pas portés de ce côté là, vous ordonnerez donc de cet envoi. Je suis fâché que les affaires des voyageurs ne prennent pas une meilleure tournure dans les pays étrangers et que M. de Besner le laisse dans un cul-de-sac. De retour en France, je ne lui vois d'autre état que celui qu'il avait ; les emplois qui pourraient lui convenir sont plus rares que jamais, et s'il ne tente pas la fortune où il est, il aura de la peine, à Paris, de venir à bout de ce qu'il n'a pu faire encor. C'est dommage qu'il n'ait pu suivre son premier métier, quelque borné qu'il fut, il était honnête. (1)
Je suis bien aise que la boîte aux rubans vous soit arrivée à bon port et que vous en soyez contente, dites moi s'il est vrai qu'il y a encore du mouvement en Espagne et qu'on y craint d'autres révolutions. L'affaire de M. de la Chalotais a été décidée içi par le roi sans aucun jugement ; il le condamne à l'exil seulement et veut que tout celà finisse. Les Parlements crient, on les laisse faire, et la Bretagne va se calmer. J'ai peu de nouvelles d'ailleurs à vous mander. Toutou se porte bien. Mes compliments à Fils Fils, mille amitiés tendres à sa belle maîtresse.
J'ai reçu, ma chère amie, les deux dernières lettres que vous m'avés écrittes du 17 et du 21 du passé. J'ay fait passer sur le champ le paquet de M. l'abbé Colon, j'ay pris rendés vous avec luy et nous nous sommes vus. Il me paroit rempli de la meilleure volonté sans avoir les moyens efficaces, il se connoit mieux en affaire que moy, qui n'y entends rien. Il doit voir un procureur de ses amis pour le consulter sur la possibilité de faire attendre votre hôte. Je ne crois pas quil y en ait. Il doit voir Mr de St Julien ; ce moyen seroit plus certain, si votre absence n'a point éffacé de ses idées les impressions quelles avoient. Labbé doit encore consulter sur l'usage que je puis faire de votre billet, par lequel vous déclarés que vos meubles sont à moy. Nous en sommes là. Je ne puis entrer aujourdhuy dans de plus longs détails on a attendu un peu tard pour cette opération, je souhaite quelle vous satisfasse, je noubliray point ce que vous paroissés désirer le plus. Jay fait voir à Antonia la démolition de mon appartement des bains, je n'ay qu'une chambre où me loger et elle voit bien que je ne puis m'en charger, on cherchera le moyen qui luy conviendra le plus. Ne doutés pas de mon zéle de ma volonté et du désir que j'ay de vous voir sortir de tous vos embarras, j'embrasse ma chère Emilie.
____________________
(1): M. de Nerel, qu'on a vu précédemment gardien de l'habitation du baron de Bennes à Montjoli, a cru pouvoir faire lortune en Guyane, fantasme courant à l'époque. M. de Bessner est une sorte d'aventurier, qui de capitaine d'artillerie au service de la Hollande passa à celui de la France. Il accompagna en Russie le marquis de Caulaincourt et fut envoyé en mission près de l’armée suédoise. De 1764 à 1768 il commanda comme colonel la garnison de Cayenne, selon certains auteurs il chercha à faire de la Guyane "un nouveau Pérou ».
*
Déménagement parisien
A Paris le 26 Janvier 1767.
Belle et chère amie, la dernière lettre que d'Harboulin m'envoie me donne bien de l'inquiétude. C'est La Jeunesse qui m'annonce votre maladie, car je crois que c'en est une, il me promet de ne point me laisser ignorer les suites de votre état. Si ce n'est que la maladie qui régne en ce pays ci, elle n'est pas dangereuse, mais je tremble toujours pour les tnaux et médecins des pays étrangers. Faites le moins de remèdes que vous pourrez, que le calme de la tête soit un de vos premiers remèdes et ménagez vous sur tous les points.
J'ai reçu en même temps que ces nouvelles, les deux quittances que j'ai fait passer à M. de Saint Julien en lui écrivant une belle lettre à votre sujet, pour le louer de ce qu'il fait et de ce qu'il peut faire ; il a vu votre hôte, il a tort ; arrangez avec lui. L'abbé doit vous avoir mandé tout cet arrangement ; vos meubles seront garantis et logés. Je n'ai qu'un grenier à ma disposition, M. de Saint Julien offre une chambre pour les mettre plus en sûreté. Antonia en prendra ce qui lui sera nécessaire pour une chambre particulière. N'ayez point de regret au logement de M. Guéan, il est triste, bruyant, vous n'y auriez point été heureuse, on trouvera mieux que cela ; enfin portez vous bien et comptez sur la France. Je n'ai point ouï parler des deux cent livres dont il est question dans la lettre de La Jeunesse : voyez s'il a été donné quelque ordre pour celà. Vous ne m'en aviez point parlé, je ne sais si vous n'avez pas manqué à la formalité d'envoyer votre certificat de vie pour accompagner vos quittances. M. Calon vous le mandera ; il faut bien vous porter, je reviens à cet article essentiel, tout le reste ira bien içi, faites aller l'Espagne. Les nouvelles du Paraguay nous arrivent, voilà la suite heureuse de cette singulière expédition de M. d'Aranda. L'évènement le plus inoüi, le mieux conduit, le plus étonnant qu'on puisse lire dans l'histoire ; qu'on vous rende donc heureuse, si l'on rend justice à tout le monde. Ce bonheur sera celui d'un ami qui vous dit et vous dira toujours qu'il vous aime tendrement.
Antonia se porte bien et son camarade aussi. Je remercie La Jeunesse, sa lettre m'a fait grand plaisir. Il me promet de m'écrire si vous n'êtes pas en état. Je lui serai très obligé de cette attention et j'en garderai de la reconnaissance.
*
A Madame Portocarrero à Madrid.
A Paris le 1° février (1767)
Je nay point eu de vos nouvelles, ma belle amie, depuis la lettre de La Jeunesse qui m'apprenoit votre maladie ; vous jugés de l'inquiétude où elle m'a jettée, il me promet de m'écrire, et jauray peut être demain quelque lettre de luy. Quand vous pourrés nous rassurer vous même, vous jugés du plaisir que vos nouvelles nous feront. On a suivi vos intentions au sujet de l'arrangement qu'exigeoit votre locataire M. de St Julien s'est prêté avec zéle a ce que vous luy avés demandé, il a payé luy même M. Guéan pour trois termes qui luy étoient dus, et jay joint ses quittances à celles que j'avois déjà. L'écriteau est à sa maison pour le terme de Pâques ; vos meubles seront retirés chez M. de St Julien parce que je n'aurois qu'un grenier à leur donner où ils seroient plus mal que chés luy. Antonia louera une petite chambre pour elle, et elle se servira de quelques meubles qui luy seront propres. Elle demande qu'il luy soit permis de louer cette chambre dans le quartier de son mari pour être plus à portée de luy. Elle et toutou se portent bien. Je luy ay remis 371.10 sols qui restoient de la somme de 600 que M. de St Julien a remis et sur laquelle les trois quartiers ont été payés. Nous aurons le temps de recevoir les ordres que vous donnerés dicy au terme de Pâques pour ce que vous jugerés convenable que fasse Antonia, je n'ay que le temps de vous mander rapidement ce qu 'on a fait et de vous prier encore de nous donner de bonnes nouvelles d'une santé aussi chère qu'elle est inquiétante. Mille et mille assurances d'attachement à la belle Emilie.
*
A Madame Portocarrero à Madrid.
A Paris le 18 (février 1767)
Voilà, ma chère Emilie, le plus long intervale quil y ait eu dans vos lettres depuis que vous nous avés quittés ; vos affaires demandaient cependant des réponses que vous aviés promises. Ce silence m'inquiette sur votre santé ; au moins La Jeunesse devoit-il écrire pour rassurer les gens qui s'intéressent à vous. On n'a pas été moins occupé de votre déménagement qui s'est fait avec ordre et économie. Antonia a pris de quoy meubler sa chambre, vos autres meubles sont en dépost chés M. de St Julien et fort bien placés. Jay le grand et petit secrétaire, une petite table et quelques paquets, tout celà est numéroté par état. On m'a remis encore une certaine quantité de bouteilles dont il n'y a qu'une cinquantaine qui soient pleines et je ne say si le vin en est bien conservé, jay aussi quelques bouteilles de liqueur que jay mises en sûreté pour vous attendre ; vous attendront elles longtemps, cest ce que vous ne scauriés nous dire encore. Je respecte vos secrets, et je sens que des lettres ne comportent pas des explications et des détails qui demandent du temps et de la sûreté. Pourveu qu'en travaillant au repos que vous désirés vous ne souffriés pas trop de peines, l'attente de vos amis sera plus supportable. Vous devés aux soins et aux engagements de M. de St Julien la pacification de votre hôte qui n'aura jamais connu son hôtesse, il aura plus perdu que vous. M. de St Julien attend la quittance que vous déviés lui renvoyer il y a un mois. Je vous conseillerais de lui écrire et de luy faire vos remerciements de cette manière qui vous est propre et qui d'un mot scait payer tous les bienfaits. Antonia est toujours fort inquiette sur l'incertitude de son sort, je la rassure de mon mieux, son mari la tourmente. Son pupile ne songera à vous que quand il vous verra, il ne songe point aux infidélités que vous luy faites peut-être avec la race espagnole et dont fils fils est peut être le complice. Pour moy belle Emilie, je vous crois fidèle et constante à tous les objets de votre attachement, et crois vous rendre justice en répondant de l'honeteté et de la sensibilité de votre âme. Vous connoissés la mienne elle vous prouvera sa constance. Bonjour à ma chère Emilie.
La dernière lettre que je vous ay écritte a voyagé sous envelope de Mr Baden, cellecy passera par la voye ordinaire.
*
A Paris le 22 février 1767
Les deux lettres que j'ay reçues de vous en dernier lieu ma chère Emilie sont du 4 et du 9 de ce mois, elles m'arrivent touttes fidèlement, je fais passer de même à leurs adresses celles que vous écrivés à différentes personnes. Notre ami d'Harboulin ne trouve point mauvais que nous mettions notre amitié sous le couvert de son privilège, il y mettroit encor autre chose avec le meme plaisir et la meme sûreté.
Je crois que M. Giambony n'a pas plus de répugnance à vous faire passer mes lettres et il paroit bien sur de M. Baden qui est fort de ses amis et des vôtres. Je suis extrêmement flatté des marques de souvenir de M. le M.is de Crillon que des époques fort éloignées d'Allemagne et d'Italie rendent encor plus précieux pour moy. Je luy suis toujours fort attaché et je partage avec bien du monde le regret de sa transmigration. Je luy ay toujours connu cette gaîté qui le caractérise et qui est bien prouvée si elle se soutient contre le flegme et le sérieux de la gent espagnole. N'allés pas nous déserter comme il a fait et ramenés le si vous pouvés. Nous sommes toujours menacés d'un deuil prochain par l'état d'extrémité où se trouve Mad. la Dauphine qui nous laisse encor jouir des plaisirs du Carnaval. Il se fait beaucoup de mariages. Je vais être moy même tout au milieu des noces : le Cte de Coigny se marie dans huit jours, il épouse une fille de fortune aimable dont la famille m'est connue depuis longtemps. Ce mariage est fort avantageux pour un cadet peu riche que son état porte à beaucoup de dépense. La future s'appelle Melle de Roissy, petite fille de Mad. de Villette, parente des Montmartel. Cette affaire me donne un peu de tracas, mais me fait beaucoup de plaisir. (1)
Je vous félicite du beau temps que vous avés, nous en jouissons içy et il fait fort beau. En profiterés vous bientôt pour passer vos vilaines montagnes ? Je ne compte sur votre retour que pour cet été. je ne say où se tient votre consul ; je ne l'ay rencontré nulle part. Vous ne finirés vos affaires qu'à son retour. Ne voudra-t-il pas vous retenir encore ? J'en meurs de peur. J'ay fait usage de l'article de votre lettre et j'en ay fait une notte que j'envoye à Mr Yvel en luy marquant votre désir et votre intention ; je ne doute pas qu'il ne la mette à profit. Je vous trouverais bien heureuse, et l'Espagne bien généreuse, si vous pouviés compter sur cette rentrée. En attendant je vois que vous jouissés là bas d'une considération qui doit vous flatter et diminuer l'ennuy de votre séjour. Je feray part à Madame Geoffrin de vos compliments. Je suis toujours fort bien avec elle et le Comte de Creutz aussi, j'aurois bien voulu que votre consul eut été chés elle où vont tous les négotiateurs du monde, j'aurois été à portée de le faire solliciter pour vous. M. Portier pourra beaucoup à celà, je le verray encor à cet effet.
Moretto sera, s'il vous plaît, le premier objet de vos regards quand vous entrerés chés vous et vous le trouverés endormy sur le canapé de votre chambre en y entrant à droitte. Camille qui vous est bien obligée sera charmée de vos regards et vous la verrés à gauche en entrant dans votre salon toujours occupée de déchausser son amant qu'elle abandonnera pour vous recevoir. (2)
Antonia qui est chés moy dans ce moment ne vous écrit point, s'en rapportant à ce que je vous mande. Elle et Moretto se portent bien. Antonia dit que vous l'oubliés ; je l'assure bien que non, et j'entretiens ses espérances. Vous devés compter sur tous ceux qui vous aiment, jugés si vous devés compter sur moy.
________________
(1) : Le comte de Coigny, Gabriel-Augustin de Franquetot, 27 ans, épouse en mars 1767 Anne Josèphe Michel de Roissy. La mariée est beaucoup moins noble, mais beaucoup plus riche que le mari : elle est parente de Paris de Montmartel, un des quatre frères Paris, financiers et amis de la Pompadour. Ce ménage Coigny aura une fille ravissante : Aimée, qui inspirera dans sa prison, sous la Terreur, à André Chénier son poème "La Jeune Captive". Les "Mémoires " qu'elle a laissées semblent apocryphes.
(2) : Il s'agit d'un tableau ou d'une gravure. Camille est, dans "l'Enéide", une chasseresse à la course rapide "qui eût couru sur les épis sans en courber la tige." Dans l'inconscient d'Emilie, la "maîtresse errante" de Gentil-Bernard, il s'agit d'un autoportrait.
*
A Paris le 9 mars 1767.
Les dernières lettres que jay receues de la belle Espagnole sont du 9 et du 23 février. Je me suis acquitté de ses ordres. J'avois écrit à M. Yvel. Je say que M. Partier fera tout ce qui dépendra de luy auprès du Consul ; il faut que ce ministre vive icy d'une manière fort retirée, on n'en entend point parler, il est vray que je fréquente peu le département des ministres. Jay vu les deux Suédois dont vous me parlés, ils vous sont fort dévoüés. Le baron m'a fait l'amitié de me venir voir et il m'a parlé des commissions dont vous l'avés chargé, je le reverray avant son départ, il est installé chés Mad. Geoffrin il m'a trouvé fort occupé de vous et du plaisir de vous revoir ; je crois pour nous que nous n'en jouirons pas sitôt : je ne vous attends plus que pour l'hyver prochain ; encor Dieu sçait ! Je vois qu'en attendant vous n'estes pas heureuse, qu'on vous désole par les lenteurs, que vous nestes point dédommagée des tracas de votre esprit par aucune occupation de coeur qui puisse vous distraire des ennuis d'une longue solitude. Je vous exorte néammoins à tout supporter si vous voyés la sûreté d'une retraitte honnete et suffisante, je crois bien que l'habitude, l'amitié et bien dautres raisons vous la feront choisir en France ; je me mets aussi quelque fois dans la tête que vous vous établirés en espagne. Je vous le pardonnerés si à quelque fortune se joint une passion qui fasse votre bonheur. M. de St Priest vient de me faire passer cette lettre pour Mad. la Duchesse de Lerme, je désire fort quelle puisse produire l'effet que vous en pouvés attendre et concourrir à vos vües, il me charge de vous assurer de ses amitiés respectueuses.
J'ay été quinze jours sans avoir le plaisir de vous écrire. Les embarras les affaires que me cause le mariage du Cte de Coigny en sont cause. Enfin tout sera terminé dans huit jours. Me la Dauphine a été administrée hyer, on n'attend que le moment de sa mort, et nous voilà encor dans la tristesse et le deuil.
Antonia vien de mapporter sa lettre. Elle et Toto se portent bien. Je présente mes respects à Madame Portocarrero et j'embrasse ma chère Emilie.
A Paris le 16 mars (1767)
La dernière lettre que j'ay reçüe de vous ma belle amie est du 2 mars. Je suis bien fâché qu’il y ait du retard dans le passage des nôtres, celà vient de la négligeance des bureaux auxquels nous sommes assujettis. Si j'avois quelque chose de plus préssé à vous dire, je me servirois de la voye que vous m'indiquez ; voilà deux lettres qu'Antonia m'apporte en m'assurant que tout est bien chez vous et que Moretto est en parfaitte santé. Je vous rends grâce de tout ce que j'ay trouvé de tendre et d'obligeant dans votre dernière lettre, mes sentimens pour vous n'ont pas besoin d'être réchauffés; mais voilà bien de quoy les entretenir. N'en ayés donc aucune inquiétude, l'interest ne peut qu'augmenter à mesure des peines et des embarras que vous supporterés. Votre archevêque me désole, c'est ce qu'il y a de plus opiniâtre au monde que les gens d'Eglise ceux du pays que vous habittez le sont plus que partout ailleurs ; vous avés pour vous la loy, la justice et le Roy, celà me rassure. Mais je n'entrevois point encor la fin de vos discutions. Rien n'est plus obligeant cependant que la lettre que vous m'avés adréssé de Monsieur l'ambassadeur, j'en ay pris la lecture, et pour ne point perdre de temps je l'ay envoyée hyer à Mr. Parthier pour luy en donner connaissance et le mettre à portée d'en faire part à son ami ; ce consul paroit fort peu dans le monde ; vos amis le comte et le baron chés qui j'ay diné il y a trois jours, lui parlent souvent de vous. A ce qu'ils m'ont dit, le Baron doit vous avoir écrit pour avoir vos derniers ordres et touttes les instructions qui luy seront nécessaires avant son départ d'içy. Je suis bien persuadé qu'il vous trouvera encor en Espagne, et le Ciel vous condamnant encor à y rester, je vous trouve heureuse d'avoir la ressource de sa société. Le comte de Creutz s'occupe beaucoup de son établissement dans ce pays cy, son hôtel s'embelit tous les jours, et il fait de la dépense. Je suis encor dans le train et l'embaras de notre nopce, elle doit se faire mercredy à Plaisance, après celà je seray un peu moins tracassé, et je m'occuperay encor plus de vous.
On prend demain le deuil pour Madame la Dauphine, et celà pour six grands mois, nous ne pouvons pas sortir des crêpes. Il me paroit que cette Dauphine cy n'est pas autant regréttée que celle que nous avons perdu avant elle et que nous tenions de l'Espagne. Le Roy est avec sa famille à Marly pour douze jours (1). Voilà touttes nos nouvelles. On m'interromps et l'heure presse. J'embrasse mille et mille fois ma chère Emilie.
Je ne say si je vous ay rendu compte du prix de la pluche de soye. Il y en a chés nos marchands de différente sorte et beauté, depuis 12 jusqu'à 18 et 21 livres selon la force et la couleur.
__________________
(1): La Dauphine Marie-Josèphe de Saxe meurt à 36 ans le vendredi 13 mars 1767. La première Dauphine, l'Infante Marie-Thérèse, fille de Philippe V d'Espagne, était morte le 22 juillet 1746 après un an de mariage, en donnant naissance à une fille qui ne lui survécut pas deux ans. "La consternation fut grande et les esprits les plus optimistes demeurèrent frappés comme d'un présage de nouveaux malheurs. " (Régnault). Le Grand Dauphin en fut longtemps inconsolable.
*
Le 23 Mars (1767).
Depuis ma lettre écrite, mon ami d'Harboulin est venu me voir et m'interroger sur un envoi qui lui a été adréssé de Bordeaux. J'ai vu par les détails qu’il me fait qu’il était question de la pacotille de M. Nerel. Effectivement je l'ai reçue telle qu'elle m'a été indiquée par la lettre que j'ai reçue, mais comme tout celà a été mis dans un panier, apporté par la poste, les papillons ont un peu souffert. Malgré celà, j'ai cru devoir à l'auteur de notre correspondance de lui offrir ce qui pourrait lui plaire. Le hasard a fait que votre ami l'abbé de Crillon, fort amateur de ces choses là, s'est trouvé chez d'Harboulin qui m'a conté tout celà, et on a parlé de Madame de Saurin. J'ai pris occasion d'en dire davantage à mon ami qui s'intéresse à vous sans vous connaître, il sera à portée de voir l'abbé Billiardy, plus à portée encore de lui faire parler par le Duc de Duras qui le connait fort. Je verrai demain ce Duc à Choisy, et je le connais assez pour lui dire de solliciter et pour l'engager à vous recommander lui-même. J'ai donné pour celà une note à d'Harboulin et il en fera bon usage. Il m'a dit qu'il donnerait deux papillons à Madame la Présidente d'Alligre pour qu'elle engage surtout le Duc de Duras à solliciter l'abbé. Je crois que je ne puis faire un meilleur usage des curiosités de la Cayenne et que vous y donnerez votre consentement ; j'embrasse encore içi ma chère Emilie et l'assure d'une éternelle amitié.
*
En mars 1767, le ministre Saint-Priest écrit à la duchesse de Lerme pour Emilie. Mais l'archevêque espagnol, inconnu et néanmoins malveillant, conteste ce que le roi Charles III a décidé à propos de notre héroïne : on ne va pas lui lâcher comme ça les picaillons... Le marquis d'Ossun, notre ambassadeur en Espagne, s'entremet lui aussi. C'est lui qui d'après les instructions secrètes de Choiseul, premier ministre, poussa Charles III à chasser les Jésuites d'Espagne. "Faut-il qu'un homme de Dieu, un ministre de paix et de charité, un prélat de l'Eglise vous chicane sur ce que la justice d'un roi équitable vous accorde ?” se désespère Gentil-Bernard. Emilie, moins jeune, aurait pourtant du se méfier : les Espagnols ne lâchaient les douros qu'avec circonspection. Un Montpellierain, Jean Ranc, avait peint Charles III enfant (le tableau est toujours au Prado). En 1737, alors qu'Emilie apprenait à parler, un autre peintre méridionnal, Louis-Michel Van Loo, d'Avignon, vint en Espagne dans le but avoué de remplacer Ranc. "Il resta quinze ans à la cour comme peintre de chambre, prodiguant les louanges et les bassesses pour, à la fin, en sortir payé chichement, en retard, et parfois, pas du tout...” (Antonio J. Onieva : "Nouveau guide complet du Musée du Prado", Madrid, 1974).
*
A Paris le 26 mars 1767.
Jay reçeu ma belle amie deux de vos lettres depuis fort peu de temps, celle du 2 et celle du 8 de ce mois. Je vous écrivis lundy dernier ; vous vous plaignés de ce qu'aucun de vos amis n'a encor vu Mr. votre Consul. Le Cte de Creuts ma dit sêtre entretenu de vos affaires avec luy. Jay écrit et parlé à ce sujet à Mr. Parthier sur lequel vous comptiés particulièrement ; vous verrés par une lettre que jai reçeu de luy quil n'a pas tort, quil s'est occupé de vous, mais quil n'a pu joindre luy même ce ministre si fort occupé à Versailles que personne ne l'a vu à Paris. Ainsi il est difficile que vos amis ayent été en état de luy parler de vous comme ils l'auroient fait. Le Baron et le Comte sont plus à portée de celà allant à Versailles tous les mardis. Vous vérrés par la lettre de Mr Parthier quil compte aller l'y chercher. Jespérois comme vous le dittes quil se seroit présenté chés Mad. Geoffrin le rendés vous des ministres étrangers ; jaurois été à portée de l'y voir et de luy faire parler. Sans doute que la nature des affaires quil a ne luy permet pas de s'écarter de Versailles. On dit quil ne tardera pas à vous rejoindre, je crois que le baron ne nous quittera pas encor sitôt. Je vous renvoyé la lettre de M. le M.is d'Ossun qui marque bien toutte la volonté quil a de protéger votre cause et de concourrir au succès de vos affaires, faut il qu'un homme de dieu, un ministre de paix et de charité, un prélat de l'église vous chicane sur ce que la justice d'un roi équitable vous accorde ?
Je nay reçeu que depuis deux jours, et je ne say par quelle voye une lettre fort détaillée de Mr. Nerel ; comme elle est sans datte je ne puis en fixer l'époque, elle me parait ancienne. Il navoit point encor eu de vos nouvelles, il fait le récit de ses voyages, de ses occupations, de ses projets. Il m'annonce lenvoy dont vous maviés parlé il y a deux ou trois mois et m'envoyé un état de ce quil contient ; il ne me marque point qui s'est chargé de cet envoy ny par quelle route il sera remis. Je n'en ay eu aucun indice. Jay fait dire dans le temps à Mr. labbé de Montboile ce que vous m'aviés mandé à ce sujet ; je vous avois prévenue sur le peu d'usage que je pouvois faire du présent de Mr. Nerel que je remerciray de ses attentions si je trouve le moyen de luy faire parvenir une lettre. Il me paroit [?] à vous dans la résolution de revenir ; je crains qu'il n'en rapporte que des plumes d'oiseaux et des curiosités légères ; je luy souhaiterois une pacotille plus solide. Je ne say si Mr. de Besner est retourné dans les parages. Il auroit du mettre Mr. Nerel en état de mieux faire, parce qu’étant assurés de la paix comme nous le sommes dans ce pays cy, je luy vois peu de ressources pour les emplois militaires qui sont plus rares que jamais. Nous voilà pour six mois dans la tristesse du deuil. Le Roy retourne à Versailles aujourdhuy et va demain à Choisy où je passeray la semaine, touttes nos nopces sont finies ; une innocence de 13 ans a été la proye d'un époux de 25. En vérité celà fait mal. L'amour fait tout supporter et rend tout excusable, les conjoints s'en portent bien. Faites de même dans votre solitude et votre célibat, car je vous suppose dans la sphère du vuide. Tant mieux pour ceux qui sont jaloux de la place que vous leur accordés dans votre coeur, vous serés plus libre pour eux et plus occupée du retour que vous devés aux sentiments désintéressés de la pure et tendre amitié.
Antonia, Toto, le logis, tout va bien.
*
M. de Flobert avait des dettes.
Réflexions naïves de l'Abbé Belliardy,
consul de France en Espagne, sur l'eau bénite de cour.
A Paris le 30 mars 1767.
Enfin jay eu le bonheur de rencontrer M. labbé Belliardy et de l'entretenir tout à mon aise des affaires d'Emilie ; cest M. Partier qui m'a procuré cet avantage, en me priant à diner chés luy dimanche dernier. Il a marqué tout linterest quil prend à vous, a discuté luy même les moyens possibles daméliorer votre sort, nous avons plaidé luy et moy pour la debte de Flobert qui pouroit aussi souffrir de fortes objections si Ion veut vous chicaner. Si les difficultés sont surmontables, M. Belliardy peut seul entreprendre de les vaincre, et nous lavons laissé aussi chaud quil se puisse sur vos interests, j'ay bien vu qu'il l'étoit déjà, et je crois que vous pouvés compter sur touttes les ressources de son esprit, de son zéle et de son amitié ; j'ay reçu de luy l'accueil le plus prévenant et le plus poli, jay senti à qui je le devois. Ce ministre est au mieux avec Versailles, fort aimé de ceux qui le connaissent à la ville, aimé de quelques grands personnages et considéré de l'étranger. L'Espagne je crois ne le gardera pas longtemps. Quil assure votre petite fortune et que le Ciel prenne soin de la sienne. Je désire fort que les ordres de notre Cour le ramènent à celle que vous habittés ; dés que vous pourrés voir clair dans votre état et dans la consistance quil peut avoir, je vous conseille de prendre une résolution prompte ; de faire tous les sacrifices qui seront nécessaires et de fixer votre séjour. Deux établissements à Paris et à Madrid vous épuiseroient, l'ardeur de quelques-uns de vos amis se rallantiroit à la longue ; ainsi ma belle amie il faudra'que votre prudence et votre courage combinent un plan de vie pour vous y arrêter, quel quil soit. Vous ne pouvés pas manquer du nécessaire ; fixés y vos premières idées et laissés faire le reste au temps et aux circonstances.
Je vous diray entre nous une réflexion de l'abbé, qui ne connoit pas assés ce pays cy. Il est étonné que tant de personnes que vous connoissez qui s'intéressent à vous, tant de personnes notables et puissantes qui vous recommandent ne fassent pas autre chose pour vous, et ne vous envoyent pas dautres secours. C'est peu connoitre les hommes que d'avoir cette surprise ; il faut des objets présents pour exciter l'interest, et les grandes protections ne sont pas les plus secourables. Sur celà vous vous dirés tout ce quil y a à dire et tout ce que vous savés mieux que moy ; mais tout celà doit porter votre bon esprit à prendre un parti sage suivant le degré de possibilité et vous y tenir.
Je vous demande pardon ma belle amie de la liberté avec laquelle je vous parle, vous me l'avés permis, cest lamitié inquiète et impuissante qui vous tient ce langage et qui voudroit vous voir heureuse.
Antonia vient de m'apporter ces deux lettres, elle se porte bien et Toto qui l'accompagne aussi. Mille caresses à son fils chéri, je baise les mains de sa belle maîtresse.
J'ay vu le baron et le comte. Je pense que le premier ne partira pas avant deux mois.
*
Le Testament de M. de Flobert
Horreur ! Tout comme le capitaine Fagan dans le film de "Barry Lyndon", ou comme le tuteur du "Voleur", de Darien, le général de Flobert a volé sa pupille, Emilie de Portocarrero ! Voilà ce qu'on découvre en fouillant le passé ! Emilie est furieuse. Comme elle n’a pas le testament de son tuteur, elle essaie de le reconstituer, on ne sait sur quels documents. Voilà sa version des événements :
M. de Flobert est décédé en Espagne en 1763, mais il a fait un testament pour lequel il a nommé deux exécuteurs : MM.Warde et Stuart. M. Warde est mort, mais on peut encore trouver l'autre. Lorsque M. de Flobert est mort, au service de Charles III, la cour d'Espagne lui devait 30 000 livres pour sa solde militaire. Somme énorme ! De plus, il avait touché dès 1752 une rente de 7 000 livres qui appartenait à sa pupille ! Avec les intérêts du capital qui courent depuis près de vingt ans, Emilie calcule que c'est 14 000 livres qu'on lui doit !
Où est passé ce monceau de pesetas ?
Sur ces données, elle consulte un habile homme de loi, qui lui remet un « Mémoire Instructif » irréprochable.
"Vous avez raison, mille fois raison de chercher" lui dit cet homme. "Les exécuteurs testamentaires ont du indubitablement faire des démarches auprès de la Cour d'Espagne tant pour faire liquider le décompte de ces appointements, que pour en toucher le montant.
Ainsi de deux choses l'une : ou ils ont touché, comme cela étoit de leur fonction, ou ils n'ont pas touché.
S'ils ont touché, ils ont aussi fourni au Trésor Royal leurs quittances et décharges ; et dans ce premier cas ils sont eux-mêmes devenus débiteurs vis-à-vis la succession de M. Flobert ou ses créanciers : et c'est à eux directement que Melle de Portocarrero doit s'adresser…"
C'est lumineux ! "D'ailleurs le titre même de leur mission qui est le testament, les assujettit à rendre compte, et ce compte peut être demandé par tous ceux qui y ont intérêt. Quant à la créance de Melle de Portocarrero, elle est dans l'ordre de celles que toutes les lois regardent comme privilégiées, s'agissant de la restitution des deniers d'une pupille." Parfaitement exact ! Et M. de Flobert ne pouvait l'ignorer. Quand il est mort, comme on a vu, en 1763, Emilie a 28 ans. Ce n’est plus une gamine. (On était majeure à 25 ans, à l'époque).
Oui mais voilà : M. de Flobert n'a jamais rendu de comptes de tutelle. Il a proprement étouffé la fortune d'Emilie. C'est un militaire indélicat, ce qui est un pléonasme. "Après tout, s'est-il dit, Emilie n'a besoin de rien. Je me suis assez occupé d'elle. Faite comme elle est, elle saura bien se débrouiller toute seule." M. de Portocarrero, Grand d'Espagne, a bien pris soin de doter sa fille, mais il est mort depuis 1747 : qui ira fouiller là-dedans ?...
Il reste au moins un exécuteur testamentaire : M. Stuart. Emilie s'adresse au Ministre des Finances de Sa Majesté Catholique : M. Esquilace. Pas de chance ! C'est pendant la Révolte des Chapeaux, et M. Esquilace s'enfuit à tire d'ailes pour ne pas être transformé en merguez par les Madrilènes... Il a d'autres chats à fouetter que de rechercher dans un tas de paperasses le testament d'un général français mort depuis belle lurette !
Près de six ans passent, et la ténacité d'Emilie trouve un jour de 1772 sa récompense. Elle importune tellement une Excellence, un certain Ms djo, qu'il fait faire par un homme d'affaires, M.M., une véritable enquête policière.
Les résultats sont très différents de ce qu'avait rêvé notre belle songeuse.
D'abord M. Warde, le mort, s'appelait réellement M. Wast, quelque officier aux Gardes Wallonnes. Quant à M. Stuart il se nomme Ramon Sierra, ce qui est d'ailleurs plus espagnol.
Sa version des faits ne colle pas du tout à celle d'Emilie !
Ramon Sierra n'a jamais eu les papiers de feu Flobert ; ils étaient entre les mains de M. Wast. Bien plus, il n'a jamais ouï parler de droits quelconques d'une demoiselle Amalia Robertot, un des premiers noms d'Emilie. Mais ce qu'il sait parfaitement, lui Ramon Sierra, et il s'offre à en faire une déclaration dûment signée, c'est que M. de Flobert lui devait, à lui, énormément d'argent. Malgré ce qu'il a pu récupérer, il n'a pu recouvrer 34 000 réaux, car il n'a pas voulu faire un procès à Mme Rondé, soeur de M. de Flobert, qui a hérité en France les terres du défunt... Mieux que cela : le gouvernement espagnol n'a jamais payé à lui, Ramon Sierra, les 40 000 et quelques réaux dus à M. de Flobert... On voit que cet homme a perdu beaucoup d'argent, que s'il en récupérait ce serait pour lui, fort perdant dans l'affaire, et qu'il n'y a de toute façon pas un maravédis de prévu pour Emilie.
*
"Extraits de trois lettres de MM. à M. le Ms djo,
la première du 19, la seconde du 20 aoust 1772, la troisième du 7 7bre.
J'ai vu et parlé au sieur Ramon Sierra, cet après-midi, en me bornant au plan que V.E. m'a dicté, et sans qu'il ait pu démêler le véritable objet de ma démarche. Il m'a dit qu'il n'a jamais eu en son pouvoir les papiers de M. de Flobert, qui ordonna, par son testament, qu'ils fussent délivrés à M. Wast, ce qui fut exécuté : que par le même testament, le sieur Sierra fut institué exécuteur testamentaire et nommé héritier fidéi commissaire, avec pouvoir de se faire payement des biens du défunt, sans qu'on put lui demander aucun compte. Qu'en effet il s'y était appliqué, le produit de tous ces biens, indépendamment desquels et des appointements que la Cour devait à M. de Flobert, il lui restait encore dû environ 34 000 réaux, parce qu'il n'avait pas voulu poursuivre les biens fonds que le défunt avait en France, pour lesquels il avait institué sa soeur héritière ; que les appointements que la finance d'Espagne devait à feu M. de Flobert pouvaient aller à quarante et tant de mille réaux - car quoiqu'il prétendit à son décès ceux de quartier-maître de l'armée, ceux de Directeur du Génie et ceux de Maréchal-de-camp, la Cour ne lui accorda que les appointements du premier emploi comme le plus lucratif, et ce, pendant le terme de huit à neuf mois, et que si V.E. ou tout autre voulait une déclaration de tout ce que dessus, il la donnerait sur le champ signée de sa main.
Seconde, du 20 aoust.
V.E. trouvera ci-joint les papiers originaux que Madame de Portocarrero lui a remis en dernier lieu, desquels je garde une copie pour m'en servir dans la suite, si les circonstances l'exigent. Je les ai examinés avec attention, et je trouve qu'il y a des clauses très essentielles et tout à fait différentes des papiers qui ont été produits, et qui existent à la Secrétairerie de la Présidence de Castille pour l'affaire principale de cette dame, raison pour laquelle j'estime qu'il ne saurait lui convenir dans aucun cas de faire usage des papiers ci-joints, attendu qu'on s'exposerait à ce qu'ils fussent confrontés avec les premiers, sur lesquels on ne trouvera certainement pas que Madame de Portocarrero ait été connue sous le nom d'Amalia Robertot, ni baptisée sous condition en 1753 comme il résulte par les papiers inclus.
Troisième, du 7 7bre 1772.
Le Sieur Sierra a été à la campagne plus de quinze jours, il n'est de retour que depuis avant-hier, ce qui fait que je n'ai pu exécuter les ordres que V.E. me donna par la dépêche du 20 aoust, d'exiger la réponse par écrit, et pour ce qui regarde les aliments de cette dame, le majordome de la maison de Montijo m'a promis qu'il les paiera du 10 au 12 de ce mois sans faute."
*
Emilie restera tout au long de sa vie persuadée contre toute évidence que son tuteur lui a laissé quelque chose. En 1775 elle essaie d'agir par notre ambassadeur en Espagne, le comte d’Ossun. Celui-ci répond : "Soyez persuadée, Madame, que s'il y avait quelque moyen d'engager Sa Majesté Catholique à venir à votre secours, je les aurais employés ; j'ai tenté toutes les voies inutilement et pour ce qui concerne vos prétentions contre les biens de M. de Flobert, il n'a rien laissé à sa mort, et il est résulté de toutes les recherches que j'ai fait faire dans les archives qu'il ne lui était rien dû par le fisc royal." Cette mauvaise nouvelle définitive est assortie d’une autre : "Vous ne deviez pas vous attendre au nouvel objet de dépense que la situation de Madame votre mère vous occasionne, et quoique vous lui donniez des secours qui passent vos forces, je suis sûr que vous êtes affligée de ne pouvoir pas suivre à son égard les mouvements de votre coeur. "
Pauvre Emilie ! "Qui ne fait châteaux en Espagne ?" En 1791, ayant appris la mort de Mme Rondé, elle fait encore chercher par un avocat parisien si par hasard dans le testament de cette dame ne se trouveraient pas les 7 000 livres que le traître Flobert lui a piquées.
M. Rondé, le beau-frère de M. de Flobert, était lui aussi un militaire, Commissaire des Guerres attaché à la Maison du Roi pour la 2° Compagnie de Mousquetaires. En 1765 il habitait rue du Doyenné Saint Louis, si joliment chantée bien plus tard par Nerval : c’est actuellement dans la Cour du Louvre, à l'emplacement de la Pyramide.
A Paris le lundy 6 avril. (1767)
Vous serés bien fâchée, ma chère amie, dun accident arrivé à Moretto, Antonia et moy ne voulons pas vous le cacher, je commence à vous prévenir que cet accident ne sera rien suivant les espérences quon nous donne. Elle sortoit de chés moy il y a huit jours au moment que je venois de faire partir ma lettre et la sienne. En traversant le jardin un chien du Duc quelle ne voyoit point est approché de Moretto et l'a mordu au col. Jugés des cris de cette femme qui m'ont fait descendre et voir un spectacle fort triste, jay pensé men trouver mal comme elle. J'ay bien vitte envoyé chercher un carosse et j'ay envoyé du Sigur avec Antonia chés le médecin pour y porter remède, elle vous fait un récit plus exact que celuy que je vous pourrois faire de ce qui a suivi cet accident et de l'état des choses, le petit animal n'a rien dessensiel qui soit endommagé, il mange, dort et ses blessures vont bien, il luy reste seulement de la foiblesse dans les jambes ; on tachera dy remédier quand les playes seront guéries. Jay eu l'oeil sur le chien qui l'a bléssé, comme vous croyés bien, il se porte à merveille et ne peut donner aucun soupçon ; il n'a montré cette méchanceté qu'avec les chiens qu'il ne connoit pas. Jay été désolé que cet accident soit arrivé à Moretto et soit arrivé dans cette maison. Ce n'est point la faute d'Antonia ni de personne ; c'est le hazard, le plus imprévu, c'est une tuile qui tombe. Soyés sure qu'on n'épargne rien pour la guérison, du père de fils fils et que cet évènement nous a donné bien du chagrin. Je vous instruiray de ce qui se passera, et je compte sur le rapport du médecin que j'ay vu moy même que je vous donneray de bonnes nouvelles.
Je nay pas revu M. labbé Billiardy. Le Duc de Duras, Mad. Daligné et bien d'autres luy ont parlé de vous, et vous ont recommandé fortement. Il assure bien fort tout le monde qu’il n’a pas besoin de celà, et quil se dit à luy plus de choses que personne ne luy en peut dire. On a toujours rempli avec égard ce que vous désirés. J'ay vu le Cte et le baron, celuy ci compte partir avant la fin du mois et il s'arrange pour exécuter vos ordres ; je l'estime fort heureux de vous revoir avant nous ; mais aussi, il faudra qu'il vous perde ensuite, et vous le laisserés dans lexil que vous quitterés. Mais quand le quitterés vous, je n'en scay plus rien. Nous connaissons les raisons de ce retard et nous maudissons l'archevêque. Cependant c'est à votre prudence de voir le présent et de calculer l'avenir pour régler quelque chose sur un double établissement qui vous est fort à charge et que vous auriés simplifié si vous aviés pu prévoir tant de retards. Je vais passer la semaine à Choisy. J'enverray savoir exprès des nouvelles de Moretto. Adieu belle amie, vos amis se portent bien.
*
Il y a mille ans, chère amie, que je nay receu de vos nouvelles et j'en suis véritablement en peine. Jay été aussi tardif à vous en donner. Des affaires, des voyages, des déménagements en ont été cause, et point du tout l'oubli que vous ne devés pas soubsonner. Mon absence m'a même empêché de vous envoyer lundy dernier cette lettre d'Antonia qu'elle m'avoit adréssée pour la joindre à la mienne. Antonia et le père à toto se portent bien. Je ne puis rien vous mander des choses générales, je me contente de vous renouveller l'assurence de mon tendre attachement, du désir que j'ay de vous revoir, de celuy que j'ay de votre santé et de votre bonheur.
A Paris le 12 May.
*
A Paris le 28 Juin 1767.
Vous vous plaignés ma chère Emilie par votre lettre du 9° de ce mois que mes lettres ne vous arrivent pas régulièrement, ce ne peut être que la faute des commis de notre Bureau d'adresse, je le feray dire à M. Giamboni ; notre ami Dharboulin est plus exact et vos lettres me sont rendues fidèlement. Vous ne m'apprenés encor rien de nouveau sur votre sort et je partage bien vivement votre impatience. Je suis venu passer deux ou trois jours à Paris ; j'ay visité votre maison où tout est en ordre. La gouvernante de Moretto se porte aussi bien que luy et ils vous désirent tous les deux ; vous le vérrés par la lettre que m'apporte Antonia. Je n'ay vu aucun de vos amis depuis quelques jours, tout le monde est éparpillé dans les campagnes, dans les provinces et dans les garnisons ; on m'a dit que M. le M. de Crillon étoit à Paris, je ne lay point rencontré, sans doute il y sera quelque temps ; vous avés un compliment à luy faire, son fils est fait colonel dans les Grenadiers de France, je crois aussi qu'on va le marier. Je n'ay point entendu parler de Navarre et de son conducteur, sans doute il aura fait passer à l'Hôtel de Soubise le présent que vous avés destiné au prince. Je vais me faire informer si je puis de tout celà. Je crains toujours que votre santé ne soit pas aussi bonne que je le voudrois, vous ne me mandés pas franchement que vous vous portés bien. Ces chaleur vont encor augmenter mes inquiétudes, déffendés vous en le plus que vous pourrés et soutenés le courage dont vous avés si fort besoin. Prenés des dissipations, touttes celles qui peuvent amuser votre esprit, et même occuper votre âme, si cette occupation est nécessaire à votre bonheur. Point de lien s'il vous plaît qui vous détache de nous ; on n'a pas manqué sûrement de vous en inspirer le projet, mais ils ont beau faire vous nous reviendrés, j'en suis sûr. Si je suis moins régulier à vous écrire, ma belle amie, ce n'est pas que je sois moins porté à songer à vous, j'ay toujours les mêmes choses à vous dire, et je vais presque toujours être absent. Il minporte bien plus de savoir comment vous vous portés. Vous estes en l'air, je suis en sûreté. Je désire bien ardemment vous voir jouir du même sort que moy. Dittes à fils fils que je ne l'oublieray pas cette fois et que je luy baise la patte que vous tenés dans votre main.
Jay songé avant hier au manége d'un anglois qui fait içy les tours les plus extraordinaires avec des chevaux que vous aimeriés à la folie. Il en monte trois à la fois qu'il mène tout debout, il court à côté, dessus, dessous, voltige, caracolle et fait des tours surprenants ; il plaît beaucoup à nos femmes quil caracollera ; il ma fait souvenir d'un suédois. Il est fait comme luy.
*
A Madame Portocarrero à Madrid.
A Paris le 16 Juillet (1767)
J'ay receu ma chère amie la lettre consolante que vous m'avés écritte le 27 du mois passé, par laquelle vous me mandés qu'enfin vos payemens sont ordonnés par le Roy et que l'ambassadeur travaille à vous faire partir dans peu. Je vous en félicite, si votre retour vous fait autant de plaisir qu'à nous, et je n'en doute pas sur tout ce que vous me dittes. Vous m'annoncés l'envoy de quelque argent avec la destination que vous en faites, je suivray exactement vos ordres. J'ay prévenu Antonia qui m'est venue voir avec toto qui est plus beau et plus fou que jamais ; Antonia m'a porté ses mémoires qui se montent plus haut que je ne croyois. Elle a receu par les résultats que je vois, soit de Mr de St Germain, de vous ou de moy 680 L., ses gages, nouritures, il luy est redu 926 L. outre quelques mémoires qui m'ont paru en ordre. Vous en jugerés d'un coup d'oeil. Je ne puis vous répondre positivement au sujet de ce que vous voudriés faire passer en France. D'Harboulin est à sa terre, il n'en reviendra qu'à la fin de ce mois, il faut que je le consulte sur les moyens à prendre de faciliter ce passage et il faut que je l'attende pour celà, sil en est le maitre il m'en procurera les moyens. Sil n'étoit question que d'un pot de tabac bien enfermé dans une boëte, vous pourriés la mettre sous l'adresse de Mr Janel directeur des postes de France, en le prévenant il pourroit bien me faire ce plaisir, mais je ne pourrois luy proposer un coffre. Je verray d'Harboulin pour celà. Permettés ensuite une représentation à mon amitié, voicy ce qui arrive, on se ruine en partant d'un pays où l'on croit tout à bon marché, on fait des emplettes pour l'avenir, des provisions dont souvent on n'a que faire, des présents qui ne servent à rien. On trouve icy de tout celà ou des équivalents qu'on achette dans ses besoins ; l'argent est plus portatif que les effets et l'on ne manque de rien à Paris. Pardonnés moy cette petite représentation sur un abus dans lequel j'ay donné moy même.
Jay soupé hier avec le Cte de Creutz et je me suis acquitté de votre commission pour luy, il a été charmé de ce que je luy ay dit de vos affaires et de l'espoir de votre retour. Il veut vous donner à souper à votre arrivée ; le Comte se porte bien. Faites tous mes compliments au Baron si vous le voyés (1) j'attendray de vos nouvelles avec impatience et vos ordres avec la disposition que vous me sçavés de les exécuter avec tout le zéle possible, il égalera mon amitié pour vous, c'est tout dire. J'embrasse tendrement Emilie.
____________
(1): Le baron de Friezendorff.
A Paris le 24 aoust 1767.
Ma dernière lettre écritte à ma chère Emilie est partie par la poste ordinaire sous l’envelope de M. Baden, jenverray cellecy par M. Giambony et par touttes sortes de voyes, jassureray ma belle amie de la vérité et de la constance de mon affection. Jay reçu son dernier paquet contenant des lettres pour Antonia et pour Mr. de Saint Germain qui leur ont été rendues, Antonia vous répond fidèlement et vous rend compte de ce qui se passe chés vous. Toto se porte bien mais sa gouvernante est grosse, quelque légitime quen soit la cause je lay bien grondée, je ne voudrais voir les fardeaux de Ihymen qu'à ceux qui peuvent les supporter ; je considère ensuite que son embarras peut faire le votre précisément dans le temps de votre retour. Je vous diray, quant à ce retour, que je n'y compte pas encore, les obstacles qui l'ont retardé si longtemps tiennent à des liens qui peuvent durer et se multiplier encor. Peut être y en at il de plus d'une espèce, car ma chère amie, je ne puis, quand j'y pense, imaginer que vous avés été assés malheureuse pour ne songer qu'à de tristes affaires ; je connois les sentimens qui vous attachent à ce pays cy et je les crois supérieurs à tout, mais je vois l'ennuy qui a du vous accabler là bas, je vois ce que vous valés, ce que vous mérités d'interest, ce que vous devés inspirer de séduction, je vois les attaques et les deffenses, l'espace du temps, le climat, votre âge, tout peut justifier l'adoucissement que la nature nous invitte d'apporter à nos peines. Il peut sêtre formé par la des chaînes embarrassantes qui rendent peutêtre plus fortes celles qui vous retiennent dans la poursuite de vos affaires ; touttes ces réflexions auxquelles je ne puis me refuser et que je vous prie de me pardonner, écartent un peu lespérence de vous revoir sitôt, mais elles n'en affaiblissent point le désir. Vous devés à mon amitié vos plus intimes confidences ; mais loin d'en exiger, je vous demande... (La fin a disparu).
*
A Paris le 22° 7bre 1767.
Je me trouve obligé, ma chère Emilie, de vous envoyer la lettre cy jointe de votre hôte qui se plaint de n'avoir point eu de vos nouvelles, voilà trois termes quy luy sont dus, et vous estes au bout du monde. Il a bien quelques raisons detre inquiet ; vous sçavés ce que jay toujours pensé de ce logement, de sa dépense et de son inutilité ; comme je ne suis point du tout au fait de vos affaires présentes, je ne puis sçavoir si jay tort ou raison ; votre femme de chambre est aussi dans une situation douteuse et pénible, à votre place si vous ne voyés point de fin à vos affaires d'Espagne je songerois à en mettre une aux affaires de Paris. Je voudrois être en état de vous y aider; mais vous sçavés que jay des charges et des bornes à ma fortune ; vous ne pouvés trop méditer votre situation et trop tôt prendre un parti sur cet article. Pardonnés ce conseil à mon amitié, je ne puis pas vous en donner sur autre chose, n'étant pas instruit, mais étant persuadé que vous ferés le mieux possible dans la contrariété de votre destinée. Si vous estes dans la résolution constante de garder votre logement et sil est nécessaire pour suspendre les poursuites de votre hôte, de luy payer un terme, je luy donneray toujours cet aliment ; répondés luy et faites moy sçavoir, aussitôt que vous le pourrés la résolution que vous prendrés. Votre état me donne de l'inquiétude, vous devés l'attribuer aux sentiments de l'amitié et de linterest qui m'attachent à vous, adieu Belle Emilie, ne me sçachés point mauvais gré de cette lettre sérieuse qui succédera à la lettre folle que je vous ay écritte il ya dix jours.
*
A Paris le 12° 8bre 1767.
Vous devés ma belle amie avoir reçu une lettre peu agréable par laquelle je vous mandois létat de vos affaires à Paris. Pour obvier aux poursuites de votre hôte et à la sentence quil alloit obtenir contre vous jay fait ce que je vous ay promis et jay remis 189 L. à Antonia pour le troisième terme de votre loyer échu, c'est tout ce que jay pu faire dans linstance du moment mais votre hôte est un homme difficile, qui ayant peu de confience sur le passé pourra bien donner congé pour lavenir. Antonia est aussi dans un état qui me fait peine ; cest à vous de voir létat présent et à venir des choses, comme jignore totalement la situation où vous estes, les raisons de votre retard, la possibilité et le temps de votre retour, je ne puis vous donner aucun conseil. J'en ay hazardé qui peuvent tomber à faux parce que je ne suis pas instruit, mais je ne vois pas que ce que deux ans de temps n'ont pu faire soit sitôt prêt à terminer. Lhyver arrive, et cet hyver ne sera pas encor pour nous. Ce qui me fâche, cest de demêler malgré moy votre embarras par votre silence, il y a six semaines que je n'ay reçu de vos nouvelles ; ma plus forte crainte est pour votre santé et j'en suis inquiet ; cachés moy ce que vous faites, mais dittes moy comment vous vous portés, vous avés le courage de supporter une mauvaise fortune, je nay pas celuy de vous savoir malade ; je me feray avec peine à votre absence lorsqu'elle sera nécessaire à votre bonheur, mais je ne veux pas vous croire malade ou malheureuse. Adieu, ces reproches sont ceux de l'amitié.
Ma lettre étoit cachettée quand jay reçeu celle d'Emilie dattée du 28 7bre. Elle se plaint de moy quand je me plaignois d'elle. Mon inquiétude étoit mieux fondée, ne vous déplaise ; je suis en lieu de sûreté, vous estes pour moy au bout du monde. Vous avés tort de douter de mes sentimens, qui sont et seront toujours les mêmes ; mais que voulés vous que vous disent mes lettres quand je vous ay bien assuré de mon affection. Je ne puis vous entretenir de vos affaires que je ne puis connoitre, j'éxécute icy vos ordres, je fais des voeux au Ciel qu'il vous y ramène et vous donne ce que vous mérités, voilà létendüe de mon pouvoir. Vous tachés de ranimer lespoir de votre retour, jay de la peine encor à le croire, de quelque cause que viennent vos retards enfin vous me rassurés sur votre santé, celà me soulage.
Jay remis à Antonia les lettres que vous luy écrivés et je luy ay toujours donné plus d'espérence que je n'en ay. Si je puis voir M. cassagne je macquitteray de vos ordres. Il aura votre lettre. La femme grosse se porte bien, et le gros père aussi. Je vais partir pour Fontainebleau, où je seray jusqu'à la fin du voyage ; bien aise davoir pu avant rassurer Antonia, appaiser votre hôte et sçavoir de vos nouvelles, jembrasse ma chère Emilie et suis toujours le même.
*
A Paris le 3 Janvier 1768.
Voilà, ma chère amie, le commencement de la troisième année qui vous tient séparée de nous, sans que vous puissiez nous donner une espérance bien certaine de votre retour ; le désir que vous en avez vous fait une illusion qui ne se rend pas maîtresse de nous, quelque désir que nous en ayons nous-même.
J'ai lu votre dernière lettre avec bien de l'attention, je n'y trouve encor que des projets vagues, parce que vous n'êtes point dans un point fixe d'où vous puissiez les former ; l'inéxécution de ce qu'on vous a promis me parait tout aussi fondée qu'elle l'était puisque l'ordre du Roi reste toujours sans activité. Permettez encor que mon amitié réfléchisse sur le plan qui parait vous plaire davantage : un retour momentané serait une folie, des dettes içi, des dettes là-bas peut-être, les frais de deux voyages, l'incertitude que j'aurais toujours du retour des fonds espagnols, tout celà me fait difficilement croire que votre conseil et vos facultés vous permettent cette démarche ; j'ose encore vous dire, avec la franchise que vous m'avez permise, que vous vous faites illusion sur l'espoir d'une pension de notre Cour, je vois celà de plus prés que les regards de Madrid. Sur quoi fonder cette attente ? On donne peu de pensions aux étrangers, elles sont très modiques ; il est du quatre ans de celles de tous nos officiers, et par un réglement nouveau on en fait la vente, ne pouvant les acquitter. Il est donc difficile de compter sur cette ressource-là. Et je ne vois que les droits que vous donne votre naissance qui puissent fonder une espérance solide, mais constatez les bien, pour obvier aux chicanes et aux lenteurs que l'on éprouve toujours dans les payements étrangers. Je suis étonné que le zéle de l'abbé B. [Belliardy] ait besoin d'être réchauffé par le vieillard des Invalides. Je pensais que la présence et le souffle d'Emilie étaient bien plus capables de l'inspirer et d'accélérer son ouvrage. Je ferai cependant ce que vous m'ordonnez ; j'écrirai à M. Partier selon votre espoir et d'après vos instructions. Je ne puis l'aller voir, étant sans chevaux, et avec ce qu'on appelle içi la grippe, c'est à dire un rhume fort incommode. Il fait un froid exécrable depuis huit jours et tout le monde est malade. Gardez vous bien de pareille incommodité. Antonia se porte bien, et Toto aussi, mais Antonia s'ennuie et est mal à son aise ; elle entend les voix de votre hôte qui menace toujours. Voyez au nom de Dieu ce que vous avez à faire pour ce maudit logement, voilà la 3° année d'une dépense considérable et superflue...
Voyez, réfléchissez, calculez, je ne puis vous donner des conseils sur des moyens que je ne connais pas ; je vous ai dit les miens et mes embarras particuliers ; et je vous avoue que j'ai eu regret à chaque terme que j'ai payé sans l'espérance de vous revoir sitôt. Je vous fais toutes mes excuses de vous parler avec cette austérité ; les espagnols me donnent de l'humeur, ils ne vous méritent pas, et ils vous chicanent pour vous garder, je vois bien tout celà. Ils vous garderont, j'en suis sûr ; si vous êtes heureuse nous en pâtirons seuls. Je crains de vous donner par cette lettre de bien mauvaises étrennes, je vous en demande encor pardon. La vérité est compagne de l'amitié, et lui fait dire ce qu'elle pense, c'est avec la même voix que je vous assure aussi que je vous suis tendrement attaché pour la vie.
*
A Paris le 9 fev. (1768)
Voilà ma belle amie deux lettres qu'Antonia mapporte pour vous les faire passer, je n'ay pas beaucoup de nouvelles à y ajouter. Jay été fort enrhumé ces jours ci et ne suis pas sorti de la semaine de mon hôtel. Ma toux est fort diminuée, c'est un tribut que je paye chaque hiver, j'en seray quitte après cecy. Mais vous, belle Emilie, comment va cette santé qui vous est si nécessaire dans le pays que vous habittés et dans le tracas où vous estes ? Jay sçu que Monsieur Labbé Beliardy étoit arrivé à notre cour, je nay vu encore personne qui l'ait rencontré parce que jay vu peu de monde. J'ay passé deux fois chez Mr. Yvel sans le trouver. Le pauvre Giambony est sur le grabat depuis quatre mois dans l'état le plus déplorable. Je me suis acquitté de la dernière commission que vous mavés donnée auprès de Mr. de St Germain qui vous répondra sur ce que vous lui mandés et qui fera certainement ce quy dépendra de luy. Comme votre nouvel hôte s'impatiente de ne point voir sa belle hôtesse, pour alimenter sa patience jay alimenté un quartier de loyer, payé jusquau 1° 8bre dernier. Ainsi nayés aucune inquiétude, jespére ces jours ci recevoir de vos nouvelles, vous aurés des miennes aussi régulièrement que je pourray.
Comptés belle amie sur le plus vif et le plus sincère interet quon puisse prendre à ce qui est aimable, à ce qu'on aime, à ce qu'on aimera toujours.
*
A Paris le 18 May 1768
J'attendais ma belle amie pour avoir le plaisir de vous écrire la réponse de M. de St Julien pour vous envoyer l'employ que voicy de l'argent receu sur votre dernière quittance. Vous voilà libre de ce vilain et inutile logement. Je fais passer le restant de 38 F. 16 sols à Melle Verner, ditte Antonia. Je la vois peu, parce qu'elle loge fort loin de mon quartier et que je suis rarement à Paris. Je feray ce que vous désirés et tacheray de sonder ses résolutions ; je la crois toujours la même, l'incertitude de votre retour a causé ses négligences. Peut être qu'elle s'ennuye aussi de son mari et je la trouve triste. Le petit vieillard se porte bien et vous le rajeunirés.
J'ay receu la lettre en grand papier du 28 avril que vous m'avés fait l'amitié de m'écrire. Elle contient des remerciements dont je vous dispense pour toujours. Je puis vous donner des nouvelles de MM. Yvel et Portier, le hazart m'a fait trouver assis entre les deux à une cérémonie de l'Ordre de St Michel où j'ay été obligé d'assister. Vous jugés qu'il a été fait mention de vous. C'est à qui mieux mieux qu'il en a été parlé, leur empressement, leur zéle m'a paru le même pour vous, et je me suis mis à l'unisson de l'intérest. Une troisième personne qui s'est trouvé là a pris part à la séance parce qu'elle vous connoit et s'est jointe à nous pour sçavoir ce que vous faites et comme y prenant beaucoup de part. Je n'ai pas eu le temps de m'informer de son nom. M. Parthier vous recommandera toujours à l'abbé B. Quoy qu'il dise que vous lui êtes très recommandable je vous crois comme luy assés et peut être trop en faveur ; le dénoument de vos affaires a été retardé par plus d'une cause. Des interests particuliers ont pu nuire souvent à l'interest principal. Les incidens ont fait languir la pièce, elle a encor de la peine à finir, et je n'attend pas le dernier acte avant la fin de l'automne. Si le chien destiné pour M. de Soubise arrive, je le feray passer par M. yvel à sa destination ; mon ami d'Harboulin est dans sa terre pour deux mois. Je lui feray part des marques de souvenir d'un homme pour lequel je say qu'il a bien de l'estime et de la considération : je reçois toujours vos lettres exactement. Comme j'ay manqué le jour ordinaire de M. Giamboni je vous écris par M. Baden, vous aurés plutôt cette lettre. Adieu, Belle amie, il fait encore içy très froid, vous avés déjà très chaud dans le climat où vous estes. Je vous y souhaite un peu de repos et beaucoup de santé. J'ay assés de l'un et de l'autre pour ne demander aux dieux que de rester comme je suis. J'embrasse ma chère Emilie.
*
A Paris le 13 Juin 1768.
Comme vous pouvez être en peine, ma chère Emilie, du chien que vous m'avez fait adresser, je ne perds point de temps à vous instruire qu'il est arrivé à bon port par le courrier de Bayonne aussitôt que l'avis que j'en ai reçu par M. Lostau. Le prix du voyage avait été fait à dix écus que j'ai payés. L'animal est un peu maigre, mais il sera, je crois, fort beau. J'ai envoyé aussitôt chez M. Yvel, pour qu'il le présente lui-même au prince ; ils ne sont à Paris ni l'un ni l'autre. (1)
M. Yvel arrive demain, je le chargerai du dépôt, et votre intention sera remplie. M. Lostau m'annonce en même temps qu'il y avait une chienne qui est morte dans la route d'Espagne, vous pouvez en être déjà informée. Si votre sort et votre vie sont toujours les mêmes dans le pays que vous habitez, je mène aussi la même vie que vous savez à la ville ou à la campagne, passant de l'une à l'autre, sans plaisir ni peine, d'une manière assez douce ; vous êtes sûrement plus agitée. Pourvu que votre âme ne le soit point trop ! Il faut qu'elle cherche des plaisirs pour s'occuper et se distraire ; je souhaite, belle Emilie, qu'ils soient pour vous sans mélange. Ce droit n'est presque attribué qu'à ceux de l'amitié, je n'ai pas besoin de vous les conseiller. Je sais que votre coeur est fait pour elle. Comme c'est aussi ma vocation, comme l'âge la fortifie, vous devez être encore plus sure de moi, ainsi ma chère Emilie recevez les protestations sincères de tous les sentiments que je vous ai voués.
Le petit chien de Paris se porte aussi bien que celui d'Espagne, mille caresses de ma part à celui qui a le bonheur de vivre sous vos yeux.
_______________
(1): Le prince est certainement le prince de Soubise.
*
Ma chère Emilie, pardon, si l'expédition que vous m'avez demandée a été retardée, mes absences, celles de vos amis en sont cause, j'ai été ce matin chez le notaire qui me sert et que j'avais chargé de cette besogne, elle était prête à signer. J'ai trouvé sous ma main devinez qui ? Notre intendant des Invalides, qui a comme moi signé l'acte de votre liberté. J'ai écrit à M. Yvel et à l'abbé, pour joindre leurs noms sacrés à mon nom ; cela fait, je vous enverrai la pancarte. Vous croyez bien que j'ai profité de l'occasion pour parler de vous à M. Parthier, il ne vous a point oublié auprès de l'abbé, mais il désespère du succès d'une affaire qui n'a pour elle aucun titre, et il craint que votre ami protecteur ne puisse vaincre les obstacles, il faut donc vous retourner et chercher quelque autre voie, puisqu'il est écrit que le traître Flobert était né pour fermer toutes les routes de votre bonheur.
Nous voilà, ma chère Emilie, tout au milieu de l'automne quand les chaleurs durent chez vous, le froid nous gagne, les montagnes vont se couvrir bientôt, vous ne passerez plus, et le quatrième hiver vous séparera encor de nous. C'est un triste présage qui s'élève dans mon coeur je le reçois pour me faire à cette idée, pour m'accoutumer aux privations nécessaires. Je sacrifie tout à vos raisons que je ne puis savoir ; sans vous arrêter aux satisfactions du moment, vous calculez le bonheur de votre vie ; vos amis, en gémissant, ne peuvent qu'approuver le calcul, vous louer, vous désirer, et vous attendre. Un de mes amis, qui me parle souvent de vous, vient d'être assez malade, c'est le comte de Creuts. Sa maladie était même dangereuse ; il est mieux depuis deux jours. Le flegme que la nature semble lui avoir donné, celui qu'il a du prendre en Espagne n'ont pas empêché, je crois, les passions, les goûts qui causent les maladies inflammatoires. C'est aussi d'une inflammation que la médecine cherche à le guérir (1). Belle Dame, que cet exemple soit un avis. J'ignore l'état de votre âme, je l'ai connue et je la crois sensible, pardon, je connais aussi et vos vertus et votre courage.
Je vis fort peu à Paris, je ne vous en donnerais pas des nouvelles. Il y a quelques temps que je n'ai vu Antonia. J'attendrai vos ordres pour la payer à mesure des fonds qui me restent entre les mains. M. de Saint Julien court les campagnes ; j'y passe ma vie aussi, puissiez vous être aux lieux qui vous plaisent davantage, avoir de beaux jours et de paisibles nuits. Si l'une d'elles me rappelle à vous dans le sommeil, elle doit me représenter sous les traits de l'ami le plus fidèle.
______________
(1) : Tout ceci veut dire que le comte de Creutz a une maladie vénérienne.
A Paris le 1 ° 8bre 1768.
C'est la faute du notaire dont jay fait usage, ma chère Emilie si je ne vous ay pas plustot envoyé le certificat cy joint que vous m'avés demandé il y a quelque temps. Je vous lenvoye, je souhaite que vous le trouviés tel que vous le désirés. J'y joins une lettre d'Antonia que jay depuis huit jours, jattendois pour vous ladresser dans ce paquet. Mr. Giambony prétend quil partira trop tard et quil ne vous trouvera plus à Madrid, je le désire par lassurance que j'aurois de vous revoir plutôt ; mais l'automne s'avance, nous gagnons l'hiver. Les espagnols vous chicaneront pour vous faire rester, et les nèges des Pirenées tomberont avant que vous soyés en route. Ainsi je crains de ne vous voir qu'au printemps. Mon amitié vous deffendroit surtout de vous mettre en chemin le mois de X bre par un temps pareil à celuy où je vous vis partir. Antonia vous rend compte sans doute de l'état de son domestique et des emplettes quelle a faittes sur la notte que je luy ay donnée de votre lettre. Je luy ay donné l'argent nécessaire pour celà. Il m'en reste encore et je m'en serviray pour payer les mois à mesure et par là alimanter son zéle.
M. Parthier, quand je lay vu, m'a beaucoup parlé de vous, de l'abbé votre ami et le sien, il vous a recommandé comme vous le désirés ; mais il croit que la demande que vous faites sur ce qui vous étoit dû par votre vilain tuteur ne soit très difficile ou même impossible à obtenir ; vous devés être sur celà plus au fait que personne. Je ne sçay si lon est fort riche et fort content en Espagne, icy tout le monde murmure ; les bleds sont fort chers, on nest point payé. Il y a de l'embarrras dans les finances, mais on vient d'en changer le Ministre, c'est M. Menon Dinvault qui est nommé Contrôleur Général (1). On attend beaucoup de luy. M. de Boulogne est aussi déchargé de la partie du Trésor Royal quil avoit et qui sera remplie par un Commis du Contrôleur général. Tous ces arrengements montrent qu'on veut remédier aux maux dont on se plaint, et regagner la confiance du public. On attend à Paris l'arrivée du Roi de Dannemarc et on prépare tous les plaisirs qu'on pourra luy donner. Quelque estime que jaye pour les rois, j'aimeroi mieux qu'on m'annonçât votre retour. Bonjour à la belle Espagnolle, puisse telle être francisée tout à fait dans quelque pays quelle soit, je luy conserveray toujours mon fidèle hommage.
Antonia m'apporte en ce moment une seconde lettre que je joins à ce paquet.
_________________
(1) : Maynon d'invau, maître des Requêtes depuis 1747. "En 1769, après onze ans d'administration de Choiseul, d'Invau dit à Louis XV que les finances étaient dans le plus affreux délabrement : 50 millions de déficit annuel, 80 millions de dettes criardes, un an d'anticipation sur les impôts, un cauchemar. " (Bernard Faÿ: "Louis XVI", P. 93.)
*
A Paris le 24 8bre 1768.
Jay receu un peu tard ma chère amie la lettre écritte par La Jeunesse que je remercie de son attention, elle m'a laissé encor de linquiétude, pourquoy ce qui sert à parer la beauté, à augmenter les charmes du visage, vatil mal apropos vous déchirer les mains. Vous ne pouvés par colère avoir brisé ce miroir. Il ne mérite pas cette cruauté, il vous dit si souvent que vous estes belle, que tout est fait, tout est bien, que vous pouvés sortir, que vous plairés. Comment donc ce malheur est-il arrivé, guérissés vitte ces belles mains, je leur rends bien des grâces de la ligne entière quelles ont ajou-
Té à la page du secrétaire, et je les baise de reconnaissance. La Jeunesse me parle de votre appartement. Sçavés vous quil est très difficile d'en trouver tel que vous le désirés, celà est impossible dans le coeur de Paris. L'abbé Calon et moy nous en cherchons plus loin ; je suppose ensuite que nous trouvions quelque chose d'approchant vos désirs. Ne pouvant l'arrêter par l'incertitude du temps de votre retour, tout est loué bien vite. Un appartement que vous n'aurés pas choisy vous même manquera de quelque propriété. Vous ne serés pas contente. Je ne conçois pas les raisons qui vous empêchent comme toutte voyageuse de loger quinze jours en hôtel garni, vous navés qua dire que c'est une maison d'ami, qui s'informera du contraire ; jaimerois mieux être incognito quelque temps. Je vous représente touttes ces choses. Je vous logerois si je pouvois mais je n'ay plus que ma chambre, et bientôt je n'auray plus que l'auberge. J'attend que le duc ait une maison pour me loger dans le quartier qu'il habittera. Je voudrois bien que ce fut aussi le votre. Adieu ma chère amie ; que nous habitions au moins la même ville. Mes remerciements à La Jeunesse. Antonia vous a écrit il y a huit jours.
*
A Paris le 30 8bre 1768.
Je reçois, Belle Amie, la lettre dont vous m'honorés du 17 de ce mois, et j'y réponds sur le champ, pour que vous ne vous plaignés pas encor de moy. Mes lettres quelquefois ne sont pas si fréquentes, mon éloignement de Paris, mes voyages en sont cause. Comme vous le dittes d'ailleurs on ne peut écrire tout ce qu'on pense, et l'on est souvent réduit à des protestations réitérées dont l'amitié n'a pas besoin quand elle est éprouvée comme la notre. Vous m'annoncés, Belle Amie, continuation de séjour, je m'y étois attendu, la saison étant aussi avancée. Vous me dittes de trop bonnes raisons pour ne pas applaudir à votre démarche, tout ce qui peut constater votre état et assurer la jouissance de votre petite fortune doit être privilégié. Loccasion de ce mariage est un lien qui devoit vous retenir, on y ajoute les agréments que vous me dittes, et lon peut donner trois mois à terminer heureusement des affaires qui ont duré trois ans. Je vous ay entretenu dans ma dernière lettre au sujet de votre logement, vous y vérrés mes réflexions sur les difficultés qui se rencontrent ; on aura toujours les yeux ouverts sur le terme du printemps, car je vous conseille de l'attendre dés que vous passés l'hiver au delà des montagnes. Vous les traverserés au retour mieux qu'en allant. Je viens de faire part de ce changement à labbé Calon qui cherche comme moy. Je viens d'instruire Antonia ; vous fériés bien d'écrire un mot à Mr. Yvel, Mr. de St Julien et l'Intendant des Invalides. Tout ce monde vous est fort attaché. Ne voyant point Mr. de St Germain, je ne puis vous en donner des nouvelles. Je le crois frais, gaillard, joufflu comme nous le connaissons. Antonia sen informera et vous rassurrera sur son compte. La longue absence des objets diminue la continuité du souvenir, mais n'en efface point l'idée, qui reprend toutte sa force quand les objets bien aimés se présentent, voilà le sort que vous éprouverés. Croyés que j'auray moins perdu qu'un autre, que je n'auray même souffert aucune perte, m'étant plus occupé de vous que personne. Adieu belle espagnole, faites que nous vous rendions pour toujours le nom de notre patrie. Je baise la main bléssée et la remercie de ce quelle mécrit et ce que j'ay gravé dans ma mémoire.
*
Paris le 6 9bre 1768.
Je reçois, Belle amie, cette lettre de M. de Saint Julien écrite du fonds de ses terres, où il doit être encore un mois. Me voilà de retour à Paris, moi, occuppé à me loger Rue Neuve Luxembourg, dans un appartement sur le rempart qui est assez agréable, et chez une amie de trente ans. La maison des Coigny, chez qui je demeurais, est dispersée dans plusieurs hôtels ; je leur suis toujours également attaché et j'ai gardé un petit logement chez le Duc. Voilà ma situation actuelle. Ma santé est assez bonne d'ailleurs. J'ai été charmé, belle étrangère, que la votre soit devenue meilleure et qu'elle s'accoutume au climat que vous habitez. Le temps où nous arrivons et l'hiver qui s'approche me font penser que vos affaires ne sont pas encor dans le cas de vous laisser venir ; votre empressement, que je crois véritable, est toujours contrarié par votre sagesse et quoiqu'elle nous contrarie aussi, votre sagesse a sans doute raison.
Votre souvenir et votre amitié sont un bien dont je vous prie au moins de ne pas me priver. Melle Antonia me voit quelquefois, elle est constante dans son attente et dans les soins qu’elle donne au vieux petit père qui se porte bien.
*
A Paris le 1° Janvier 1769
Je ne puis mieux commencer cette année, Belle Emilie, qu'en m'occupant de vous par les voeux que je fais pour tout ce qui peut vous être agréable et propice à votre bonheur. Dans le nombre des désirs que je forme entre nécessairement celuy que j'auray toujours de votre souvenir et de votre amitié ; je ne mériteray pas moins vos sentimens par la fidélité de ceux que vous m'avés inspirés. Ils sont à l'abri des danger que cause l'absence, quelque changement qu'elle cause dans touttes les choses de ce monde. Vous nous avés flatté qu'elle ne nous voleroit que le quart de cette année, j'en donnerois la moitié pour être assuré de votre retour, le prix que nous en retirerons fera la solidité de vos aménagements pour la petite fortune qui vous regarde. Je n'ay pas grandes nouvelles à vous mander, on ne parle que du mariage arrêté de M. le Duc de Chartres et de Melle de Lambal, et de celuy de Mademoiselle d'Orléans avec Mr. le Prince de Bourbon. Le premier se fera au printemps prochain, tous nos deuils sont finis, il faut bien les remplacer par quelques sujets de fête, elle n'empêcheront pas qu'on ne murmure toujours un peu de la cherté des grains, de l'embarras des finances et du retard des pensions ; le nouveau ministère travaille à remédier à tout celà. Je suis bien fâché, ma belle amie, de voir encor sur ma commode le paquet que je devois vous envoyer. La difficulté n'étoit pas le trajet de la France, il falloit me marquer le moyen de le faire échapper à la dépence qu'il coûte en Espagne. Ce n'estoit pas la peine de s'y exposer pour si peu de chose, si vous m'indiqués quelque moyen, j'obéiray à vos ordres. Le paquet sans beaucoup de pesanteur, est de 15 poulces en quarré, sur 6 de haut. Jay vu ces jours cy Anthonia, qui vit dans l'espérance. Son élève se porte toujours bien, je dis mille choses à l'enfant de ce vieillard et aux étrangers qui l'accompagnent sûrement. Mille et mille nouvelles assurences à ma belle amie, de l'attachement que j'auray toujours pour elle et des sentimens que je luv ay voues pour la vie.
*
A Paris le 10 Janvier 1769.
Je viens de recevoir, ma belle amie, votre lettre du 26 Xbre. Les paquets quelle contient vont être portés à leurs adresses. Je suivray l'instruction que vous me donnés pour la boëte aux petits écrans, et si je puis y faire entrer les livres que vous me demandés, je les feray partir en même temps. Je suis charmé des bonnes nouvelles que vous me donnés de votre santé, vous faites bien de suivre le régime qui vous est favorable, vous estes née bien constituée. Vous avés fait quelquefois trop de remèdes ; les plus doux vous seront les plus salutaires et je vous les conseille. Vous faites bien de vous amuser de votre ménagerie, mais ce seront des regrets et des privations quand vous prendrés le parti de revenir ; il faudra que vous vous en sépariés ; l'usage de la vie en ce pays, le climat, le transport, les soins, tout doit vous empêcher un transport tel que vous médités peutêtre ; je ne vous permettrais qu'un oiseau et une bête à poil, pour compagnon de voyage. Le père à fils fils n'en veut pas davantage, Antonia penseroit aussi comme luy. Enfin belle dame, vous ferés tout ce qui vous plaira, surtout n'entreprenés pas de rien faire venir par la fantaisie des autre apportés de largent pour satisfaire les vôtres, que je vous conseille de borner à vivre heureuse, je ne vous diray point de nouvelles. Il y a une femme à la Cour nouvellement introduire dont on parle beaucoup, je ne vous en entretiendray pas dans une lettre. Notre Carnaval sera court, et l'on se dispose à se mieux divertir ; vos amusements seront plus graves dans le pays où vous estes, profités en le mieux que vous pourés, mais conformément au régime qui sera nécessaire à votre santé, elle obtient le premier de mes souhaits, dans ce moment où l'on en forme tant pour tout le monde. Bonjour à ma chère Emilie que j'assure de lattachement inviolable que jauray toujours pour elle.
J'ay vu mon ami Dharboulin qui m'a promis de faire contresigner Choiseul le paquet que je luy donneray. Il partira cette semaine, prévenés en M. Baden.
C'est pour vous dire ma Belle amie, que votre Boete est partie hier contresignée d'Harboulin jusqu'à notre frontière maritime et mise ensuite à l'adresse de M. Baden ainsi que vous lavés marqué, le contresaing de notre ami vaut tout autant sur la route que celüy du ministre.
Je dois vous observer que je n'ay pu ajuster dans cette boëte les livres que vous mavés demandés, il eut été trop gros et vous v errés qu'ils n'y pouvaient tenir. On vous les fera passer par quelque autre occasion, quand il s'en présentera. Je vous envoyé cy joint la réponse que vous fait M. de St Julien et quil me charge de vous faire passer. J'ay trouvé l'opulent trésorier dans une maison de ma connoissance, il ma fort bien traité et ma prié à souper pour après demain chés luy. Je m'y rendray pour parler de vous. Les occasions m'en seront toujours chères tant quil ne me sera pas permis de parler de vous avec vous même.
Il y a eu un lit de justice à Versailles pour ordonner la continuation du vingtième, et une création de rentes viagères à dix pour cent sur une tête, et huit sur deux. La grande querelle de la Cour avec le Parlement de Bretagne paroit enfin appaisée sous l'entremise de M. le Duc de Duras qui est allé présider les Etats à la place de M. le Duc d'Eguillon. Rien de nouveau encor à Versailles. Le Carnaval sera court, et l'on se presse d'en jouir ; je ne say si le votre sera bien gay. Je vous souhaite tous les plaisirs que le lieu peut donner, pour moy je commence à renoncer à ceux qui font trop de bruit et donnent trop de mouvement ; il me semble que je me plairois assés dans la paix du petit établissement que vous me peignés. Je vous y verrois négligemment assise, une main sur Toto étendu sur vos genoux, la tête un peu penchée sur un oreiller qui donne de l'expression même aux yeux qui n'en ont pas. Dittes moy si les espagnols vous en trouvent. Je vous réponds qu’icy lon vous en trouvera. Je finis par cette image pour effacer celle de trois belles polonaises qui partent de ce pays en pleurant pour retourner dans le leur où tout est dans le plus grand désordre. Je finis pour aller voir une très bonne actrice qui débutte avec succès aux François et qui fera fortune sur ce théâtre. En quittant ma belle amie je baise cette main que je vois sur Toto.
*
A Paris le 7 Janvier (1)
Vous ne m'aviés pas expliqué assés clairement la manière de faire passer le paquet en question, ma belle amie, et il auroit fallu attendre le courrier extraordinaire, qui peut être ne l'auroit pas reçeu sans ordre. Enfin il est parti, contresigné jusqua Barcelone, adréssé ensuite à Mr Baden. Vous vérrés ce qui en arrivera ; en tout cas la perte ne sera pas bien considérable. Je viens d'envoyer à Antonia sa lettre, elle me paroit très dispose à vous désirer à vous attendre à vous bien recevoir, vous, l'oiseau et la petite meute. Vous attendrés le beau temps pour celà, et vous ferés bien. Notre hyver est fort vilain, notre carnaval fort court. Il auroit pu finir plus tristement. Le Roy a fait avant hier à la chasse à St Germain une chute assés considérable, on lui croyoit le bras cassé, on a pu le ramener à Versailles, il ne s'est rien trouvé de cassé heureusement et tous les esprits sont tranquilles. Vous me demandés des nouvelles d'une personne qui les occupe fort à la ville et à la cour. On annonce chaque jour le cérémonial qu'elle attend, il est sans cesse retardé, cependant on ne doute pas qu'il n'ait lieu. Je ne puis entrer dans aucun des détails de cette grande affaire dont on parle partout assez ouvertement. J'imagine que selon l'esprit de votre cour on doit l'y trouver encor plus singulière. Adieu ma belle amie ne vous excédés pas trop au bal, je nay pas encor mis le pied à celuy de l'Opéra, j'ay renoncé aux plaisirs bruyans et pénibles, il en est de plus doux dans la société et plus convenables à mon âge. Quelque différence quil y ait de vous à moy, modérés ceux que vous prenés. Vous sçavés quel bonheur je vous souhaite par l'intérêt sensible que je prends à vous. Mon amitié fait la régle de mes souhaits adieu belle dame.
__________________
(1): C'est par erreur que Gentil-Bernard a écrit "7 janvier": il s'est trompé de mois. C'est le 4 février 1769 que "chassant dans la forêt de St Germain, le roi fit une chute de cheval, tomba sur le bras, le crut cassé, se montra d'une faiblesse extrême et se fit rapporter, sur un brancard improvisé, jusqu'à ses voitures. On rentra à Versailles à la tombée de la nuit, au milieu d'une cour incertaine et agitée" (Pierre de Nolhac). La personne "qui occupe tant les esprits" est la comtesse du Barry, nouvelle liaison du roi depuis la mort de la Reine. Depuis longtemps Louis XV désirait la présentation à la Cour de sa maîtresse, cérémonie qui officialiserait sa liaison. Mais cette présentation ne se fit pas sans heurts ni intrigues de la faction Richelieu (qui avançait Mme du Barry) contre la faction Choiseul. La chute du roi et la maladie qui s'ensuivit en est un des épisodes.
*
A Paris le 26 février 1769.
Je reçus hier, ma belle amie, la lettre que vous m'avez écrite du 8 de ce mois, par laquelle vous accusez la réception des images portatives que je vous ai adréssées ; je suis fort aise que vous soyez contente de cette bagatelle. J'avais mis moi-même les petits chats sous l'enveloppe, ils se seront perdus, puisqu'il ne se sont pas trouvé, et je vous en enverrai d'autres.
Je suis bien fâché de votre genou malade. A la finesse de la peau j'imagine bien qu'il lui faudrait des caresses plutôt que des frottements rudes, ce pays ci a je crois des mains plus douces et l'on s'y trouverait bien heureux d'employer ses exercices à de pareils usages. Le beau temps vous rétablira, j'aime à voir l'image que vous m'en faites; je n'y répondrai pas par de pareilles peintures, car il fait içi des pluies continuelles et un temps affreux. Antonia soupire surtout dans ce moment de n'être pas auprès de vous, ou que vous ne soyez pas auprès d'elle. Vous êtes bien bonne de vous informer de mon service et de mes gens. Je ne suis pas aussi heureux que je voudrais ; c'est un boeuf humain qui mène mes chevaux. Un second domestique que j'ai est fort et robuste, mais il n'est que celà. J'ai vu celui dont vous me faites l'honneur de me parler: si j'avais été libre, j'aurais pu le prendre. Si je ne puis le servir, je le ferai avec plaisir sur votre recommandation.
Vous êtes bien hardie de me parler comme vous faites d'une belle dame de ce pays ; sa faveur est toujours la même, on attend la dernière marque qu'on doit lui en donner, je crois qu'elle ne tardera pas (1). L'Etoile est toujours dans le palais du Soleil, mais le Soleil est malade ; cependant il sort, il marche et s'agite, mais il se ressent encor de son accident et l'on parle de lui faire prendre les eaux des côtés que vous habitez. Il n'est qu'un peu malade, heureusement, et le pape est mort. Nous avons envoyé deux de nos chapeaux. Il y aura, je crois, un peu de tapage sous les ailes du Saint Esprit. L'Espagne même n'est plus dévote, et tout celà va mal. Portez vous bien, vous, et tenez ferme sur vos jarrets ; je soupais hier avec M. de Saint Jullien, je vous assure qu'il est bien sur les siens, mieux encore M. son fils, grand et beau jeune homme, qui vaudra bien monsieur son père. J'ai fait vos compliments à d’ [?] il sera bien aise s'il revoit içi son cher abbé B. Je crois que tout le monde aura le même sentiment. Si j'étais à Madrid, j'attacherai, quand il viendra, un petit cordon d'un côté au bout de son manteau, de l'autre à votre jupe, il faudrait bien que vous vinssiez. Venez seule, et sans force celà aura encor meilleure grâce. L'ambassadeur ira de son côté, la princesse de l'autre. Vous êtes ma princesse, vous êtes ma reine.
__________________
(1): L’Etoile est évidemment Mme du Barry, qui est dans le palais du Soleil, chez Louis XV, à Versailles. Le roi est encore malade de sa chute de cheval mais il pense toujours à se faire présenter officiellement sa maîtresse. « Complètement rétabli, il annonça dans son cabinet, le 21 avril au soir, qu’il y aurait le lendemain une présentation, une seule, et que ce serait celle dont il était question depuis longtemps celle de Mme du Barry… Celle-ci, impatiente, se sachant moquée des femmes de la cour, blessée dans le rôle de vanité qu’elle remplissait depuis plusieurs mois, avait joué au naturel une scène de larmes… » (Pierre de Nolhac : « Mme du Barry, favorite ». Historia n° 96). « Ce fut un scandale pour toute l’Europe » écrit le comte d’Espinchal, mondain et coureur de théâtres, d’ailleurs très favorable à Mme du Barry (d’Espinchal : « Journal d’Emigration »). Gentil-Bernard est plus mesuré : il en a vu d’autres.
*
A Paris le 9 avril 1769
Vottre lettre, Belle Emilie, ecritte le 20 mars m'a rassuré sur l'article de votre santé et sur l'état de vos affaires. Le détail que vous me faites marque la considération que vous avés dans votre famille, il faut la cultiver, pour qu'elle vous donne des preuves réelles et constantes de l'interest qu'elle prend à vous. Celà demandera peut-être encore du temps, nous partageons le sacrifice ; s'il est nécessaire au bonheur de toutte votre vie, il faut le supporter et attendre. Je vais obéir à vos ordres et faire part de votre souvenir aux amis que vous nommés. J'ay vu Antonia qui est venue ce matin me porter cette lettre que vous trouverez sous cette envelope. Etant allé voir aujourdhuy Mad. la C. d'Egmont j'y ay trouvé enfin M. l'abbé B. que j'ay été fort aise d'embrasser et qui m'a fort bien reçu ; je n'ay pu entrer avec luy dans de grands détails, il m'a parlé de vous, tout haut et très bien. Son interest est pour vous aussi vif que jamais, et je crois que vous pouvés compter sur luy. Il m'a paru qu'il croyoit retourner et vous trouver avec votre famille encor mieux qu'il ne vous y a laissé ; enfin j'ay été très content de luy, de son amitié et de l'interest qu'il prend à ce qui vous touche; je n'ay pu que luy toucher un mot des 7 000 L. Je désirerois fort pouvoir vous les procurer. Je luy en feray parler encor par M. Parthier. Ce seroit une bonne affaire que le gain de cette petite victoire. On vous la chicanera peut être, ainsi que d'autres avantages pour en faire des liens qui vous retiennent auprès des gens qui veulent vous garder. Quant à la grande question de votre départ ou de votre séjour je me retire du conseil ; mon interest me feroit peut être parler ; c'est le votre qu'il faut écouter, et ce sont des amis plus éclairés que moy qui doivent vous conduire. Votre bon sens jugera bien s'ils ont raison ; quoyque le coeur en murmure, il faut du calcul dans ce choix là, la prudence et la fermeté qui mettent à l'abri de tout repentir. Je suis fâché d'être si philosophe avec vous, mais je dois l'être. Je me trouve à l'instant de mon premier décampement, je quitte le 20 mon petit logement borgne, où pourtant je vous ay vu bien des fois. J'habitteray cet été ma grange et mon taudis des Capucines. Au mois d'octobre le duc veut que je loge chés luy dans un hôtel asses commode situé au bout du boulevard, prés la rûe St Honoré vis à vis le marché d'Aguesseau (1). Comme je suis vieux je m'arrangeray si je puis ensuite pour être tout à moy. Je suis si détaché du monde que je n'ay point été voir à Versailles cette superbe nopce de notre premier prince ; un peu de désordre s'y est mêlé par l'extrême affluence de la compagnie. Le Roy s'en est bien trouvé, il monte à cheval et chasse, d'ailleurs tout est dans le même état. Le Pape et le Turc nous mettent dans l'attente des nouvelles. L'Empereur est au Conclave, touttes ces nouveautés sont assés plaisantes. Il en est d'autres qui ne le sont pas tant et qui nous laissent voir beaucoup d'embarras dans nos finances. La Compagnie des Indes fait une lotterie, parce qu'elle n'a pas fait fortune. Faites mieux qu'elle ; si mes voeux étaient écoutés, vous auriés le lot de tout bonheur. J'aspire à celuy de votre amitié, et comme il ne dépend pas du hazard, j'en suis un peu plus assuré. Adieu belle Emilie, je baise la main qui tient la patte de filsfils quoy qu'il en puisse dire.
________________
(1): Presque en face de l'Elysée. Le duc est celui de Coigny.
*
A Paris le 8 Sbre 1769.
J'étois bien empréssé, Belle Emilie, de recevoir de vos nouvelles, enfin votre lettre de lautre mois qui n'a pas d'autre datte m'est parvenue et m'a rassuré sur votre santé, d'abord, ensuite sur votre projet de retour. Je n'avois reçu de lettre que celle du 4 juillet à laquelle je répondis. Je n'ay point entendu parler de la commission qu'on avoit donné pour l'épée d'argent qui devoit m'être remise ; j'aurois éxécuté vos ordres. J'ay été fort en l'air ces temps passés ; je reviens à Paris où je suis encor dans l'embarras du déménagement. Les voyages du Roy à Choisy m'y ont retenu cet automne, il est établi à Fontainebleau. Voilà le froid qui nous gagne, et malgré vos assurances je crains toujours que des raisons de nécessité plus que de goût ne vous retiennent encor. Vous estes sage et prudente, je voudrois que vous fussiés aussi heureuse, et que votre bonheur put s'accorder avec le notre. Le votre dépend de cette circonstance et vous avés raison de le voir très affermi avant de quitter prise. Je n'ay donc point encor un espoir assuré de ce retour prochain, je tiens mes idées suspendües pour leur éviter la peine de se voir trompées dans leur espérence. Consolés nous au moins par vos nouvelles. Jay fait part des dernières à ceux que vous m'avés marqués. Je ne suis point étonné du projet qu'on avoit formé et des vües quon avoit sur vous pour un employ de confience. Vous avés agi prudemment, et soutenu votre considération, je men rapporte à la connaissance que vous avés du lieu et des personnages. Ménagés les bien jusqu'au bout. Je ne suis pas surpris non plus du sentiment qui fait penser l'abbé, ainsi que vous le dittes, peut être aussi voit-il de cette manière vos interets qui cadrent avec les siens. Je ne l'ay vu que deux fois et n'ay pu lui parler de vous qu'à la hâte, j'ay remarqué qu'effectivement son avis n'étoit pas pour le retour. Cependant je ne doute point au fond de l'interet véritable qu'il prend à la solidité de votre bonheur. N'étant point à portée de voir M. Yvel qui court le monde comme moy, je luy ay écrit en luy envoyant l'extrait qui le regarde dans votre lettre pour qu'il engage le prince à parler utilement. Je ne doute pas quil ne le fasse. Comptés sur mes désirs. Belle Emilie, et sur l'interest profond que je prends au bonheur de votre vie. En quelque pays que je le voye écrit, je feray pour vous mon sacrifice au païs. Adieu ; souvenir, amitié, nouvelles. Mon bonheur dépendra toujours beaucoup de vous scavoir heureuse.
Jay remis moy même votre lettre à Antonia qui doit vous écrire ; elle attend, comme vous sçavés, toutou n'attend rien, mille caresses au tendre fils qui vous aime. Melle Antonia arrive chés moy et me remet cette lettre que je joins à la mienne. Elle se porte bien et soccupe toujours de vous comme elle le doit.
*
A Paris, décembre 1769.
Je rends grâces à la belle étrangère, qui nous donne une nouvelle assurance de quitter les bords lointains pour retourner dans sa véritable patrie ; la nouvelle de sa maladie m'a fait trembler, et la cause m'en a fait horreur; je sens à quel point la sensible Adelaide en doit avoir été touchée ; j espère que cette empreinte s'est adouçie, que les regrets se sont apaisés, et que la santé est revenue ; vous avez bien fait de ne pas l'exposer, au terme où nous sommes de la saison, et de n'être pas revenue au temps où vous êtes partie. Attendez que le beau temps vous ramène, que la fin et la sûreté de vos affaires vous porte à ce retour et l'accompagne : vous ne perdrez pas chez nous de beaux moments. Ils sont bien tristes à l'heure que je vous parle. La Cour est embarrassée, la ville est inquiète. On attend des changements décisifs. Nous sommes sans Contrôleur Général. Le notre a remercié, dans l'impuissance de faire exécuter ses projets, qui sans doute ne méritaient pas de l'être. On est toujours menacé de grandes réformes, et chaque citoyen est inquiet. De là naissent des banqueroutes fort considérables ; moi, pauvre hère, je suis la victime de l'une des plus fortes : celle du Caissier des Postes, arrêté à La Bastille ; j'ai dix mille livres engagés dans cette affaire dont je ne retirerai rien. Mon ami d'Harboulin, qui en est un peu cause, y perdra bien plus que moi. Le Trésorier du Prince de Conti a fait aussi un trou à la lune. Vous gagnez à ne pas voir dans ce moment d'aussi tristes spectacles. Il faut espérer qu'ils changeront. Tout le monde refuse de monter au Contrôle Général ; on dit qu'un abbé (l'abbé Théré) s'en chargera. Je lui souhaite les lumières du Seigneur, l'inspiration des prêtres et les miracles de l'autel.
J'ai rendu compte de votre projet à M. de Saint Julien qui sera bien aise de vous recevoir, et qui me charge de vous faire passer cette lettre contenant un reçu qui demande votre signature. On fera de cette somme l'usage que vous désirez, je l'ai déjà annoncé à la demoiselle Antonia, qui vous attend toujours, toujours. Elle est fraîche et rebondie, son petit camarade est gaillard et dispos. Il assure son fils de ses devoirs, et moi aussi. Je ferai avec plaisir l'emplette que vous me recommandez ; je verrai pour les crochets d'acier avec des porte-mousqueton qui ne sont pas entièrement expliqués. L'envoi des lettres de Madame de Sévigné est plus facile, mais par où voulez-vous que je les fasse partir ? Ces choses méritent des précautions.
J'attendrai vos ordres pour une maisonnette ; je ne vous cacherai point que la trouvaille est difficile, en lieu commode et voisin. On fera le mieux, vous ne serez pas contente. Ce quartier est d'une cherté extrême ; j'y loge actuellement séparé des amis chez qui j'étais et qui se sont quittés ; je n'ai que trois pièces pour 1 200 L. Quoique vous paraissiez désirer sur celà, je croirais qu'il y aurait moins d'inconvénients de risquer deux ou trois mois d'appartements garnis pour faire votre choix et votre arrangement vous-même ; vous n'aurez de reproche à faire à personne et vous verrez tout par vos yeux. Vous ferez alors l'emploi de vos richesses domestiques qui sont en sûreté et vous attendent. Si vous avez d'autres ordres à donner, vous aurez le temps de parler, nous d'agir ; comptez sur la volonté, l'envie de bien faire, de vous plaire et de vous voir heureuse. C'est mon premier désir que je fais voler au Ciel pour demander qu'il vous soit propice et favorable.
P.S. Dans mon entretien avec M. de Saint Julien, vous devez croire que je n'ai point oublié la pension et l'extension que l'on désirerait. Il prétend que c'est une des plus amples que l'on donne. Cependant, à la volonté qu'il m'a marquée, je ne désespère pas que les grâces de dieu ne produisent en votre faveur quelque petit accroissement ; fléchissez le genou, et mettez vous en prière.
M. L'abbé Belliardy doit être arrivé dans votre Cour. Son amitié, ses secours, ses lumières pourront vous être encor utiles et je vous félicite de son retour.
*
Emilie revient en France
A Paris le 5 février 1770.
Votre dernière lettre du 16 janv. que jay reçue m'a fait, ma belle amie, le plus grand plaisir du monde. Elle me rassure sur votre santé, me donne de nouvelles preuves de votre amitié et me persuade de votre retour, trois choses précieuses pour moy. Je vous renouvelle la part que je prends à la perte que vous avés faitte ; je trouve fort sages les motifs de votre consolation. Il faut s'armer de raison contre les évènements naturels et tâcher de se contenter de ce que le Ciel nous laisse des portions de notre bonheur. C'est sur quoy je suis forcé d'exercer un peu ma philosophie ; vous scavés dans quel désordre sont les finances de ce païs. Le nouveau ministre prend des arrangements décissif pour remédier à laffaire publique ; mais le particulier en souffre. Je me trouve compris par les effets que jay dans la diminution quil opère et je ne laisse pas que d'y perdre considérablement. Malgré celà, mon peu d'ambition et mon désintéressement me fortifient. Je m'arrangeray suivant les cas, et nétant plus dans lage d'augmenter ma fortune, je jouiray, content, de celle qui me restera. J'aurois voulu pour vous trouver à votre retour un Samuel Bernard, il y a quelque différence (1). Le plaisir de vous voir et de jouir de votre amitié me consoleront de tout et me rendront encor fort heureux. J'ay fait emplette de ce que vous désirés, des deux porte-épées et de ce qui les accompagne. Vous aurés aussi les lettres de Mad. de Sévigné que jay prises. Je vais passer dans le moment rue Coquiliére pour tacher de voir M. Bocelu, je feray usage de tout ce que vous me dittes et verray par luy à vous faire passer les deux paquets. Je me presse de vous écrire cette lettre, parce que c'est le jour qu'elles partent, et que je ne veux pas que vous m'accusiés de négligence. Je borne içy ma lettre pour aller à vos affaires et aux miennes ; finissés heureusement les vôtres avant de partir ; songés que votre meilleure affaire est votre santé, ménagés la je vous supplie et recevés le double au moins des assurences que vous me donnés d'un sentiment auquel j'attache mon bonheur.
________________
(1): Samuel Bernard est le richissime banquier qui finança les guerres de Louis XIV. Néanmoins Gentil-Bernard exagère quand il veut se faire passer pour misérable. Comptons un peu : le bibliothécaire du Roi à Choisy touche par an des pensions qui montent à 30 000 livres : soit la solde de six colonels d'infanterie que tout le monde s'accorde à l'époque à trouver très bien payés. (Un ouvrier touche une livre par jour - quand il travaille...-). Quant à Emilie, avec ses différentes pensions, elle arrivera à palper 5 000 livres par an, ce qui est très beau, pour une femme seule et qui n'a pas les soucis d'un colonel. Mais Gentil-Bernard est surtout très pingre et prévient dès avant son retour les sollicitations possibles d'Emilie. Dans les plus bas salaires, ceux des gens de campagne, un domestique de ferme (travailleur agricole) touche, logé et nourri, une cinquantaine de livres par an, un berger ou un charretier une centaine, une servante entre 30 et 40. On voit qu'avec ses 5 000 livres Emilie est très loin de la misère.
*
La mort du débauché, gravure morale imitée de Hogarth
A force "d'éterniser la chaîne des plaisirs", Gentil-Bernard aurait du se méfier: "redoutez, nous dit-il, possesseur trop heureux, l'excès fatal du tribut amoureux." Voilà certes deux vers prophétiques. Pour ne pas avoir mis en pratique sa propre maxime, notre libertin fut frappé chez son amie, la sage et mélancolique comtesse d'Egmont, d'une attaque de paralysie.
"Au mois de février 1771, âgé de plus de soixante ans, Bernard voulut, en certaine occasion, se comporter comme s'il n'en avait eu que trente, et sans doute il se tira de l'entreprise avec trop d'honneur..." (Et si c'était avec la belle Emilie retrouvée que cette aventure lui était arrivée ?)
"...Le lendemain, comme il était allé faire sa cour à Mme d'Egmont, cette dame, qui était à sa toilette, le pria de lui servir de secrétaire pour répondre à une invitation. Sans doute la comtesse attendait quelque billet galamment tourné : hélas ! Le poète saisit la plume, balbutie, s'agite et s'affaisse sans avoir pu écrire un mot ; la paralysie venait se s'emparer de lui et, quand la première crise fut passée, il ne resta plus du Gentil-Bernard qu'un être misérable entièrement privé de raison." (F. Drujon). Tombé dans le gâtisme qui suit les bamboches, comme une centaine d'années plus tard Baudelaire, Gentil-Bernard se survécut cinq ans, complètement ramolli. Son ami Saurin nous dit que Bernard
D'une pitié stérile objet humiliant,
Victime de l'Amour, dont il chanta l'empire,
Ne fut plus qu'un fantôme errant,
Qu'une ombre vaine qui respire.
Bref, en pleine déliquescence. C'est épouvantable.
La charmante comtesse d'Egmont, témoin de cette scène, mourut pourtant avant son commensal, poitrinaire et à 33 ans, en 1773. Elle s'était trompée d'époque : cette âme fière et patriote aurait dû naître à l'aurore de la Révolution. Elle aurait épousé un maréchal napoléonien et aurait été une héroïne de cette épopée qu'elle appelait de tous ses voeux dans ses lettres à Gustave III de Suède. Or, on peut supposer que si Bernard avait été le débauché crapuleux que par une illusion d’optique et grossissement théâtral ses contemporains nous ont peint, dans le style "Ici Paris" de leur époque, la comtesse d'Egmont, si délicate dans le choix de ses amis, ne l'aurait pas admis chez elle.
Car ce que nous venons de lire sur cette fin exemplaire ressemble fort à une image d'Epinal tirée du « Miroir de l'Ame Pécheresse », ou à une gravure de Hogarth sur la Carrière du Débauché. Que Gentil-Bernard soit mort paralysé ne prouve nullement que ce soit à la suite d'excès sexuels. Sa correspondance avec Emilie prouverait qu'il avait dételé depuis longtemps. "J'ai renoncé aux plaisirs bruyans et pénibles" écrit-il en 1769, à 61 ans : "il en est de plus doux dans la société et plus convenables à mon âge." A propos d'un séjour à la cour, à Compiègne : "Ces dissipations forcées ne me vont pas plus qu'à vous et j'aspire au repos qui m'attend à Paris dans huit jours." Gentil-Bernard a 56 ans au moment de cette lettre, et il lui reste neuf ans à vivre. Il est probable que ses affections furent du genre de celle qu'il voua "à ma chère Emilie, que j'aime de l'amitié la plus tendre et la plus durable."
Il fait son propre portrait :
... "même, pour peu que ce là vous coûte de ne pas me répondre sur celà, que jaye tort, ou que jaye raison nous nous en entretiendrons, nous en rirons même quelque jour ; quand mon imagination cherche à pénétrer les secrets de votre âme, je puis sans crainte vous dévoiler la mienne, elle vous fera le sincère aveu du calme profond dans lequel elle se repose. Ni tourment, ni regret, ni désir ; des dissipations sans attachement, sans trouble ; des commerces d'ancienne amitié qui suffisent à mes affections ; un goût particulier que jay pour la solitude que jhabitte et qui me plaît de plus en plus. Voilà, ma belle amie, le port tranquille où je suis. Vous estes loin encore de la même situation, il faut faire son chemin, je voudrais que le votre fut plus semé de fleurs ; je désire ardemment de vous sçavoir heureuse parce que je vois en vous tout ce qui vous rend digne et capable de l'être et parce que je vous aime très sincèrement."
Sont-ce là des phrases d'érotomane, même distingué ? Il n'y parait pas. Gentil-Bernard ressemble à ces poètes bacchiques qui clament les vertus du jus de la treille, alors qu'ils ne boivent que de l'eau. Rien dans sa correspondance, on l'a vu, toujours décente, n'indique un Casanova, mais bien plutôt un coeur tendre, qui ne demande rien : il écrit pourtant beaucoup à la lointaine Emilie ! "La politesse qu'il portait à la société n'était, au fond, qu'une grande indifférence sur tout", écrit un contemporain. Voire. Combien de ces indifférents ou soi-disant tels, qui ne sont au fond que des sentimentaux blessés ! Et si Bernard s'était simplement conformé, par arrivisme, à l'image de l'érotomane qu'on attendait de lui à Choisy? Après tout, l'érotisme, c'était son fond de commerce...
Un passage assez énigmatique de Chamfort, qui donne pour une fois dans l'analogie, comme un vulgaire croyant, éclaire d'un jour singulier la fin de deux soi-disant mécréants : "C'est une chose bien extraordinaire que deux auteurs, pénétrés et panégyristes, l'un en vers, l'autre en prose, de l'amour immoral et libertin, Crébillon et Bernard, soient morts épris passionnément de deux filles": il ne nous dit, hélas, pas lesquelles. En fait cela n'a rien d'étonnant. Pour amener les âmes à la vérité, c'est-à-dire à l'amour, Dieu, ou la divinité (langage d'époque) se sert de moyens à la mesure de ceux qu'il veut gagner. Il est bien rare que l'amour physique n'amène pas, même chez les plus obtus, une légère lueur de compréhension. Bernard et Crébillon étaient assez raffinés d'esprit pour le devenir de coeur.
De même qu’on nous a montré Bernard érotomane forcené, ce qui est contredit par sa correspondance, on nous le montre complètement gâteux, mais continuant à faire des mots d'esprit : tout cela sent à plein nez la "nouvelle à la main":
"Pendant sa longue démence, un seul éclair de raison brilla dans le cerveau vidé du poète qui avait oublié jusqu'aux noms de ceux qu'il avait aimés, et ne se souvenait même plus de ses ouvrages. Assidu aux promenades et à l'Opéra (même paralysé ?) un jour qu'il voyait jouer "Castor", il demanda quelle était la pièce et l'actrice qui représentait Télaïre. On lui répondit:
- Castor et Mademoiselle Arnould.
- Ah! Oui, s'écria-t-il, ma gloire et mes amours.
Et ce fut tout. Enfin, cinq ans après son accident, il mourut presque subitement à Choisy, le 1 ° Novembre 1775, déjà bien oublié de ceux-là même qui l'avaient le plus adulé." (F. Drujon).
Et Emilie ? On la retrouve dès son retour à Paris, en 1770 rue Meslay, au Marais, sans doute dans un de ces beaux hôtels du XVIIIe siècle tout neufs à l'époque. Certainement c'est Gentil-Bernard qui lui a trouvé son appartement. Pour une fois, la rente de la famille Montijo a l'air d'être servie régulièrement. Gentil Bernard n'habitait pas très loin de la rue Meslay : Place des Victoires - en prenant la rue du Mail et la rue de Cléry, il était chez son amie en un petit quart d'heure -.
Alors qu'on nous le montre irrémédiablement gâteux, depuis son attaque de 1771, il arriva à Bernard une aventure qu'a retrouvé un érudit de la fin du siècle dernier. On sait que Bernard n'avait fait paraître aucune de ses oeuvres. Or, en mai 1775, que voit-il chez un libraire ? Son "Art d'Aimer” et des poésies diverses, sans lieu ni date, édités chez le libraire Le Jay, sans le moindre consentement de l'auteur... "Sa sœur, Mademoiselle Bernard, était aussi contraire à cette publication, elle avait toujours désiré que les poésies de son frère, qui n'avaient aucune utilité morale, restassent ensevelies dans l'oubli..." Evidemment, si le but de la poésie est l'utilité morale, l'édition pirate de ce Le Jay, paré des plumes du paon Bernard, n'avait que peu d'avenir. Il fut poursuivi par Me Louis Bertin (et pas libertin) avocat au Parlement, demeurant à Paris rue des Deux-Ecus, paroisse Saint-Eustache et conseil du poète.
"Le dit sieur Bernard a dit, qu'étant informé qu'on a imprimé, sous son nom, un ouvrage intitulé: l'Art d'Aimer, suivi d'autres pièces fugitives et d'un poème intitulé "Phrosine et Mélidore", en un volume in-8° qui se débite chez Le Jay, libraire, il s'est procuré un exemplaire de cette édition ; que, l'ayant confronté sur ses propres manuscrits, il a été étonné d'y trouver de la conformité pour la plus grande partie, d'autant qu'il n'a confié ses ouvrages à personne avec destination de les faire imprimer, son intention n'ayant jamais été de donner au public des écrits si peu corrects ; en conséquence, ledit sieur Bernard ne pouvant trop se hâter de désabuser le public... etc, etc... interdit l'impression de ses poésies." (1)
L'acte est daté du 2 mai 1775. Six mois après, Bernard mourait. La défense ne dut guère être appliquée, car entre 1775 et 1776 il y eût cinq éditions. Puis de nouveau cinq autres entre 1793 et 1802. Elles furent encore très nombreuses au cours du XIXe siècle, mais bien peu donnent des renseignements biographiques sur leur auteur: les lettres à Emilie Portocarrero sont désormais ce qu'on sait de mieux sur les élans du coeur du bibliothécaire du Roi à Choisy.
___________
(1): Ed. Maignien: "Gentil-Bernard et son Art d'Aimer", article du Dauphiné, 6 avril 1890.
*
Suite et fin des aventures d'Emilie Portocarrero
Emilie a passé en Espagne un peu plus de quatre ans (décembre 1765-février 1770). A son retour a-t-elle profité du "bouquet et de la salade" que son vieil amoureux lui offrait de son ermitage de Choisy ? A la mort de Bernard, en 1775, il lui restait encore vingt ans à vivre. C'était toujours la même insouciante, errante, artificieuse, orgueilleuse et maladroite personne. Les difficultés financières, les déboires familiaux, les mésaventures picaresques et la solitude sentimentale furent son lot jusqu'à la fin : on n'échappe pas à son destin, et le sien était celui d'une enfant naturelle, assez mal reconnue, "de muy mala engana" par sa famille ibérique. Savait-elle que sa rente sur le Clergé lui était versée par l'entregent de Madame de Saint-Julien "d'un naturel des plus ardents”, femme du receveur général et maîtresse de Gentil-Bernard ? Les papiers d'Emilie occupent encore une nombreuse correspondance. Elle habite chez des amis, aux environs de Paris, correspond avec des hommes d'affaires français et espagnols. La fidèle Antonia Verner la quitte subrepticement, on ne sait pourquoi. Emilie loue une grande maison à Echarcon, près de Corbeil-Essonne, et joue les Marie-Antoinette avant l'heure : elle a des chiens, un âne, fait elle-même ses vendanges, son potager. Elle a une nombreuse domesticité et reçoit pas mal d'argent, mais c'est un panier percé. Tout cela ferait l'objet d’un autre livre. Monsieur de Saint-Germain, son ami de jeunesse, lui écrit fidèlement d'abondantes lettres. En 1784, elle s'attache un jeune abbé à la mauvaise santé : Bernard de La Mazelière. Il tombe bien : elle est en pleine déconfiture, criblée de dettes, que M. de Saint-Germain passera dix ans à éponger. Elle doit à son tonnelier, son cocher, son marchand de bois, son pâtissier, etc, etc. Mais les hommes aident toujours Emilie : l'abbé de Crillon fait nommer l'abbé de La Mazelière à la cure de Viterbe, minuscule village près de l'évêché de Lavaur, en Languedoc. Emilie et son abbé s'y réfugient, tels Robinson dans son île. C'est là qu'en 1788 Emilie (qui a 53 ans) reçoit un jour une lettre de son ancien amoureux, le comte de Lascaris, devenu colonel du régiment Royal-Italien où elle l'a fait entrer. Il a fait une belle carrière. Il s'est marié, depuis peu, à une jeune fille de dix-huit ans. Il a l'air heureux. Que durent être les réflexions d'Emilie de Portocarrero en recevant cette lettre ?
A Paris ce 4 Mars 1788
Je ne pense pas, ma chère amie, qu'un silence que je me suis reproché plusieurs fois puisse m'attirer votre indifférence ; vous êtes sure au moins qu'elle n'est pas dans mon coeur sur tout ce qui vous touche. Le tems de mon mariage a été pour moi un tems orageux, j'ai éprouvé beaucoup de dificultés qu'il seroit trop long de détailler ; acablé de soins et d'affaires je ne pouvais m'occuper que de celles qu'il m'étoit impossible de renvoyer à un autre tems. J'ai eu à peu prés deux mois, n'étant ocupé que des [?] et des devoirs et j'ai été après à la campagne où j'ai subi une opération très douloureuse, et qui m'a tenu dans mon lit environ un mois et demi ; dés que j'ai pu suporter la voiture, ma playe étant encore ouverte, je suis parti pour le Mondauphin, où j'ai été jusqu'au 20 7bre. Je suis parti de là pour Turin, et de là à Nice, et je suis arrivé dans les terres de mon beau-pére, en Brie, le 27 8bre. Vous voyés par conséquent qu'en moins de trois mois, j'ai fait six cent lieues, puisque j'étois parti des environs de Paris le 5 du mois d'aout ; nous sommes rentrés à Paris en Xbre, et j’aurais eu certainement le tems de vous écrire, mais il m'a semblé que vous ne déviés rester que deux ans dans ce pais là, et j'aurois crû ma lettre aventurée. J'ai perdu de vue M. de Saint-Germain, je vois souvent l'Abbé de Crillon, mais l'abbé de Richeris est parti pour Madrid avec le Duc de Crillon qui étoit içi à la fin de 86. Il ne m'a écrit qu'une fois depuis son départ.
Il y aura un an le 13 de ce mois, ma chère amie, que j'ai épousé Mademoiselle de Reyhac ; elle aura de la fortune un jour ; je suis jusqu'à présent chés mon beau-pére et belle-mére. Mon mariage s'est fait assez singulièrement et en très-peu de temps, mon inclination m'a bien plus déterminé que la fortune, vous connoissés mon coeur, il me faloit une femme sensible et honnête, je crois jusqu'à présent de l'avoir trouvée, elle n'a que 18 ans, son âge m'a donné de l'inquiétude un moment, mais elle est trés-formée pour l'esprit et le caractère, elle a de la gayeté et de l'amabilité ; d'une taille plutôt grande que petite, d'une figure agréable et régulière, très blanche et blonde. A l'égard des talents, elle joue de la harpe, s'acompagne de la voix, elle est musicienne, et peint assés joliment pour son âge, le coeur excellent, et trés-aimante. L'on m'a remis votre lettre en sa présence, elle m'a demandé qui m'écrivoit, je lui ai donné votre lettre, et je lui ai parlé de vous comme d'une amie trés-chére. Elle m'a dit qu'elle aimoit tout ce que j'aimois, et m'a fait promettre que je vous parlerés d'elle, et que je vous ferois de sa part les plus tendres compliments ; J'ai promis et je tiens parole, mais point de plaisir sans peine, je serois parfaitement heureux si le beau-père étoit plus facile à vivre, mais c'est un homme hypocondre qui nous rend quelquefois trés-malheureux, ne me parlés pas de lui dans vos lettres, mais sans cette circonstance, j'aurais trouvé ce qu'il me faloit pour être heureux, je le suis par le coeur c'est l'essentiel, il faut espérer que le reste viendra.
Vous me prendrés peut-être pour un étourdi, ma chère amie, mais il n'en est pas moins vray que j'ai oublié l'adresse du bijoutier, et de M. de Saint-Germain. J'ai vu ce premier dans le tems, mais je dois vous avoir mandé qu'il me dit qu'on y travaillait, et qu'il ne m'a rien remis. Ayés la complaisance je vous prie de me donner les noms et les adresses, et m'expliquer ce que je dois faire içi pour vous, je m'en aquiterai le mieux qu'il me sera possible. Je dois vous prévenir que je partirai dans le mois de may de Paris et peut-être avant. Je verrai Mademoiselle de Fos sous peu de jours, et le plutôt que je pourrai. Mille compliments de ma part, je vous prie, à votre cher curé et croyés moi pour la vie, avec les sentiments du plus-tendre et fidèle attachement votre trés-affectionné
Lascaris
(Au dos, de la main d'Emilie:)
A Monsieur le Comte de Lascaris Vingtimille, mestre de camp comandant le Régiment Royal Italien, en son hôtel rue Saint Louis au Marais N° 21, Paris.
*
Tous ces gens du XVIIIe siècle finissant seraient à peu près heureux si n’éclatait brusquement un orage épouvantable : la Révolution. Le comte de Lascaris, forcé d'abandonner son régiment licencié par le roi, émigra avec femme et enfants ; il termina sa vie en errant comme il l'avait commencée. On ne sait même pas où il est mort. Quant à l'abbé de La Mazelière, malgré sa mauvaise santé il se révéla une certaine force d'âme ; refusant de prêter serment à la constitution civile du clergé, il s'exila en Espagne, chez d'anciens amis d'Emilie, qui le reçurent on ne peut plus mal. En 1793, l'abbé mourut. Emilie, chassée de la cure de Viterbe par les révolutionnaires, se réfugia au château de Riols près de Teyssode où elle décéda en 1795, à 60 ans. Je suppose qu'elle est enterrée dans le charmant cimetière de ce village, dans le tombeau des Clauzade de Riols. Elle avait passé les dix dernières années de sa vie à faire du bien aux miséreux de Viterbe, leur payant des potions, des médicaments, leur faisant porter des soupes... Toute cette charité lui vaudra un certificat de bonne vie et moeurs des régénérateurs de la France en particulier et de l'humanité en général. On oublia de l'envoyer à l'échafaud avec ses pareils. Peu s'en fallut même qu'une centaine d'années après, l'abbé Maurel, curé de Viterbe en mal de saints pour sa paroisse, ne fasse de l'abbé de La Mazelière un "confesseur de la foi", et d'Emilie quasiment une sainte. Probablement une Madeleine.
Ce qui, sans nul doute, ne lui aurait pas déplu.

Écrire commentaire